« Ce livre ne ressemble à rien qu’à son propre désordre » : la phrase d’Aragon reprend l’épigraphe tirée de Henri Matisse, roman, du même Aragon. Robert Bober cite l’écrivain, semble regretter le fouillis des souvenirs dans lequel il plonge ou puise, avec digressions, retours en arrière et suspens, mais l’ancien apprenti tailleur fait quand même en sorte que tout ça tombe bien. Pas de faux pli : Par instants, la vie n’est pas sûre est d’une bonne coupe. Cette longue lettre adressée à Pierre Dumayet contient dans ses poches multiples un merveilleux fourbi.
Robert Bober, Par instants, la vie n’est pas sûre. P.O.L, 352 p., 21,90 €
Pierre Dumayet, mort en 2011, a été pendant de nombreuses années celui qui posait des questions tandis que Robert Bober filmait. Parfois, ce dernier filmait seul et ce fut par exemple le cas pour Vienne avant la nuit, ou avec Perec pour les Récits d’Ellis Island. Les émissions et documentaires que Bober et Dumayet ont réalisés ensemble étaient des modèles du genre. Aujourd’hui, on nous rebat les oreilles avec la « culture apprenante » ; on ferait mieux de diffuser à une heure de grande écoute « Livre c’est vivre » ou d’autres émissions dans lesquelles on sentait, avec Pierre Dumayet, qu’une « question cela peut être tout simplement une toux, un bruit ».
C’était le cas avec Duras, qui commençait par se taire : « Juste pour s’habituer ». Ce silence unissait Bober et Dumayet ; il liait aussi Dumayet et Dubillard, Bober et Jean Rochefort, ou, autrement, le peintre Serge Lask, enfant de déporté comme lui, Perec, Schwartz-Bart, Sami Frey et tant d’autres. Le portrait de Lask par Jean-Claude Grumberg est simple : « Déjà il était silencieux, sa présence était à la limite de l’absence ». Lask avait choisi la peinture sur le tard : il remplissait le papier de lettres hébraïques, du yiddish pour être précis : « Il faut que ce papier soit usé. Que ça soit usé d’écriture. »
Robert Bober décrit sa bibliothèque. Outre ce qui est prévisible, avec classement d’un type ou d’un autre, l’auteur a collé sur ses étagères des post-it, des phrases qui comptent. Il y en a tant que toutes ne peuvent tenir. Il en change. Parler de ce livre pourrait être un montage de citations – sans se comparer au Paris, capitale du XXe siècle de Walter Benjamin.
Revenons modestement sur terre et sur le pavé parisien qu’arpente l’écrivain et cinéaste. Il retourne avec Joachim, l’un de ses petits-fils, dans le quartier de la Butte-aux-Cailles où il a passé son enfance. Il y a situé Berg et Beck. Il raconte des farces faites avec ce Henri Beck un jour disparu, à qui il continue d’écrire : « Je suis au café mais qui m’attend ici ? Je suis ici et j’écris. Oui, je continuerai à t’écrire puisqu’il paraît que tu n’as de vie que parce que je suis encore vivant. » La phrase vaut aussi pour l’ami Dumayet, pour quelques autres dont nous reparlerons.
Outre le quartier de l’enfance, Bober revoit la rue Vilin et en montre des photographies. Là, il faut savoir regarder, et d’abord voir. C’était la rue de Perec, enfant. Elle a des côtés mystérieux, avec des numérotations bizarres, de quoi intriguer tous ceux qui usent des semelles de chaussures et de l’encre. Raymond Queneau, bien sûr, ou aujourd’hui Didier Blonde, Jean Echenoz ou Patrick Modiano. Le livre contient de nombreuses photos en couleurs et en noir et blanc. Il n’en existe pas pour éclairer le poème « Tête perdue » de Reverdy, dans lequel on ne sait pas ce qui se passe entre le numéro 13 et le numéro 30. D’autres mystères existent, non loin de la place de la République. Si la municipalité nous informe que Jonas était un prophète, elle ne dit rien, rue Dieu, de ce dernier. Une note de bas de page n’aide guère. Et puis déambuler dans Paris, c’est songer aux photographes, et on trouvera de belles anecdotes sur Doisneau, qui, au lieu de sortir son appareil, consolait un berger dont un camion avait éventré le troupeau.
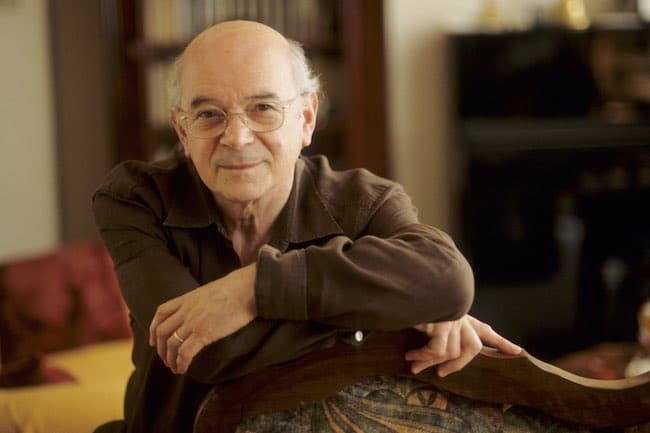
Robert Bober © John Foley/P.O.L.
D’autres photographes jouent des rôles déterminants dans la vie de Robert Bober. Walker Evans a fait de lui le lecteur qu’il n’était pas. Lecteur parce qu’Evans a composé Louons maintenant les grands hommes avec James Agee. Bober apprenait le métier de tailleur et il aurait passé sa vie dans l’atelier sans cette rencontre (pas seulement celle-là, celle avec Truffaut dont il fut l’assistant pour Les 400 coups et Jules et Jim). Il s’est mis à lire. Lentement, patiemment, soulignant des mots, comme allaient le faire les lecteurs dans « Lire c’est vivre ». On peut voir sur Internet des extraits de l’émission. Il y a le couvreur, longtemps illettré, qui a appris grâce à son épouse et à ses enfants, pour lire L’Assommoir. Il y a Jojo, dont je ne dirai rien, qui lit Pierrot mon ami. Et Mme Emorine, se sentant si proche d’Emma Bovary qu’elle ne souligne rien concernant Rodolphe. Dumayet questionnait : « on pourrait faire parler le silence », disait-il. Et s’il l’avait rencontré, il aurait interrogé Flaubert sur le vent qui souffle çà et là dans ses textes.
Une photo de Cartier-Bresson, prise pendant une fête champêtre en 1936, montre deux hommes allongés, de dos. Bober s’amuse à penser qu’il s’agit de son ami et de lui. C’est une façon de se voir, ou de se rêver, puisque ce récit rempli de digressions, de retours sur un détail ou une anecdote, est une rêverie. Mais pas seulement : le réel est là, dans une photographie que l’auteur étudie. Elle montre un lynchage. Un homme est pendu à un arbre, la foule qui a commis le crime regarde du côté du photographe, comme si la victime faisait partie de l’ordre des choses. Le réel, c’est aussi la colère de Bober contre les assassins de Charlie Hebdo. Nommer, c’est rendre vie : il rappelle le nom des journalistes et dessinateurs, en regard de ceux figurant sur l’Affiche rouge. On verra pourquoi.
Ce qu’écrit Bober de son ami Perec et de Paul Otchakovsky-Laurens est émouvant. Ce dernier a connu Bober par Perec. Il a lu les premières pages de Quoi de neuf sur la guerre ? Le futur romancier n’y croyait pas ; Otchakovsky l’a incité à continuer. Cela a duré sept ans, chapitre après chapitre, les pages arrivaient, lentement écrites à la main. Aucun de ses travaux n’a valu autant de lettres à Robert Bober. Avec L’atelier, de Jean-Claude Grumberg, c’est l’un des plus beaux textes sous-titrés en yiddish. Cette langue, c’est l’un des cœurs du livre. Lask est de la même génération que Schwartz-Bart, du même passé. Sa lenteur à parler l’aurait exclu de nos lucarnes modernes. Il fallait Dumayet, Pierre Desgraupes et Max-Pol Fouchet pour comprendre et accepter ses hésitations, ses interruptions, sa peur. Bober parle de silences « impressionnants » : « Comme s’ils permettaient aux mots de ne pas s’égarer, d’y trouver un abri. »
Et puis il y a le yiddish, « langue apprise » et non plus « vécue ». Bober fait visiter la bibliothèque Medem à Erri De Luca, traducteur de cette langue, comme Batia Baum et Rachel Ertel que nomme l’auteur : « Traduire le yiddish aujourd’hui, après son éradication par le génocide nazi, est un acte à la fois d’urgence et de violence », écrit Rachel Ertel. Bober évoque aussi Mordekhaï Litvine, qui a traduit Louise Labé et de nombreux poètes français dans sa langue natale. On les lisait à Varsovie et ailleurs.
Du yiddish au yiddishland, le pas est franchi. Le livre s’ouvre sur ce que célèbrent Dumayet et Bober, dès leur rencontre, à travers leur première émission : le hassidisme. Les livres de Martin Buber, en particulier ses Récits hassidiques et Gog et Magog, suscitent des échanges avec le rabbin Safran et d’autres penseurs. Et si le regard est au cœur du récit et des expériences de Bober, la main l’est autant, célébrée par Alexandre Safran : elle « personnifie cette unité de l’être humain, qui est à la fois matérielle et spirituelle ».
Par instants, la vie n’est pas sûre est un livre de jeune homme, un livre enthousiaste et enthousiasmant. Il y est aussi question de Maupassant et de Max Ophüls, des oiseaux, de Saül Steinberg, des joueurs de cartes de Cézanne, du cardinal Lustiger et de Simone Veil, heureux comme des enfants. Il est question de Louise Carletti, dont Robert Bober était amoureux. Il avait dix ans, on était en 1940, il pouvait admirer l’actrice sur les écrans parisiens, pour quelques mois encore, avant que l’entrée dans les salles obscures ne devienne difficile.












