Un recueil du critique d’art américain Hal Foster apporte toujours, en plus du plaisir qu’occasionne sa lecture, quelque chose de réconfortant. Le plaisir vient des pointes qu’on y trouve, généralement taillées fin et large : elles vont droit au but et visent aussi ceux qui se tiendraient un peu trop près de la cible. Le réconfort est en grande partie lié à ces plaisirs. Ce genre de satisfaction n’est pourtant pas sans mélange. Sans que l’auteur ait rien changé à son style, par le seul poids des circonstances de l’ère Trump, l’amertume qui modifiait la saveur de certains textes de son précédent volume sature à présent celui-ci, non traduit en français : What Comes After Farce?
Hal Foster, What Comes After Farce? Art and Criticism at a Time of Debacle. Verso Books, 224 p., £18.99
Afin d’en saisir la teneur, il faut en effet remonter à Bad New Days, le recueil qu’a publié Hal Foster en 2015 (Verso, non traduit). Il y affirmait entre autres choses que, loin d’être finies, les avant-gardes contemporaines préféraient à la fondation d’un nouvel ordre la mise sous tension de l’existant afin d’en révéler les failles et, au bout du compte, de le faire craquer, en recourant notamment à l’humour. La difficulté sur laquelle se concentrait Foster était celle de leur rapport avec un temps historique déformé par « une histoire absurde », ou, littéralement, « une histoire prépostérieure » (« a preposterous history »), ni passée ni présente, et dans laquelle les « événements semblent à la fois réels et irréels, documentaires et fictifs ».
D’un art si incertain, Hal Foster déduisait que « s’il est trop tôt pour l’historiciser, peut-être n’est-il pas trop tôt pour le théoriser ». Quoique parcellaire, la vue qu’offre la création artistique sur le champ politique permet en effet d’en embrasser toute l’étendue, avec toutefois cette difficulté qu’elle est aujourd’hui à la fois incroyablement dégagée, au point de rendre superflu le rôle d’élucidation du critique, et extraordinairement bouchée, en sorte qu’il est très difficile pour les artistes de proposer une voie de sortie qui ne passe pas pour une dérobade.
Comme le rappelle Hal Foster dans sa préface à What Comes After Farce?, cette clarification a en effet été apportée par le président des États-Unis en personne. Son élection et le cours de son mandat ayant permis de confirmer que « beaucoup de ploutocrates américains considèrent le fait de détruire [trashing] les lois constitutionnelles, de chercher des boucs émissaires parmi les immigrants et de mobiliser les suprémacistes blancs » comme d’un coût moindre que les bénéfices qu’ils peuvent en retirer.
Comme par contrecoup, relève cependant Hal Foster, en jetant un éclairage aussi cru sur les véritables ressorts de ce système, l’ère Trump a également mis en lumière de nouvelles façons d’y répliquer, et relégitimé au passage l’anticapitalisme, l’antiracisme et l’antisexisme avec les mouvements Occupy Wall Street, Black Lives Matter et MeToo. L’impasse à laquelle conduit cet antagonisme tient par conséquent au fait que si, à l’évidence, « une politique de la post-vérité est un problème massif », une politique de la « post-honte [postshame] » ne l’est pas moins. Du temps de Bush fils, un cinéaste militant pouvait encore crier « Shame on you », ce que personne ne songerait à faire à l’adresse de quelqu’un qui est si complètement inaccessible à ce sentiment que son existence même a quelque chose de honteux.
C’est ce qui explique qu’un art qui investissait jusque-là toute sa puissance critique à l’égard de la réalité dans son pouvoir ironique soit désormais pris au dépourvu. Hal Foster reprend en ce sens, et prolonge, le célèbre axiome de Karl Marx contre Napoléon III, selon lequel « l’histoire se répète toujours deux fois. La première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce », pour poser finalement la question qui donne son titre au livre : « qu’est-ce qui vient après la farce ? ». Comment, en effet, se moquer de quelqu’un qui se moque d’être moqué ? Ou, pour le dire en une formule ici intraduisible de l’auteur : « How to out-dada President Ubu? » : « comment exposer à la manière dada le président Ubu », « comment faire plus dada que le président Ubu ? », etc.
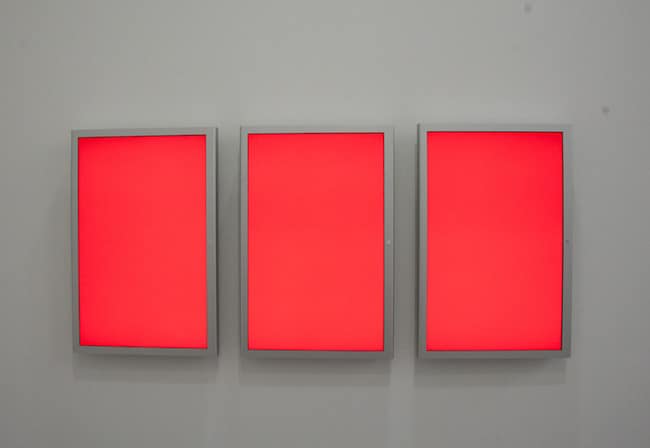
« Red Alert », de Hito Steyerl (2011) © D. R.
À une époque pas si lointaine, les humoristes s’y sont essayés en s’accrochant à chacun des traits du personnage qui en faisaient le grotesque, jusqu’à ses cheveux, qu’ils ont fini par caresser. On conçoit que si les artistes s’y risquent de manière plus indirecte (aucun de ceux évoqués par Hal Foster ne s’attaque frontalement à Trump), c’est moins par couardise que par crainte de finir tout nu face au roi qu’ils croyaient déshabiller. Quant au critique, en consacrant un article au « Père Trump », il reste lui aussi quelque peu interdit devant cette farce qui déborde à présent le cours de sa propre histoire. Celle du kitsch hérité de l’époque Bush, avec « ses rubans jaunes et ses tours enveloppés de drapeaux en décalcomanies » où « une ‟marche pour la libertéˮ libérait souvent les gens jusqu’à la mort, une ‟guerre contre la terreurˮ était souvent terroriste elle-même, et où claironner les ‟valeurs moralesˮ se faisait souvent aux dépens des droits civils ».
Or, cette extension du domaine du kitsch hors de la sphère artistique qui tend à travestir la réalité ou même à la violenter s’est préparée à l’intérieur même de l’art. Certaines réactions d’artistes aux événements du 11-Septembre ont ainsi pu contribuer à brouiller la « ligne entre tragédie humaine et sublimité oppressive », écrit Foster, au point « d’esthétiser sur un mode traumatique » l’horizon visuel de leurs semblables. Pareil brouillage adhère sans surprise au programme du leader sur le marché du kitsch luxueux qu’est Jeff Koons lorsqu’il déclare, par exemple, que son travail vise « à libérer les gens du jugement » ; ce qui revient à les soustraire à la honte.

Photographie aérienne de l’Office National de Reconnaissance (2013) © CC/Trevor Paglen
Le kitsch bushien n’étant pas innocent de la farce trumpienne qui lui a succédé, il est logique et salutaire, selon Hal Foster, de continuer à s’intéresser à des œuvres dont le travail de sape concerne le système tout entier, et non pas uniquement sa face la plus répugnante. (De ce côté-ci de l’Atlantique, on serait évidemment enclin à se demander jusqu’à quel point un président peut à son tour verser dans le kitsch en mimant la tragédie, et dans quelle mesure ses tirades de tragédien s’accordent finalement avec les blagues du farceur pour rendre le tragique grotesque quand celui-ci fait virer le grotesque au tragique ; examen qui mériterait d’être approfondi.)
Aux yeux de Hal Foster, Harun Farocki constitue un cas exemplaire d’artiste ayant su, par le montage, faire voir la dimension oppressive sous-jacente à toute représentation donnée telle quelle. Ce pouvoir de propagation du soupçon, en tant que réplique à la force de persuasion de la propagande, Hal Foster le retrouve chez deux autres vidéastes : le spécialiste des réseaux d’intelligence artificielle Trevor Paglen, et celle des « images pauvres », Hito Steyerl. Cette dernière a d’ailleurs opté pour une stratégie d’esquive caractéristique des nouvelles avant-gardes, qui vise à intensifier les processus du capitalisme plutôt qu’à leur résister, jusqu’à les porter, écrit Hal Foster, « au point d’une transformation explosive ».

« Souvenir 1 », de Kerry James Marshall (1997) © D. R.
Bien que l’art de Kerry James Marshall appartienne, pour sa part, à la tradition de la peinture de chevalet, il peut s’avérer tout aussi implosif. L’un de ses derniers tableaux, exposé en 2018, produit ainsi un étrange vertige, auquel la présence de figures exclusivement noires participe, mais qu’elle ne suffit pas à expliquer, tant la structure indéfiniment duelle de l’œuvre finit par la rendre indescriptible. Rien dans l’espace de la représentation qu’a défini Kerry James Marshall n’est vraiment étrange, alors que tout dans son dispositif paraît instable, qu’il s’agisse du strabisme auquel oblige sa bipartition, de la scission de l’attention provoquée par la différence entre ses deux moitiés, ou de l’effort qu’implique pour l’œil l’assourdissement chromatique de cette « sous-peinture » non titrée, pour reprendre le titre indiqué sur les deux cartels collés sur le support : Untitled (Underpainting).
Kerry James Marshall mine ainsi l’histoire de l’art et retourne du même coup l’histoire jusqu’à convoquer son passé dans un présent bifrons. Ce détournement carnavalesque est d’une tout autre volée que la farce politique dont son œuvre se distancie ostensiblement. Si cette distance est certainement le point commun à toutes les œuvres de « dada-outing » que propose de regarder Hal Foster, c’est qu’au temps d’Ubu les artistes n’ont guère d’autre choix que de se tenir en permanence « entre le critique et le dystopique ». Maintenant, il n’est plus temps d’explorer de nouvelles contrées, mais de créer d’autres pays. Au risque, certes, de se couper du monde, et de vivre en exil.












