Philosophe et traducteur, spécialiste de phénoménologie et membre de l’école belge de Daseinanalyse, Bernard Stevens est l’un de ceux qui ont introduit la philosophie de l’école de Kyôto et la pensée japonaise contemporaine en général auprès du public francophone par des traductions, des essais, des articles. Dans Heidegger et l’école de Kyôto, il s’emploie à faire le point sur la congruence entre la pensée heideggérienne et la pensée japonaise – soit la fécondité réciproque des réceptions de Heidegger au Japon et de la lecture par Heidegger de la tradition culturelle nippone.
Bernard Stevens, Heidegger et l’école de Kyoto. Soleil levant sur forêt noire. Cerf, 356 p., 25 €
La rapide biographie proposée au chapitre 3 par Bernard Stevens, dont on peut citer Topologie du néant. Une approche de l’école de Kyôto (Vrin, 2000), Invitation à la philosophie japonaise. Autour de Nishida (CNRS Éditions, 2005) ou encore Maruyama Masao. Un regard japonais sur la modernité (CNRS Éditions, 2018), rend compte de la genèse de son travail par son désir de sortir de l’auto-enfermement dans lequel se complairait la pensée occidentale et son exploration aussi vaine que rapide d’autres traditions en quête d’un authentique dialogue qu’elles auraient pu nouer – rapide, car il est difficile d’admettre que la Chine et les jésuites, depuis Ricci, ne seraient pas entrés dans un dialogue fructueux.
Ce livre – à la couverture frappante, puisque le montage photographique articule deux clichés, mettant au premier plan un portrait célèbre de Heidegger déjà âgé, dans son costume typique de la Forêt-Noire, dominant le mont Fuji bien dégagé, sans neige, dont il est cependant séparé par un lac et par une colline noire un peu inquiétante – est constitué d’articles écrits à des dates différentes, sur une longue période, ce qui, immanquablement, conduit à des redites, mais permet en même temps de renforcer la cohérence du propos et de répondre à l’injonction de prudence délivrée par Jean Beaufret, à qui le deuxième texte avait été présenté. Ainsi, par des coups de pinceau successifs, Bernard Stevens parvient-il à convaincre de la pertinence de l’éclairage mutuel tel qu’il le commente dans des arguments qui relèvent parfois de l’histoire de la philosophie, parfois de l’introduction à des traditions « religieuses » (confucianisme, bouddhisme, taoïsme et shintoïsme), de l’esthétique aussi, et parfois de la philosophie.
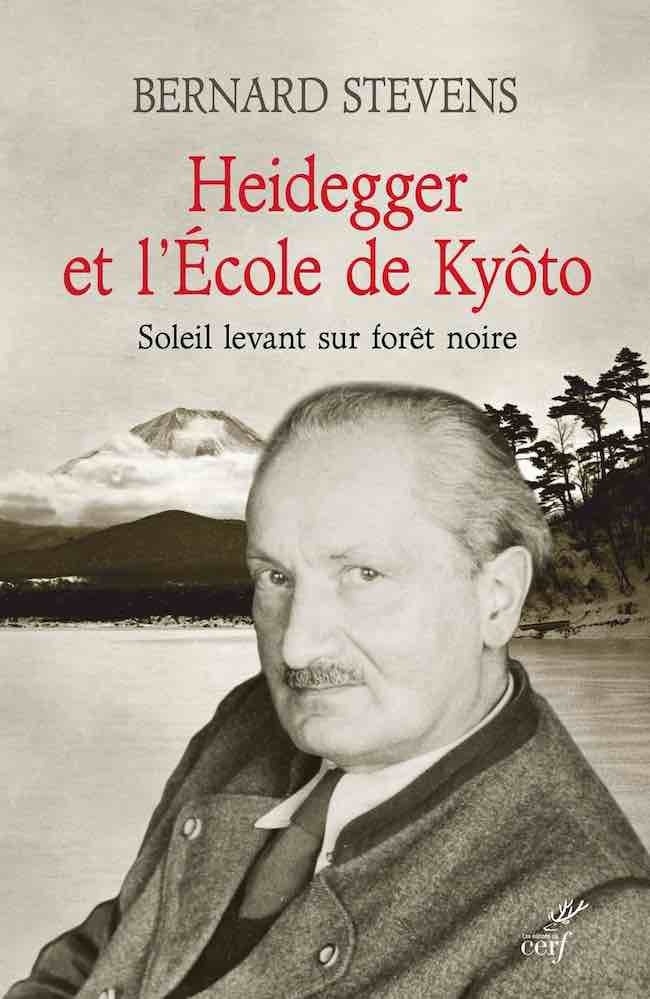
Le déplacement de Heidegger vers le Japon produit un trouble quant à la qualification du geste Heidegger : de la critique de la philosophie comme inexorablement emprisonnée par l’histoire de la métaphysique, et de ce fait partie prenante dans la transformation de celui qui devait être le berger de l’être en pantin du Gestell, surgit, par la superposition d’une pensée dite orientale et de la pensée conceptuelle, l’évidence du basculement vers le prophétique et le mystique. La réception orientale provoque une suspension de la pensée en chemin vers les « sagesses » mais aussi vers la « religion », dont, nous dit Bernard Stevens, est aussi parti le jeune Heidegger, en tant que lecteur des Écritures saintes. Le chemin est tao, comme Heidegger le dit lui-même dans « Entretien de la parole » (publié dans Acheminement vers la parole), qui annonce la rencontre du dire européen et du dire de l’Extrême-Orient. Curieusement, ce n’est pas une révélation purement kairologique, mais également chronologique, car le lecteur est renvoyé au VIe siècle avant J.-C. à un ensemble de « floraisons originaires », trop oubliées, mais qui sont recouvrées aujourd’hui, au moment du plus grand péril – technologie, écologie –qui est promesse de désoccultation de l’oubli…
La réception japonaise de Heidegger fait apparaître une épure de sa pensée, une sorte de simplification sous l’angle de la mystique : l’écoute, le Moindre, le néant, l’ouverture, le Quatre (terre, ciel, mortels et divins) se font entendre comme s’ils étaient débarrassés de ce qui serait des scories, jusque dans l’œuvre de Heidegger, à savoir les concepts hérités de la longue histoire de la philosophie européenne et que Heidegger discute philosophiquement, en un dialogue permanent avec les grands philosophes (Platon, Descartes, Kant…). Le passage par le Japon simplifie ou radicalise, et Heidegger ne s’y reflète plus comme critique acéré de la métaphysique, mais comme protagoniste de l’acceptation des sagesses après élimination pure et simple de la philosophie. De cette tradition sourde à l’Être, Hegel serait le principal représentant, d’autant plus que, dans l’histoire de l’esprit, l’Asie lui échappe totalement, incapable qu’il est de comprendre que son esthétique, de façon remarquable, signifie son refus de l’imitation, de l’illusionnisme, et donc sa totale opposition à la notion occidentale de représentation « due au privilège d’un sujet dominant et de sa perspective sur le monde objectif ».
Les concepts japonais comme celui de shizen (nature comme spontanéité naturelle) permettent de voir ce qui a été oblitéré par la tradition philosophique européenne – par exemple, de réinclure la phusis dans l’ousia, d’où elle a été exclue par Platon, de désubstantialiser le discours sur le soi et d’élargir l’horizon géographique des « rares grands commencements » : ce ne sont pas seulement les présocratiques ou le kairos du Christ, mais tout ce à l’écoute de quoi le penseur qui se réalise comme néant peut se mettre pour entendre la parole originaire, énoncée sans locuteur, forte de ses significations plus concrètes. Les dimensions possiblement nationalistes voire fascistes de cette pensée n’échappent pas à l’auteur, qui les indique chez Nishida et ses épigones, entre désir de puissance et anticolonialisme. Cependant, la caractéristique de Nishida en particulier est que, même si sa discussion de la rationalité européenne est traduite en japonais et pour un destinataire japonais, c’est pour le lecteur occidental, comme post-heideggérien, qu’elle fait sens en réalité. Le prisme heideggérien qu’il donne à sa lecture de Platon ou de Kant les « traduit » en une réception tout aussi mystique – la conscience kantienne devenant le « lieu du néant oppositionnel ».

Kitaro Nishida (1870-1945), une des figures de la philosophe japonaise contemporaine
En effet, les méthodes de Heidegger pour susciter la pensée ou pour l’empêcher de se déployer comme elle en a l’habitude, dans l’idée de revenir au « pur langage », que ce soit par des « jeux de mots » étymologiques ou par la reformulation du sens des mots pour les rendre prétendument à leur signification originaire, ne provoquent pas le même effet, ainsi déplacées dans une culture si différente, que dans le contexte de la philosophie dite européenne ; car c’est bien sa néantisation qui est recherchée et obtenue. Néant, nihilisme, être-en-dette, retour aux choses mêmes, tels sont les principaux concepts heideggériens qui se retrouvent tout naturellement traduits d’abord par Nishida, avec les termes de basho pour la khora grecque, puis par Nishitani en une ontologie religieuse, par Kimura en une psychopathologie phénoménologique et par Watsuji en éthique (chapitre 6). Ce qui retient l’attention est que les néologismes heideggériens trouvent une traduction dans des mots simples de la culture japonaise (aida, ki, mono no aware), ce qui renforce l’impression que quelque chose aurait été perdu en Occident. Ainsi, une partie de l’essai consiste à expliciter les notions japonaises à travers le prisme de la reprise ontologique heideggérienne.
Le dernier essai rassemble en une réflexion plus articulée des éléments qui se trouvent au fil des chapitres autour du rapport entre le modernisme pictural et l’herméneutique heideggérienne, ce qui produit un autre déplacement d’horizon. Ici, ce n’est pas la spontanéité naturelle qui est visée, mais une certaine relation avec la nature où prime le souci de « l’enracinement de la conscience dans la réalité, de la coappartenance, en un sentiment à la fois religieux et artistique, préconceptuel ».
Dans l’ensemble, l’ouvrage nous offre une perspective intéressante sur un dialogue tel qu’il aurait dû avoir lieu, mais se poursuit sous une forme énigmatique. Le livre se termine par la retranscription d’un article d’un philosophe japonais, Tomio Tezuka, rapportant l’entretien qu’il eut avec Heidegger en 1954, au cours duquel il en vint à reconnaître, bon gré mal gré, que le mot pour dire parole en japonais (kotoba) signifiait la chose (Ding) en allemand. La conversation confirme le prisme de Bernard Stevens : « Dans la langue japonaise, tels sont les mots les plus usuels pour exprimer le phénomène, Erscheinung, et l’essence, Wesen. Mais pas dans la terminologie scientifique. N’y a-t-il pas moyen d’exprimer cela avec des mots habituels de l’usage commun ? » Le Japonais s’efforce de répondre à Heidegger « selon les orientations de son intérêt ».
Bernard Stevens s’attache à montrer, de façon érudite et extrêmement forte, que ce dialogue où la pensée de Heidegger vient expliciter une certaine pensée japonaise, celle qui est née à l’ère Meiji, dans un Japon qui sera bientôt l’allié de l’Allemagne nazie, et qui se poursuit jusqu’aujourd’hui, soucieuse de l’originaire, n’est pas détaché de l’histoire du temps, pas plus que ne l’est, selon les mots de Tomio, la « véritable poésie [qui], lorsqu’elle reste inaperçue des hommes, établit un rapport des plus étroits avec l’époque et avec les affaires de l’époque ».












