Mona Ozouf, sans doute l’intellectuelle française qui parle le mieux de George Eliot, avait appelé son essai L’autre George, en référence à George Sand, afin de replacer l’écrivaine britannique en pays de connaissance et d’affection. Deux chapitres de ce livre sont d’ailleurs repris à l’occasion de l’entrée, ô combien bienvenue, de l’auteure du Moulin sur la Floss et de Middlemarch dans la « Bibliothèque de la Pléiade ». Pour saluer l’événement, qu’il nous soit permis d’évoquer « l’autre Eliot » : chanceuse, en effet, est la littérature britannique, qui peut s’enorgueillir de compter dans ses rangs pas moins de deux géants répondant au patronyme d’Eliot : T. S. Eliot, le grand poète moderniste, l’auteur de La Terre vaine (1922), et George Eliot, la romancière victorienne, née Mary Ann Evans.
George Eliot, Middlemarch précédé de Le moulin sur la Floss. Trad. de l’anglais par Alain Jumeau et Sylvère Monod. Édition d’Alain Jumeau. Préface de Nancy Henry et George Levine. Avec deux essais de Mona Ozouf. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1 680 p., 63 € jusqu’au 31 décembre 2020
À l’heure où il serait question de « panthéoniser » Rimbaud et Verlaine, l’entrée de George Eliot dans la prestigieuse collection s’avère, pour le coup, beaucoup moins contestable. Elle vaut consécration de ce côté-ci de la Manche. Et ce n’est que justice. Du reste, une bonne part de l’œuvre éliotienne tourne autour de la notion même d’équité, de justice, humaine plutôt que divine, justice immanente même si la transcendance n’en est jamais tout à fait absente.
Justice politique, également, avec la demande qui monte d’une plus juste répartition des richesses et d’un élargissement du droit de vote (c’est l’argument, entre autres, de Felix Holt, roman authentiquement radical). Il était temps qu’une romancière qui aura fait le bonheur de Proust, Rivière, Gide, Mauriac, qui aura décillé Simone de Beauvoir, trouve, enfin, un public plus large. Et la Pléiade de « mettre le paquet » : une préface de Nancy Henry et George Levine, une introduction d’Alain Jumeau, éminent victorianiste s’il en est, en plus d’être traducteur de Trollope et de Stevenson, une traduction par l’immense et regretté Sylvère Monod, des contributions de Mona Ozouf, on l’a dit plus haut. L’appareil critique est impeccable, formidablement éclairant – même si, reconnaissons-le en toute fairness, la romancière se lit aussi sans notes.
Trop souvent, Eliot fut éclipsée par le génie de Dickens, plus tapageur et turbulent. Sa grandeur n’est pas de celles qui éclaboussent ; elle chemine tout au contraire dans l’ombre, en sinuant et s’insinuant, mais la lumière est au bout. Là est son triomphe, humble et pénétrant, en lisière de la mediocritas des Latins. Elle fuit la spectacularisation, proche en cela de la mesure chère à Jane Austen, avec qui elle a l’ironie en partage. Mais également la volonté commune d’aller à la « rencontre » (le mot est d’Alain Jumeau), de remonter à la source, de la vie intérieure, rendue par les voies et les moyens du style indirect libre. Eliot fait le choix d’un nom de plume masculin pour se fondre dans l’anonymat – tentative vouée à l’échec, bien évidemment, car on ne pardonnera rien à celle qui avait choisi de vivre avec un homme marié, George Henry Lewes (c’est de là que vient « George »), intellectuel de renom. Son goût la porte vers les « Scènes de la vie de province », celle des Midlands, vers la campagne et son mode de vie, tranquille, ritualisé, presque immuable (mais le ver de la modernité est déjà dans le fruit).

George Eliot, par Sir Frederic William Burton (1865) © National Portrait Gallery
Le monde d’avant, en somme. Les tableaux de la vie domestique, et leur héroïsme au quotidien, entre banalité et dépassement de soi, valent bien, ce sera la plus obstinée de ses convictions, l’héroïsme des mystiques (Thérèse d’Avila) ou des croisés ligués contre l’Infidèle. Ses romans, Virginia Woolf l’écrira en une formule restée célèbre, sont les premiers écrits pour un public « adulte ». Les illusions – balzaciennes ? – y sont battues en brèche : folie des grandeurs, fantasmes de maîtrise, de découverte, de gloire, et même de philanthropie, tout est balayé. Le monde est indocile et refuse de se plier à la volonté des hommes – a fortiori à celle des femmes. Il faut se faire une raison, sans en éprouver la moindre amertume.
La sympathie sert de puissant antidote. Tous les personnages y ont droit, sans exception. « Pauvre » Casaubon, mais aussi pauvre Dorothea, pauvre Lydgate, etc. Même le lettré sans cœur et desséché voit sa condition scrutée sans animosité particulière. Le narrateur, la narratrice, n’a pas son pareil pour exiger que le récit tire chacun de ses personnages de sa coquille, de façon à entrer dans la peau de l’autre, à en partager les habitus, la Weltanschauung, l’interaction avec d’autres milieux. Muse démocratique que la sienne, au service d’une vérité non pas relative mais relationnelle, imbriquée dans le tissu conjonctif de la communauté, du réseau, de la toile (web) que tisse Eliot, en araignée résolument empathique.
Pour que cette sympathie prenne, et se transmette au lecteur, il faut, inévitablement, un certain temps. D’où des romans d’une longueur toute victorienne, mais structurellement constitutive de cette volonté d’embrasser en les croisant la science, la psychologie, l’éthique (spinoziste, dans son cas), la politique, la métafiction, l’humour, etc. « Avec les romans anglais la difficulté est d’arriver à la page 175, et ensuite tout va bien », notait Claudel dans son Journal.
Prenons les choses à l’envers, et ouvrons une édition anglaise de Middlemarch, et ses plus de 800 pages, la Oxford World’s Classics par exemple, à la page 175. À une ou deux pages près –la déclaration claudélienne, très tongue in cheek, n’a pas à être prise à la lettre –, cela correspond très exactement au moment où, se retrouvant à Rome où ils passent leur lune de miel, le couple improbable que forme Dorothea et Casaubon, la jeune idéaliste et le vieil érudit, éprouve les premiers signes d’une perte d’estime mutuelle. Le tournant est d’autant plus décisif qu’on avait laissé le couple tout à son bonheur naissant, cent pages plus haut. À croire que la construction narrative du roman, à l’intrigue savamment multiple, passant lentement d’un groupe de personnages à l’autre, exigeait d’abord cette longue attente, ensuite ce nouveau départ, après quoi rien ne va plus pour le couple, alors que tout va bien (mieux) pour le lecteur, dont l’horizon d’attente retrouve des couleurs ouvertement dramatiques, pour ne pas dire tragiques. Enfin, il se passe quelque chose, sous la forme, en l’occurrence, d’un absolu désastre conjugal, et c’est glaçant. En cela, le roman éliotien tient du cricket, sport indéfectiblement anglais, où il peut se passer quelque chose de palpitant à tout moment.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, pour peu que l’emballement survienne, et c’est par exemple le cas dans le saisissant finale apocalyptique du Moulin sur la Floss, l’intensité dramatique est alors à son comble. En règle générale, toutefois, on parlera d’implosion plutôt que d’explosion, car c’est souvent à bas bruit que se produisent les ébranlements majeurs dans la fiction éliotienne. Les catastrophes y sont le plus souvent internes, se produisant dans l’intimité des consciences auxquelles la « transparence intérieure » de la narration permet de donner accès – à la différence de ce qui se passe chez Dickens, dont les qualités sont (tout) autres.
Ce qui vient alors à l’esprit, ce seraient plutôt les failles et autres abîmes qui s’ouvrent dans les poèmes d’Emily Dickinson, la contemporaine capitale de l’autre côté de l’Atlantique. En butte elle aussi aux rigueurs de la société patriarcale, la poétesse de la Nouvelle-Angleterre, pourtant peu suspecte de futilité, idolâtrait Eliot, ses romans comme sa personne (« Ma George Eliot ! », s’exclamait-elle régulièrement), et l’annonce de sa mort la plongera dans un profond abattement. Dans une lettre, elle écrira : « Qu’est-ce que je pense de Middlemarch ? Qu’est-ce que je pense de la gloire ? – à ceci près qu’en de rares occurrences, “cette mortelle a déjà endossé” ».
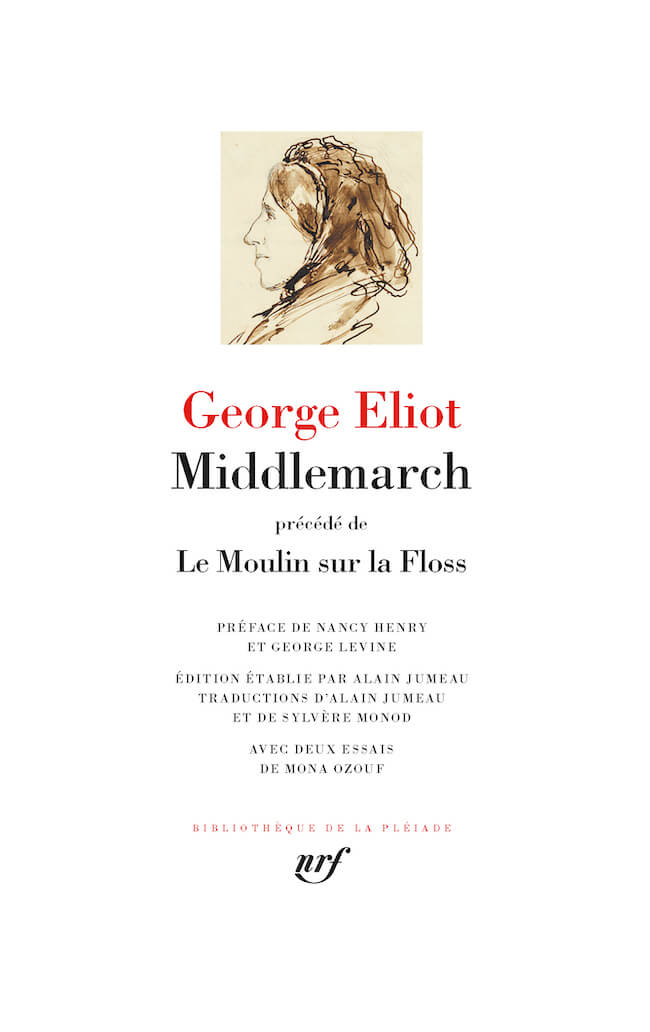
A priori, pourtant, il n’est pas de contraste plus criant entre le minimalisme lapidaire de l’une et l’ampleur maximaliste, et parfois sentencieuse, de l’autre. Mais ces deux sœurs en littérature avaient beaucoup en partage, outre la poésie, à commencer par les doutes et les interrogations, sur la foi, le renoncement, le désir, et puis, last but not least, cette intuition si pénétrante quant à ce qui, dans la trame de nos vies, les troue et nous meurtrit au plus vif : « De cicatrice, nulle trace / Mais une différence interne / Au sein des significations » (dans la traduction de Guy-Jean Forgue).
Restent les soi-disant « atrocités » d’Eliot. Virginia Woolf, dans Une chambre / un lieu à soi, est la première – la seule ? – à les évoquer, en une formulation énigmatique autant que fracassante. Sa thèse est d’ordre stylistique, syntaxique : à l’en croire, Eliot commettrait des « atrocités » du point de vue de la phrase, en cherchant tant bien que mal, et plutôt mal que bien, à se conformer à un modèle de phrase normative et caractéristique des prosateurs et romanciers du XIXe siècle, tous des hommes. Une phrase d’homme, proche de la période latine, lourde et solennelle, à manier par des hommes ; s’y essayer pour une écrivain femme, c’est manquer sa cible, c’est violenter la langue anglaise, c’est lui infliger des souffrances atroces. Une langue à soi, voilà ce qu’Eliot n’aurait pas été capable de proposer. Il est vrai que Woolf se montre souvent ambivalente à l’égard de l’auteure de Middlemarch, ne lui reconnaissant de la grandeur qu’à contre-cœur, semble-t-il, pour des raisons qui sont difficiles à comprendre, parfois.
Force est de reconnaître, pourtant, qu’effacer les passages « atroces » de l’œuvre reviendrait à beaucoup affaiblir la « force » d’Eliot. Et si l’atrocité se tenait ailleurs ? Du côté, plutôt, d’une forme de cruauté ? À condition de s’entendre sur les mots. Pas de sang qui coule, rien de gothique, chez Eliot, mais un mécanisme intellectuel qui, en sourdine, s’apparenterait quelque peu au « théâtre de la peste » imaginé par Antonin Artaud. Ce dernier, on s’en souvient, compte sur l’épidémie pour exercer son pouvoir de contagion, bouleverser l’ordre moral et social, libérer les passions, la force du mal, et, par-delà, faire de la « vie violente » la pierre de touche ultime, ainsi que le dirait Artaud, qui cite Nietzsche.
Pas de peste, dans Middlemarch, mais le choléra est à l’arrière-plan. Mais un homicide, en amont, et bientôt un deuxième, en aval, couverts par l’hypocrisie de la bonne société ; mais une méchanceté sans nom, celle des commères et du commérage ; mais, en lien avec la passion d’Eliot pour la biologie, la science du vivant, et donc de la mort, une cruauté inhérente à l’intrigue darwinienne du roman, laquelle brise les hérauts de la réforme de la médecine, met à nu la volonté de domination au sein du couple et renvoie au néant les « Grandes Espérances ». Une cruauté constitutive de la vie, égoïste et agissante : « Tout ce qui agit est cruauté. C’est sur cette idée d’action poussée à bout et extrême que le théâtre doit se renouveler. » (Artaud) S’agissant du roman, Eliot, qui n’a en rien la folie d’Artaud, fait d’une pierre deux coups. Elle l’accomplit, en le portant à son comble – et elle l’inquiète, au nom du réalisme, en installant la critique, la satire, au centre de son progressisme postulé.
Justice, humilité, hommes et femmes « infâmes » (au sens d’une absence de fama, de « gloire »), cruauté – l’orchestration éliotienne trouve des accents, une résonance, pleinement symphoniques dans les dernières lignes de Middlemarch, sur lesquelles prend également fin le volume de la Pléiade : « Et si les choses vont moins mal qu’elles ne le pourraient pour vous et moi, on le doit un peu au nombre d’êtres qui mènent fidèlement une vie cachée avant de reposer en des tombes délaissées. »
À la mort de la grande romancière victorienne, survenue en 1880, les autorités du temps, qui gardaient en mémoire la femme indigne et scandaleuse, la femme libre d’un mot, refusèrent que sa dépouille pût reposer dans le prestigieux Poets’ Corner, au sein de l’abbaye de Westminster. Entre donc ici, George Eliot.












