On se souvient de l’admirable portrait de femme fait par David Grossman dans Une femme fuyant l’annonce (traduit en français en 2011), de cette mère qui marche en Galilée accompagnée du premier homme qu’elle a aimé, fuyant obstinément l’annonce si certaine de la mort de son fils, qu’elle veut garder hors de ses oreilles, et par là hors du monde. Dans La vie joue avec moi, l’écrivain israélien brosse trois portraits féminins : Véra, sa fille Nina et sa petite-fille Guili, trois générations qui interrogent cette fois, non plus l’amour d’une mère pour son fils, mais les relations si complexes entre filles et mères. L’amour demeure toutefois central et fait de La vie joue avec moi un roman qui irradie, quête réussie d’une vérité réparatrice.
David Grossman, La vie joue avec moi. Trad. de l’hébreu par Jean-Luc Allouche. Seuil, 328 p., 22 €
La complexité n’est pas un vain mot lorsqu’on examine la situation de Véra, Nina et Guili. Alors que Véra fête ses quatre-vingt-dix ans entourée de sa famille au kibboutz, Nina, sa fille, qui vit à l’autre bout du monde, mais s’est déplacée pour l’occasion, détonne par sa raideur. Le malaise s’empare de Guili, la fille de Nina, qui tient le fil de ce récit. On s’en étonne moins en lisant que l’absence de sa mère « a toujours été sa seule contribution à la famille ». L’injonction de son prénom, qui signifie « réjouis-toi », donne le ton. Non parce que Guili décidera de se réjouir de tout, loin de là. Abandonnée par sa mère, elle-même abandonnée par la sienne alors qu’elle était enfant, elle a ses casseroles. Plutôt donc parce que le récit de David Grossman est construit sur un fil, entre tristesse infinie et rires déclinés sur tous les modes : du simple amusement au rire cocasse, dans des situations pourtant tragiques. Outre la beauté des liens entre les personnages féminins, unis d’ailleurs par une figure de l’amour absolu, Raphaël, c’est le véritable kaléidoscope des sentiments et des émotions des personnages, et donc aussi du lecteur, qui fait la saveur particulière et la puissance de La vie joue avec moi.

David Grossman © Claudio Sforza
Un récit de famille sur trois générations, un secret caché lié au Moloch de l’Histoire (ici la déportation de Véra sur l’île de Goli Otok) qui pèse sur chacun des membres de la famille et doit enfin être dévoilé pour que chacun reparte allégé de son fardeau et vive à nouveau : autant d’éléments propices aux larmes et aux grincements de dents. Sans sacrifier l’émotion, bien au contraire, David Grossman fait de La vie joue avec moi un grand jeu de réappropriation de l’expérience, celle traumatique vécue par Véra, transmise à Nina, puis à Guili, et par capillarité à Raphaël : tous les membres de la famille qui ont dû vivre eux aussi, pendant des années, sur l’île-prison, s’en trouvent libérés, peut-être aussi brusquement que Véra elle-même, des décennies plus tôt.
Mais ce n’est qu’au cours d’un voyage « azimuté », d’abord dans le village où Véra s’est installée avec son Milosz adoré, encore jeune fille, puis à Goli Otok pour faire un film destiné à Nina qui perd progressivement la mémoire, que l’expérience de Véra deviendra une expérience commune. Encore faut-il savoir jouer, créer et continuer à aimer pour y parvenir. C’est le succès de cette entreprise déjantée, et la réussite du roman. Les mères abandonnent ou trahissent, les fillettes attendent, éperdument, des « spasmes dans le ventre, au bruit des pas lourds dans l’escalier », ou encore les yeux fixés par terre, mais l’histoire ne s’arrête pas là. Grâce à l’audace et à la vitalité des personnages, grâce à un élan irraisonné pour la vie et ses jeux, l’histoire se poursuit parce que chacun accepte, plus ou moins facilement, de prendre le risque de se confronter à la réalité. Seuls le jeu enfantin et l’innocence permettent de se délester d’une charge qu’on avait fini par aimer porter, parce que la seule chose que l’on connaissait et que l’on maîtrisait, c’est son poids douloureux.
Si Guili connaît le secret de sa grand-mère, que Nina ignore, en tout cas consciemment, tout dans un premier temps la retient loin de cette mère étrangère, qu’elle souhaite punir en ne lui disant rien pour qu’elle se « trimballe jusqu’à son dernier jour sans savoir réellement ce qui a bousillé sa vie. […] jusqu’à son dernier jour, qu’elle sente qu’elle n’est qu’une énorme dissonance. Une poulette, au cou, tranché, qui continue à détaler pendant toute son existence, sans comprendre ce qui lui arrive ». Progressivement, Guili trouve une voie pour s’approcher de cette mère qui la révulsait par sa simple présence physique. La tendresse qu’elle ne pouvait jusque-là manifester qu’à sa grand-mère déborde pour Nina, cette mère qui peut désormais en être une parce qu’elle peut enfin être une fille, celle de Véra. Il fallait en passer par la nuit sur l’île, dans la tempête, sous la pluie et dans les rochers, pour que chacune des trois femmes trouve la place qui lui revient, accompagnées de leur ange gardien, Raphaël.
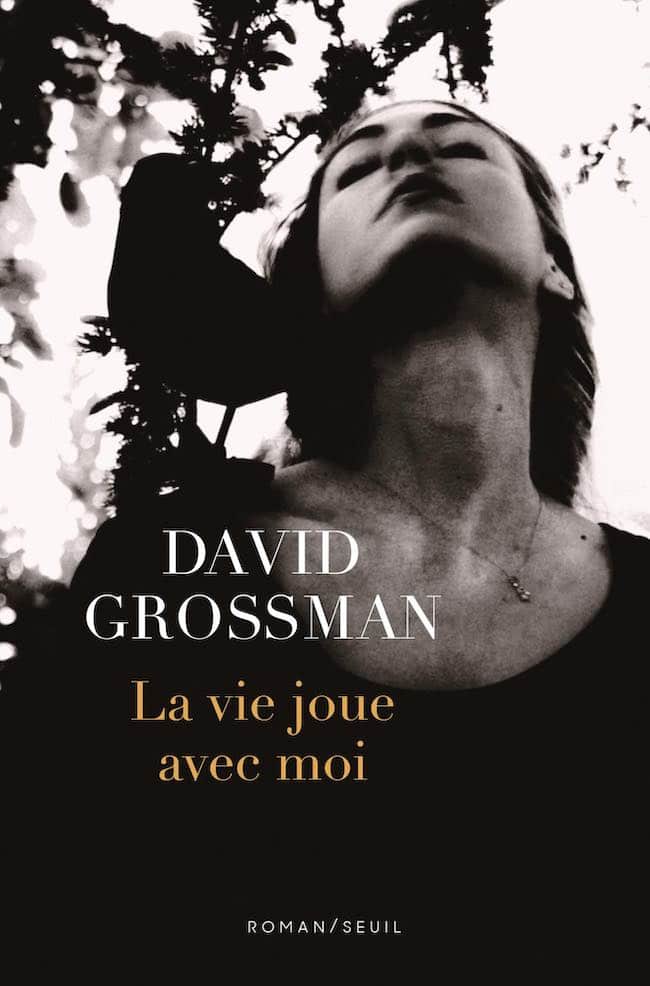
Cette rédemption donne peut-être encore davantage de force au récit qui s’intercale, celui de la détention de Véra dans cet enfer de la Yougoslavie socialiste. Le personnage de Véra, inspiré par Eva Panic Nahir, célèbre et admirée en Yougoslavie, grand témoin de ce que l’on a appelé les « goulags de Tito », et à qui David Grossman rend hommage dans une postface, est une femme qui repousse les limites de l’humain tant son courage et sa force sont extraordinaires. Les épisodes consacrés à sa déportation sont terrifiants : humiliations, tortures, exécutions, trahisons entre les détenues, corps et âmes soumis à l’atrocité de cette île infernale. Femme hors du commun, Véra a survécu et fait de sa vie un élan joyeux, une approbation inconditionnelle de l’existence, y compris dans ses dimensions les plus tragiques. C’est probablement là que réside la joie pleine et entière, et il fallait aussi entendre l’expérience de Véra pendant deux ans et dix mois à Goli Otok pour en saisir la pleine dimension.
Le roman de David Grossman déjoue toutes les attentes : Goli Otok devient la scène de l’amour retrouvé ; le spectre de la trahison, en s’incarnant, disparaît. L’amour absolu de Véra pour son époux défunt, qu’elle n’a jamais trahi, n’est plus un obstacle à l’amour qui circule de nouveau entre Nina et elle. Nina et Guili peuvent elles aussi s’aimer enfin librement. Accepter le jeu et l’expérience partagée, c’est signifier la fin du ressentiment, qu’on abandonne au profit de la création. Il n’y a ni réparation ni consolation, il n’y a que le jeu de la vie. Réjouissons-nous !












