Voici deux livres qui posent de manière originale les problèmes de la fiction. Dans Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?, Pierre Bayard poursuit ses enquêtes sur les noces de la fiction et de la réalité, les livres qu’on n’a pas lus et les histoires contrefactuelles. Cette fois, ce sont les récits soi-disant authentiques qui sont la source d’une réflexion sur le bidonnage littéraire. Dans Représentations factuelles, Frédéric Pouillaude s’intéresse à ce qui n’est pas fictionnel : documentaires, témoignages, reportages.
Pierre Bayard, Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ? Minuit, 173 p., 16,50 €
Frédéric Pouillaude, Représentations factuelles. Cerf, 483 p., 24 €
De l’Histoire véritable de Lucien aux Aventures du baron de Münchhausen, en passant par Le chat botté et Les voyages de Gulliver, les romans picaresques et Tartarin, la littérature ne manque pas de vrais-faux récits de menteurs éhontés, de petits tailleurs qui prétendent en avoir tué sept d’un coup, sans parler des monstres chez qui la réalité dépasse la fiction, comme P. T. Barnum, Rafael Trujillo ou Donald Trump. Mais ce n’est pas de ce type d’affabulateurs que parle ici Pierre Bayard. Ses sujets sont des auteurs qui se veulent sérieux et factuels, qu’ils nous livrent leurs mémoires ou leurs récits de voyage, ou des journalistes, et qui, à un degré ou un autre, travestissent leurs récits, les embellissent ou rêvent complètement les événements qu’ils prétendent raconter.
Les cibles sont Misha De Fonseca et ses pseudo aventures à la Romulus et Rémus avec les loups, Chateaubriand et ses prétendues aventures américaines, Steinbeck et ses soi-disant voyages solitaires avec son caniche Charley, Freud et ses reconstructions de souvenirs d’enfance de Léonard de Vinci, Saint-John Perse et ses autobiographies rêvées, Maria Antonietta Macciocchi et sa Chine imaginaire, les récits contradictoires des multiples témoins dans le meurtre de Kitty Genovese, le canular martien d’Orson Welles, l’évasion du goulag de Rawicz et sa traversée douteuse de l’Asie, et la construction par Arendt d’un Eichmann banal et bureaucrate alors qu’il était un nazi affirmé. Marco Polo aurait été trop convenu, mais Marthe Robin et l’affaire de l’Observatoire n’auraient pas déparé ce lot.
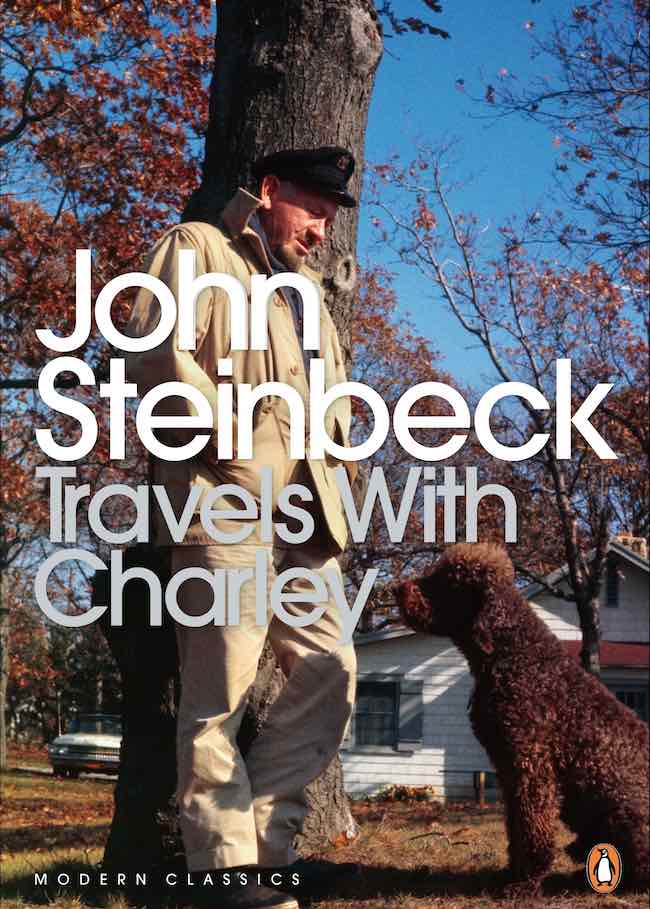
En racontant avec humour ces mélanges d’impostures, de mythomanies, de dissimulations et d’épisodes de dissonance cognitive, Pierre Bayard montre comment on affabule, on recompose, on toilette les récits pour les embellir et s’embellir soi-même. La morale de ces arrangements avec la réalité est double : nous avons besoin de ces reconstructions, et il est vain de chercher à tracer à la serpe une frontière entre réalité et fiction. La notion même de fake news et de post-vérité, nous dit Pierre Bayard, est absurde, car elle méconnaît le fonctionnement de nos esprits, qui fabrique des fables. Il se moque de Fontenelle et de son culte naïf de la vérité : « on commença par faire des livres, et puis on consulta l’orfèvre ».
Mais faut-il faire des livres quand un clown dangereux accède au pouvoir et raconte n’importe quoi ? Faut-il admirer la capacité humaine à faire des récits quand des dictateurs travestissent la réalité et enferment ou tuent des innocents au nom de leurs propres mensonges ? Samuel Johnson disait, par la bouche de Boswell : « La valeur d’une histoire dépend de sa vérité. Une histoire est l’image d’un individu ou de la nature humaine en général ; si elle est fausse elle n’est une image de rien du tout. » Ce credo classique n’est plus le nôtre. Mais ne sommes-nous pas devenus tellement amateurs de fictions que cet idéal finit par devenir admirable ?
Ce dossier s’épaissit si l’on se tourne, comme Frédéric Pouillaude, vers les œuvres qui visent à ne pas être fictionnelles. Quand on parcourt les rayons des librairies, il y a de plus en plus souvent une section intitulée « non-fiction », qui recouvre aussi bien des témoignages que des documents, des reportages et des biographies. Ces œuvres ont acquis une position dominante dans notre culture. Elles sont supposées, à des degrés divers, valoir comme « représentations factuelles ». Elles visent toutes à représenter des choses extérieures à l’espace de l’œuvre et à ne pas relever de l’imagination. C’est une catégorie extrêmement variée et problématique, qui recouvre des médias très distincts – photographies, images, livres, cinéma, performances théâtrales, danse, bandes dessinées – mais qui, très souvent, vise à représenter une réalité tragique : guerres, génocides, massacres, maladies, pauvreté, et le lot de la douleur humaine.

En 1938, Orson Welles annonce une invasion extraterrestre, en adaptant à la radio « La Guerre des mondes » de H.G. Wells © CC/The Granger Collection
Ces types d’œuvres sont aussi supposées à la fois être « artistiques » et « documentaires », donc relever à la fois de normes de représentations associées à des valeurs esthétiques et de normes relatives à la véracité et à la vérité. Le débat est connu au sujet de la photographie, mais aussi du cinéma, qui fut lancé de manière provocante par Roger Scruton (qui n’avait manifestement pas lu André Bazin) : si la photographie est seulement enregistrement ou reproduction du réel, comment peut-elle représenter quoi que ce soit qui puisse avoir un sens, et par là avoir une visée artistique ? Inversement, si les documentaires ont une visée artistique, comment peuvent-ils vraiment documenter et dire le réel ? Les structuralistes post-barthésiens, qui ne voient que des « effets de réel » dans ces proses ou performances, les derridiens qui ne voient pas de frontière entre métaphore et discours descriptif, seront ravis de ranger toutes ces œuvres dans la littérature, ce qui leur permettra d’éviter les tourments d’avoir à ne pas mentir, ou d’essayer de donner les critères de la différence entre fiction et non-fiction.
Le livre de Frédéric Pouillaude est à cet égard très utile. Il retrace dans le détail ces discussions, avec une connaissance experte de la philosophie et de la critique esthétique. Il réévalue les discussions philosophiques sur la nature de la fiction, en traitant de nombreux médias : photos comme celles de Walker Evans, cinéma, comme celui de Jean Rouch, performances théâtrales narratives ou visuelles, reportages comme De sang-froid de Truman Capote ou L’adversaire d’Emmanuel Carrère, ou textes venant de la « littérature de témoignage », devenue envahissante. Frédéric Pouillaude rejette aussi bien l’idée d’une « transparence » du médium photographique ou filmique que l’idée qu’il n’y ait pas de partage net entre les représentations factuelles et les représentations fictionnelles, ou que le critère de leur distinction soit seulement pragmatique et relatif aux intentions de l’auteur. Pourtant, il soutient que la représentation est « une praxis globale », qui a des composantes sociales et que les œuvres « factuelles » sont à la fois « miroir » et « fenêtre ». Mais il laisse indécise la réponse à la question de savoir jusqu’à quel point elles sont miroir ou fenêtre. S’ensuit-il, demande-t-il en conclusion, que l’on puisse parler de formes d’art « réalistes » au sens ontologique où ce type d’œuvres décriraient une réalité indépendante de la représentation que nous en donnons ? Rien n’est moins sûr, notamment si l’on considère que ce livre, même s’il détaille toutes sortes de sens de la notion de représentation et de ses modes factuels, ne discute pas la notion de vérité, et encore moins celle de fait. Il suggère in fine que, si réalisme il y a, ce serait plutôt un réalisme du type de ceux que proposent des philosophes comme Jocelyn Benoist ou Quentin Meillassoux. Mais voilà qui n’aide guère, comme il l’admet. On ne peut que s’accorder avec lui.
Si l’on entend vraiment tracer une frontière entre fiction et non-fiction, peut-on réellement faire l’économie d’une réhabilitation plus franche des notions de vérité et de référence et d’une ontologie de la fiction ?







![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)
