Le 7 décembre 1941, l’aviation de l’amiral Tôjô détruisait par surprise la flotte américaine à Pearl Harbor, dans l’archipel d’Hawaï. Le 2 septembre 1945, l’empereur Hirohito signait la capitulation du Japon dévasté. 46 mois de guerre qu’allaient suivre dix années d’après-guerre marquées par la pénurie et le deuil, avant que le pays ne commence à émerger péniblement du marasme. Akira Yoshimura (1927-2006) a 14 ans au moment de Pearl Harbor, 18 lors de la défaite, 28 quand le pays se met à espérer un avenir meilleur. Un dîner en bateau rassemble dix de ses nouvelles parues entre 1976 et 1988.
Akira Yoshimura, Un dîner en bateau. Trad. du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, 225 p., 22 €
L’enfance et la jeunesse d’Akira Yoshimura ont été étouffées par la guerre. Au moins sa mauvaise santé lui a-t-elle permis d’échapper à la conscription qui, dans l’atmosphère d’aliénation patriotique de la période des premiers revers (Midway, puis surtout Guadalcanal, dans l’archipel des Salomon, en août 1942 ; il a alors plus de quinze ans, nombre d’élèves et d’étudiants subissent un entraînement militaire brutal et accéléré dès cet âge), préparait une jeunesse plus ou moins fanatisée aux joies du suicide collectif.
Un tel garçon, s’il a été soustrait au pire, a vécu l’après-guerre avec le pénible sentiment de sa propre insuffisance morale, si ce n’est de sa lâcheté, qu’il lit dans le regard des autres. Un tel homme devra toujours et jusqu’à sa mort, à 79 ans, se justifier à ses propres yeux, c’est le sort de la plupart des survivants. Ce qui le sauve, en fin de compte, c’est qu’il est un écrivain, et un écrivain japonais, c’est-à-dire prolifique. Que son œuvre soit entièrement placée sous le signe de la guerre et de ses suites n’est pas pour surprendre.
On reconnaîtra cette emprise dans ces dix excellentes nouvelles, toutes publiées dans des revues littéraires comme il est d’usage au Japon, et reprises ici en traduction fine et élégante dans l’ordre même de leur parution. Elles ne sont nullement misérabilistes, et même pas uniment chargées de tristesse – cette tristesse que Kawabata, qui se suicidera en 1972, quatre ans après avoir été nobélisé, considérait comme constituant la clé du caractère de son peuple, et par conséquent de la littérature nippone.

L’écrivain japonais Akira Yoshimura © Japan Foreign Rights Centre
Ces dix nouvelles, il en est même de presque détendues, sinon enjouées, par exemple l’histoire contée dans « Fumée de charbon ». Elle se déroule durant les derniers mois de la guerre. Tôkyô est en ruines, sous d’incessants raids de superforteresses américaines parties d’Okinawa occupé au début de l’été 1945. La nourriture manque et le rationnement imposé génère un marché noir du riz que des équipes clandestines vont chercher en province pour l’écouler dans la capitale. Les rares trains sont bondés, les groupes de fraudeurs s’organisent en tandems qui empruntent chacun des voies ferrées différentes et espèrent ainsi se soustraire aux contrôles de police.
Expéditions délicates sinon dangereuses car, lorsqu’on est pris, on risque seulement, semble-t-il, de se voir confisquer la marchandise. Épopées dérisoires. Celle dont nous apprenons ici l’issue favorise ironiquement le couple de deux jeunes garçons, les moins doués du lot (dont l’auteur), des bras cassés, tandis que tous les passeurs de riz chevronnés échouent. Le tout, qui évoque une période tragique, est écrit sur le mode réaliste et bénéficie d’une rare acuité dans le coup d’œil. Mais pourtant cela baigne dans une étrange légèreté, comme si le narrateur protagoniste, qui s’exprime à la première personne, observait de haut et de loin, sur les lèvres un demi sourire dépourvu de méchanceté, les tribulations qui furent les siennes. On est à mille lieues du cynisme et de la rage contenue qui imprègnent le chef-d’œuvre de Marcel Aymé La traversée de Paris où sont narrées des misères analogues.
Tel est le ton spécifique de cet ensemble. La maladie et la mort n’y sont jamais à distance du conteur, mais il les entrevoit à travers un certain voile très original. Il s’agit moins de détachement, ou de la faculté zen de considérer en toute chose le fond de néant sur lequel elle s’inscrit, que d’une profonde mélancolie (car c’est affaire dépassée, la plupart des scènes évoquées rappellent au narrateur une malencontreuse jeunesse qui tout de même fut sa jeunesse) et plus encore d’une paradoxale tendresse.
Certains auteurs japonais, et non des moindres (Sôseki Natsumé, le romancier de Kokoro ou Le pauvre cœur des hommes, 1914), disposent de la singulière capacité d’émouvoir sans mièvrerie ni complaisance. Yoshimura est de ceux-là, ce qui rend sa touche infiniment sensible, y compris dans un texte presque toujours au bord des larmes comme « Le mur blanc », dont l’action, peu animée sinon par les mouvements intérieurs de la compassion, trouve place dans l’espace clos d’un hôpital où les cas les plus graves côtoient ceux de patients, comme le narrateur, entrés pour des opérations bénignes.
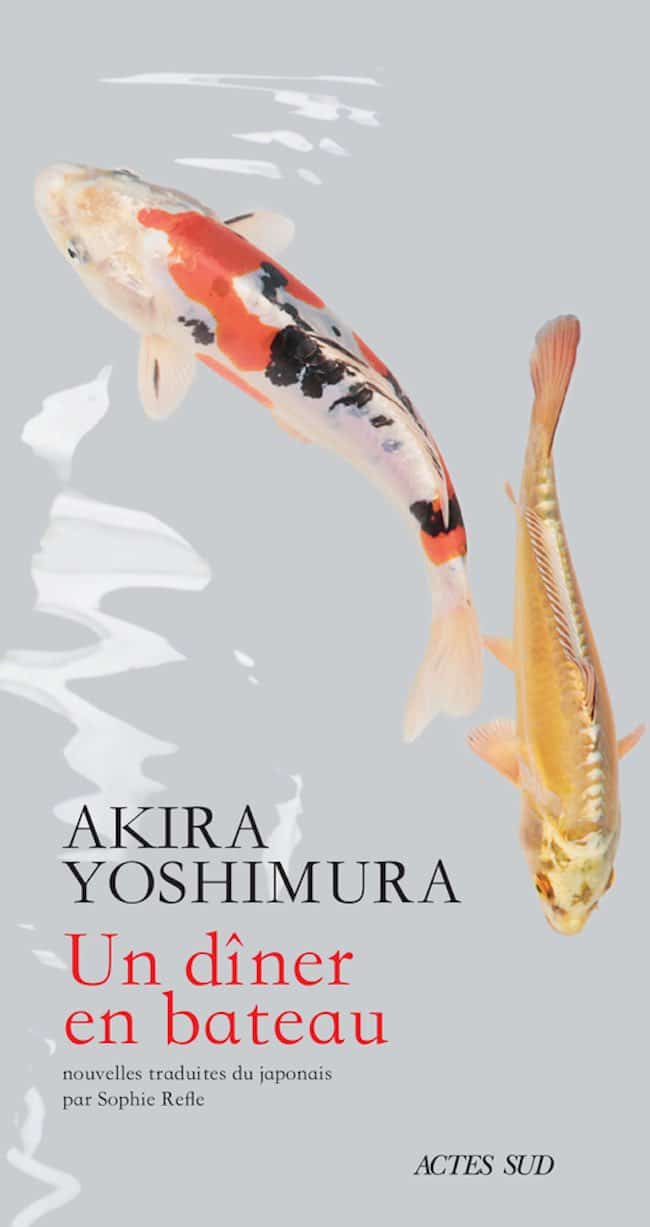
Dans des lieux comme celui-là, bourrés de tant d’occasions de désespérer, le trouble peut être traduit par un incident accessoire, comme la présence d’une mante religieuse piégée derrière une fenêtre et dont on note les mésaventures avec autant d’empathie que s’il s’agissait d’une personne humaine. C’est l’autre qualité de la prose de Yoshimura et elle appartient d’abord à son peuple animiste pour lequel, au fond, tous les vivants se valent.
Le premier texte du recueil peut ainsi commencer par une description précise et d’une justesse picturale, tel un dessin animalier d’Hokusai, des évolutions d’un poisson rouge dans son bocal, ce qui débouche, grâce à un fondu enchaîné qui n’a rien d’artificiel, sur le souvenir que la croyance populaire faisait des poissons rouges un talisman contre les bombardements pendant la guerre et, de là, sur la bombe qui a détruit la maison de l’adolescent dans les épisodes ultimes du conflit.
Petite vignette parfaite qui à son tour introduit d’une manière souple et naturelle un fragment d’autobiographie où l’ancien étudiant maladif se remémore l’humiliant « désir » qu’il a eu « d’éviter l’incorporation » tout en refusant à la fois le mensonge à propos d’un prétendu pacifisme nippon (tout le monde autour de lui pensait que la guerre était juste) et l’autre mensonge, concernant lui-même (pas kamikaze pour deux sous, il ne se sentait aucune vocation au martyre). Ce beau livre sonne vrai, de la seule authenticité qu’on attend d’un artiste, celle de l’écriture.







![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)




