Presque riens, le dernier recueil du poète marocain Abdellatif Laâbi, est un exercice d’introspection poétique, la synthèse d’une expérience personnelle qui s’acharne à défendre la dignité humaine et à opposer au chaos du monde l’éblouissement furtif du poème.
Abdellatif Laâbi, Presque riens. Le Castor Astral, 174 p., 14 €
Celles et ceux qui connaissent la poésie d’Abdellatif Laâbi savent à quel point elle est le fruit tendre et mûr d’une trajectoire personnelle rythmée aussi bien par la brûlure des expériences que par la grâce des mots. Homme des luttes et des déchirements, militant de la gauche marocaine et prisonnier politique des années de plomb, cofondateur et rédacteur en chef de la revue Souffles (1966-1972), auteur de pièces de théâtre et de livres pour la jeunesse, traducteur de poésie arabe et préfacier chevronné, Laâbi est loin d’avoir épuisé le vaste champ de ses créations. Son recueil Presque riens prolonge un exercice d’introspection entamé dans ses derniers écrits. On y retrouve, entre la synthèse des combats passés et l’urgence de ceux à venir, un éloge indéfectible de l’énergie poétique contre la défaite et la frustration.
Dès le premier poème, « Devant le miroir », Abdellatif Laâbi sonde les abîmes de son âme. Après les années des combats ardents, voici le temps de la grande faiblesse, « les ravages / de la vieillesse » et la fuite inexorable des plaisirs, la résurgence des douleurs d’antan et la hantise des fers et des barreaux. Après l’époque des éruptions politiques et des poèmes-cris, voici que sonne l’heure fatidique du retrait et du repli : « Ma rébellion / ne regarde plus que moi ». Inévitable et lancinante, la solitude du poète est « comme un hameçon / qui s’est logé dans la gorge / et avec lequel il faut continuer / à boire et à manger ». Image puissante d’une lutte intérieure dont la seule issue semble être l’éclat discret et éphémère du poème.
Loin du vacarme, Laâbi scrute les dérives du monde avec l’œil d’un observateur aguerri. Il y a dans Presque riens un art de la méditation à la fois apaisée et indocile, une écoute du temps qui glisse pour en saisir les frémissements les plus imperceptibles : « choisir dans l’infime / de ce qui se présente à toi / ce qui mérite d’être scruté / humé / caressé à distance ». Il s’agit de ralentir la course folle du monde, de réhabiliter la voix intérieure, d’opposer au chaos général la promesse d’un « élixir de la bienveillance » ou la chaleur d’« une forêt vierge / d’arbres de la connaissance / du doute / et de l’émerveillement ».
Relisant ce « roman de l’exil » qu’il compose patiemment depuis 1985, année de son installation en France, Abdellatif Laâbi reconnaît « un arrière-goût d’amertume / un goût d’inachevé » que semble prolonger l’échec de ses tentatives de retour au pays natal. De ce Maroc désormais à l’écart, le poète retient néanmoins la géographie de l’intime, à l’image du portrait omniprésent de la mère qui veille sur ses écrits ou du souvenir inaltérable du père « dans son échoppe / d’artisan sellier à Fès ». Loin de se résigner, Laâbi affronte la séparation et cherche de nouvelles issues. À rebours de son époque, il analyse les ressorts de l’optimisme, ce « sport solitaire / sans coéquipiers ni adversaires » et qui « ne vise pas la performance ». Aux côtés de sa bien-aimée Jocelyne, dédicataire du recueil et compagne des années de douleur et de régénération, il s’avoue « sans défense » face à l’amour et, comme pour anticiper « les récifs / de l’autre rive », imagine « une vie de rechange » en Andalousie, sa terre de prédilection.
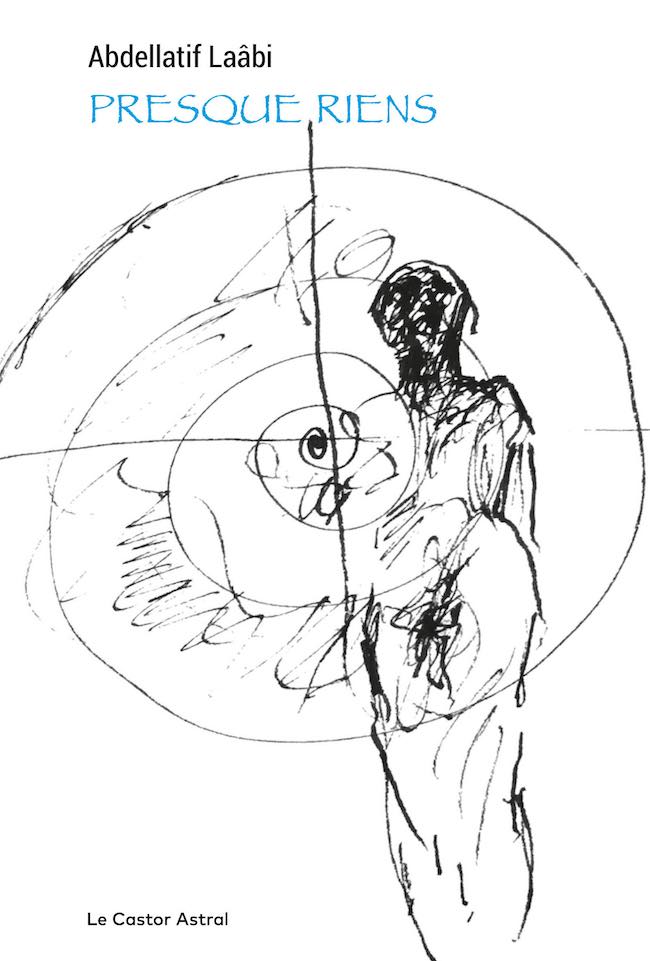
Qu’il décline la liste de ses regrets, tende l’oreille pour saisir les oscillations de l’enfance ou rêve d’une réincarnation dans la peau d’un soufi libre et rebelle, le poète demeure tiraillé entre le sens du devoir accompli et l’expression d’une lassitude mélancolique. Dans un monde livré aux lois de la violence banalisée, le poète interroge sa responsabilité et s’empresse de réclamer un refuge :
« À l’instar des abris anti-aériens
des abris anti-nucléaires
il devrait y avoir
des abris anti-atrocités
anti-désastres
anti-matraquage de discours
de sons et d’images »
La poésie d’Abdellatif Laâbi est attentive à la longue dérive de l’humanité, à l’image de ce constat implacable : « les clichés d’hier / sont devenus / les métaphores d’aujourd’hui ». Devant l’inachevé des révoltes populaires et le déclin des valeurs d’unité et de solidarité, Laâbi continue de chanter « l’appel irrésistible / de la vie à la vie », invitant comme jadis à « réapprendre / les mots de la tendresse / les gestes de l’amour / l’alphabet de la beauté / le bréviaire de la fraternité ». Vaste défi dont son œuvre est à la fois la caisse de résonance et l’incarnation poétique :
« On voudrait recoudre
là où l’humanité s’est déchirée
Mais où trouver le bon fil
et de la bonne couleur
pour ne pas gâcher le travail »
Par la puissance d’évocation de ses vers, Laâbi bouscule les esprits et éveille les consciences. Chaque poème est une opération qui relève du déminage intérieur et de l’assainissement du monde. Cette dimension se traduit plus clairement dans son attention aux équilibres de la nature et à la biodiversité. Au détour des pages, on croise l’hirondelle et la colombe, on admire « la force de la fourmi » et « l’ardeur du papillon », on écoute « religieusement / le bruit de la cascade » et on voit le poète livrer ses confidences à l’arbre millénaire ou entourer de « soins amoureux » les plantes de ses deux balcons. Dans son poème « Disparitions », où il énumère les espèces, les objets et les habitudes en voie d’extinction, Laâbi mentionne « les cent noms qui désignent / l’épée ou le chameau / en langue arabe », comme une manière d’associer la protection des écosystèmes à la préservation des patrimoines linguistiques et culturels.
Fidèle à sa langue espiègle et insoumise, le poète aiguise l’arme miraculeuse de l’ironie, à la fois « empreinte de l’âme » et « sceau de vérité ». Dans le recueil, il vilipende les ennemis de toujours, « solliciteurs sans pitié » ou « médisants de faible envergure », et dénonce la nocivité de ces « politiciens morts-vivants / plus sales / moins utiles / que des serpillières ». En contrepoint de ces figures honnies, les créateurs chers au poète, dont le peintre palestinien Kamal Boullata et l’ami peintre syrien Sakher Farzat, sont autant de « voix fraternelles » ressuscitées au creux du poème. Quand Laâbi parle de « s’absenter / pour rejoindre la présence », on pense à la Présente absence de Mahmoud Darwich, autre signe d’une fraternité introspective et poétique qui prolonge les traductions par le poète marocain de son confrère palestinien.
En août dernier, suite à l’explosion survenue au port de Beyrouth, Laâbi avait initié en compagnie de l’écrivain libanais Issa Makhlouf une pétition, « Que vive le Liban ! », en soutien au pays. Comme un écho à cette solidarité, le poème « La grotte aux pigeons », écrit en 2018 au Liban et dédié à Makhlouf, évoque la visite de Laâbi à Beyrouth dans les années 1970, au temps où les poètes arabes s’employaient à « explorer les confins du rêve » et à « porter, en idée / de sacrés coups / aux bases du vieux monde ».
Entre l’effort d’introspection indissociable du fardeau de l’exil et le travail de remémoration ancré dans ces espaces de lutte et de solidarité collectives, Laâbi écrit « pour désorienter / le fauve du désespoir ». Pour lui, l’écriture poétique reste à la fois une douleur et une jubilation, une perte et une restitution, un égarement et des retrouvailles, une lutte ouverte avec le « satané souci de la trace ».
C’est précisément comme des traces poétiques que se lisent les quatre « textes inclassables », à la fois « libres d’attache » et « proprement insolites », intégrés à la suite des poèmes. Le premier est un fragment théâtral sous forme de dialogue autour de l’innocence et de la haine, de la violence et du rêve. Un échange où resurgissent, comme un écho au recueil, la figure de « l’Arabe errant » cher au poète et la double perspective d’un détachement du monde et d’un retour au lieu matriciel de l’enfance et son odeur « aigre-douce ».
Le deuxième texte est un manifeste en trois parties, écrit entre 2001 et 2011 et publié précédemment sous le titre évocateur « Le cercle des Arabes disparus… et retrouvés », où Laâbi retrace, « sous l’arbre de la mémoire », le parcours de cette génération d’intellectuels et de créateurs arabes, asphyxiés par les guerres et les dictatures mais ressuscités dans le souffle de la jeunesse et de ses révolutions.
Le troisième texte, « Une arche nommée l’Ange Gabriel », écrit à bord d’une péniche à Béthune, prolonge le thème de la vie alternative rêvée par le poète qui se voit désormais en peintre découpant le paysage « en petites planches de théâtre » pour recréer une poésie lumineuse et nomade. Enfin, le quatrième et dernier texte est un poème consacré à Versailles où la rencontre d’un enfant au château sert de prétexte à l’observation sensible d’une humanité polyphonique et rêveuse, portée par « le souffle de l’esprit / et le bruissement des âmes encore errantes ».
S’il faut retenir une image pour décrire l’univers de ces Presque riens, ce serait celle de « l’éblouissement furtif ». Tout au long du recueil, Laâbi cultive une poétique du mineur et de la mesure :
« Pour dire moins
il est recommandé de vivre plus
et ne concevoir
– n’écrire –
qu’en cas de trop-plein »
Rappelant l’activité picturale du poète qui a déjà eu l’occasion d’exposer ses tableaux, cette inclination vers le concis et le vacillant figure à la fois la quête d’une autre forme d’éloquence et un pas de plus vers le « règne magnanime / du silence », par opposition au tumulte du monde. L’épigraphe, empruntée au grand poète arabe du XIe siècle Al Ma’arri, confirme cette dynamique : « l’éternité a parlé avec laconisme / Jusqu’à faire du silence / Le sommet de la concision ». Alternant les murmures poétiques, les allusions subtiles et les éclats brefs et incisifs, les poèmes de Laâbi n’en finissent pas de contrecarrer la violence, l’excès et la confusion. Le dernier poème du recueil, après « Fin », est intitulé « Supplément », comme une manière de repousser un peu plus l’horizon de cette « poésie audible, compréhensible / et transmissible » dont Laâbi maîtrise à la fois la matière et le secret.











