Les éditions Bleu autour, sises à Saint-Pourçain-sur-Sioule, en Auvergne, ont réalisé un bel ouvrage comportant des textes attachants, abondamment illustrés de documents d’époque et de photographies de paysages, de bâtiments de ferme, d’outils et de scènes de travail. Pour nous rendre ce monde encore plus proche, une clé USB en restitue le paysage sonore. Le monde de l’Angle a pour objet quatre générations de paysans-aubergistes installés à la ferme de l’Angle, dans la montagne, non loin du Mont-Dore. Il a été composé par leur voisine d’été, Corinne Legoy, professeure d’histoire contemporaine.
Corinne Legoy, Le monde de l’Angle. Voix paysannes 1915-2020. Avec deux films sonores de Philippe Busser. Préface d’Alain Corbin. Bleu autour, 269 p., 27 €
La première partie est constituée de longs extraits d’un cahier dans lequel l’arrière-grand-père, Blaise Leguay (1897-1972), a raconté les nombreux pèlerinages qu’il a effectués à pied, à travers la montagne, jusqu’à Notre-Dame de Vassivière, dans le Puy-de-Dôme, entre 1915 et 1967. Ces souvenirs, il les a rédigés alors qu’il avait soixante-douze ans, à l’intention de ses enfants. Comme l’indique Alain Corbin dans sa préface, les historiens du peuple n’ont pas pu s’appuyer sur ce type de document : « Ce n’est qu’au XXe siècle qu’une timide écriture de soi s’est manifestée en ces lieux sociaux obscurs. »

Vue aérienne du plateau et de la ferme de l’Angle, du massif du Sancy et du bourg du Mont-Dore (octobre 2019) © Philippe Busser
Le lecteur remarquera sans doute la qualité de la langue malgré quelques options syntaxiques non conformes à la norme. Les phrases sont d’une longueur comparable à celles de Proust, mais on y entend une oralité coutumière de la narration, qui ménage ses effets et accumule les exclamations. Il ne s’agit pas de faire du beau style mais de respecter les règles apprises à l’école élémentaire, y compris dans l’usage du subjonctif imparfait. Le vocabulaire est précis, parfois enrichi de mots d’argot, mis entre guillemets moins pour s’en excuser que pour signaler que l’on a conscience du décrochage du niveau de langue, mais aussi de termes du « patois ». C’est ainsi que tout le monde désignait et désigne souvent encore l’occitan dans ces régions où cette langue était encore d’usage courant au début du XXe siècle. C’est qu’il est des réalités locales que seuls les mots du cru peuvent rendre : la brisse, les galoches ferrées avec des morlas, les rases pleines d’eau, les frissons qui végètent dans ce rude climat… Peu de commentaires sur la langue et aucun sur sa répression à l’école. Une note précise, à propos des pèlerins de Vassivière venus de tous les alentours : « En général, c’est le patois auvergnat qui domine dans les conversations ! Mais comme ce dialecte varie, surtout en prononciation, selon les cantons, la cacophonie est à son comble, car il y a autour de cette chapelle, des convives de différents horizons ! »
Les récits de pèlerinage ont été tant de fois entendus qu’il n’est nul besoin pour les novices, Blaise et son frère, d’étudier le trajet : il est inscrit dans leur mémoire. Ainsi, ils prennent place dans la lignée des ancêtres qui ont emprunté ces mêmes chemins caillouteux, affronté neige, vent et brouillard : « et dans cette subconscience qui s’était emparée de moi […] je voyais en esprit comme s’ils avaient été réellement présents là, beaucoup de ces anciens pèlerins ». Ce premier pèlerinage leur fera parcourir 80 km à pied, en galoches, avec un crochet par le Mont-Dore que son frère voulait visiter. Celui-ci périra un an après, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Nul pathos dans le récit mais, un peu plus loin, on entend sourdre chez Blaise une colère contre l’armée, au moment de sa propre incorporation : « Et il n’y aurait pas à discuter du montant du salaire ni du nombre d’heures de travail, pas plus que du genre de “boulot” qu’il y aurait à faire avec le nouveau patron qui allait employer mes services pendant 3 ans et 9 mois “début janvier 1916 à fin septembre 1919” et cela à raison de 5 centimes par jour ! oui, j’ai bien dit, 5 centimes ! » Et quelle révolte contre la Seconde Guerre mondiale alors qu’ils avaient cru à la victoire en chantant !
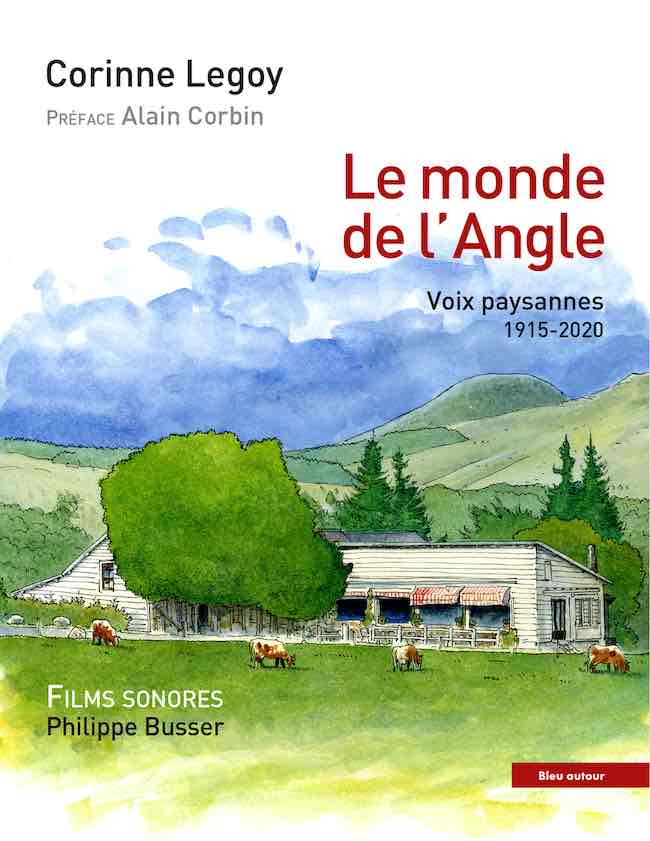
Le récit rapporte aussi des sujets de réflexion : pourquoi ce culte à Notre-Dame de Vassivière, près du Puy de Sancy, alors qu’Orcival détient aussi une statue de la Vierge vénérable ? Et devant l’amas de rochers cyclopéens au lieu-dit les Dents-Bouches : « ça s’est-il fait tout seul ? » Il s’inscrit aussi sur un fond historique qu’illustrent des documents et photos fournis par l’historienne : « complet Clemenceau » pour les démobilisés de 1918, évolution des tenues vestimentaires qui voient la relégation de la longue blouse des hommes et des coiffes des femmes, chansons populaires des années 1930, accidents d’avion ou d’alpinisme, cartes postales, etc. Et le regard est sensible aux paysages : celui que l’on voit du haut du puy de Sancy, celui jadis sillonné de sentiers muletiers désormais envahis par la végétation, « ces superbes points de vue sur les lacs et les chaînes de montagne etc. etc. » Le texte est accompagné de photographies en noir et blanc qui restituent bien le climat rude de la région. Dans sa conclusion, Blaise tire deux leçons de ses cinquante-deux ans de pèlerinage : la force que donne le fait d’avoir triomphé de difficultés d’ascension et l’importance de l’attachement au pays.
Dans la deuxième partie, « Des vies, un lieu, témoignages », on lit les témoignages entremêlés des enfants et des petits-enfants de Blaise ainsi que de sa femme, Anaïs, regroupés par thèmes. L’école, sélective et vexatoire pour tous et toutes. Omniprésence du travail aussi bien à la ferme qu’à l’auberge dès l’enfance. Jeux dans la neige. Un goût de liberté, même s’il faut faire le mur pour aller en boîte. Rester ou partir, travailler avec les parents ou être indépendant ? Plusieurs des cinq enfants de Blaise sont devenus petits commerçants, tous ne pouvant rester à la ferme. Le mode de vie évolue. Le couple des grands-parents, uni en 1957, a vécu avec tous ses enfants dans un logement comprenant une grande cuisine, deux chambres et une salle d’eau. Et l’été, ils quittaient leur chambre pour le grenier, afin de proposer des tables supplémentaires à l’auberge ! Depuis, d’autres bâtiments ont été construits, entourant le buron d’origine.
Tous ont le sentiment d’avoir appris le métier de paysan sur le tas, même ceux qui sont allés dans une école d’agriculture. Ils estiment y avoir juste appris à tenir une comptabilité et à remplir des papiers administratifs. La ferme de l’Angle est isolée mais ses habitants ne le sont pas : le grand-père, Pierre, était du syndicat agricole et du conseil municipal ; son fils a relancé l’élevage de la ferrandaise, la vache locale menacée de disparition, et a fait partie d’une association ayant pour but la formation des agriculteurs en agro-écologie. Avec la plus jeune génération, la production évolue : veaux sous la mère, produits laitiers transformés, pour lesquels il va falloir construire un « laboratoire ». On voit aussi la course aux investissements, l’endettement du monde paysan : « on a travaillé pendant vingt ans pour rembourser », et le regroupement : sur 62 exploitations au Mont-Dore dans les années 1950, il en reste deux. Ces témoignages portent aussi sur le rapport aux animaux. Patrick, l’un des fils de Pierre, regrette que tant des paysans en viennent à « se débarrasser » de leurs bêtes avec soulagement. Devenu berger, il raconte : « Je préfère voir les bêtes étalées dans la montagne à manger paisiblement, qu’elles soient le plus libres possible. C’est ce que j’aime le mieux en fait : voir mon troupeau étalé dans un travers de la montagne… Et si je peux les voir d’en face, j’aime encore mieux que d’être à côté d’elles, parce que tu entends la musique de leur ensonnaillement, tu vois le déplacement de ton troupeau ».

Jean-François Ondet, petit-fils de Blaise Legay (octobre 2019) © Philippe Busser
Ainsi le projet de Corinne Legoy a-t-il pris la forme d’un maillage des témoignages : « Il s’agissait par là, originellement, de mettre en écho les générations – libre à chacun, ensuite, de voir les convergences ou les écarts, de se construire “son” monde de l’Angle », tout en préservant la vivacité de l’oralité. « Ils se lurent aussi, tout simplement, éprouvant ce moment où des récits de soi, de quasi-confidences, assumés sans masque ni anonymat, deviennent des pages vouées à être partagées. » On remercie cette famille et leur amie historienne pour ce partage.
Afin de mieux pénétrer dans ce milieu et sans doute dans un souci archivistique, le livre est accompagné de deux enregistrements sonores de presque une heure chacun, par Philippe Busser. Ce qui surprend d’emblée l’auditeur, c’est la présence sensorielle des voix, des accents, des rires qui restituent la vie. Alternent des passages de lecture du carnet du grand-père par différents membres de sa famille – à lire et à écouter avec sous les yeux une carte d’état-major – et des enregistrements de la vie quotidienne : travail à la ferme ou traque aux sangliers. Jean-François, plutôt réservé, devient intarissable sur cette chasse. On entend les vaches qui beuglent en réponse au salut de leur « patron ». Les petits-enfants, tout jeunes, connaissent déjà le prix d’un veau et les maladies qui menacent ces animaux. Quant aux passages enregistrés en plein air, ils font entrer le vent dans nos oreilles. À écouter en plusieurs fois quand le besoin de vastes espaces se fait sentir.



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)





![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)


