La mémoire des paysans (1653-1788) de Jean-Marc Moriceau fait suite à La mémoire des croquants (1435-1652). Après la fin catastrophique du XVIIe siècle et des famines sans nom, la réalité du XVIIIe siècle est que les conditions se creusent. Le titre choisi par l’historien est très juste, car il s’agit d’abord d’une question liée à la rareté des bonnes récoltes : cela arrive, et c’est signalé, tellement c’est exceptionnel.
Jean-Marc Moriceau, La mémoire des paysans. Chroniques de la France des campagnes (1653-1788). Tallandier, 736 p., 29,50 €
Il y a aussi les loups enragés et les terribles catastrophes, les blocs de grêle qui hachent la récolte, la glace qui paralyse tout, et d’abord les moulins quand les hivers durent trop, ce qui engendre immédiatement la cherté par manque de farine disponible. On est heureux alors d’avoir quelques maîtres Cornille en leur moulin à vent ; sinon, on doit moudre la farine à bras. On regarde donc les saisons, on espère les récoltes et on fait chronique selon un tempo qui fait que le bon est escompté mais que le pire n’est jamais une surprise ; les deux font date.
Il ne s’agit pas ici de méditer le « retour des campagnes » réinvesties par temps de covid, mais de se livrer à la chasse à l’information qui intéressera chacun d’entre nous, pour tel lieu qui apparaît soudain, ou telle condition entrevue. On se réjouit avec l’agriculteur qui a réussi et se montre en habit moiré à la veille de la Révolution. C’est le laboureur de Greuze, le fermier du nord de la Beauce en la personne de Germain Petit, devenu rentier par sa stratégie d’acquisition de terres. Ses armoires sont pleines d’assiettes de faïence et de pièces d’argent. Tel autre accumule des sacs d’or et d’écus, mais il ne s’agit que d’exceptions, même au sein de la dernière partie, titrée « Espoirs et mutations ». Au hasard des inventaires après décès, on sait le vêtement et l’outillage de chacun.
Les index des lieux et des noms, le récapitulatif des intertitres, permettent à chacun de satisfaire sa curiosité. Le médecin de Monclar d’Agenais cite en 1780 trois villages pour dire que la dysenterie y fait mourir en masse une population bien trop pauvre pour se soigner. Près de Redon, des Moriceau sont de petits exploitants qui multiplient acquisitions et activités, un autre se fait prendre en faux saulnier. Il y a la guerre des farines en 1775, la crainte de voir les réserves partir vers d’autres provinces alors que la doctrine d’État consiste à penser que la libre circulation régulera les marchés. Mais, en même temps, la variole tue jusqu’à 20 % des enfants dans l’Orléanais et de violentes épizooties déciment le cheptel de Béarn en Gascogne. Le lecteur étaye tout cela de ce qu’il sait ou a su, et il peut déconstruire la longue durée des peurs, les sourdes raisons de l’angoisse panique ou du ressentiment.

« Un laboureur et son troupeau » de Paulus Potter (1648)
Ce plaisir de l’archive est tout intellectuel et d’imagination, il est portatif et agréablement détaché du fétichisme de l’écriture-source. À d’autres les lenteurs du déchiffrement et des collectes, mais à chacun le plaisir et l’effort de sens à donner à ces abrégés de drame. L’ensemble n’a nulle prétention à être exhaustif, ni la possibilité d’y parvenir. Il est varié, malgré le poids des pays d’oïl, mais quelques constantes reviennent. Le début de la période montre une société ravagée par les intempéries et les guerres ; la survie donne ensuite l’obligation à chacun de préciser l’organisation de ses coutumes, à chaque métier ou fonction ses exigences, ses devoirs, « morosité et incertitudes », dit Jean-Marc Moriceau. Le XVIIIe siècle, habituellement présenté comme le moment d’un take off, reste perturbé par les heurs et malheurs météorologiques, qui sont la grosse affaire. Lors des hivers longs et froids, les plus misérables, même en période de moindres pénuries, peuvent mourir de froid autant que de faim.
Il y a alors des révoltes et des bandes d’hommes jeunes, avec toujours quelque ancien soldat à la clé. Les hordes de mendiants existent dans les années 1770 en Bretagne et ailleurs ; ils ravagent et convergent vers les villes, soit pour négocier leurs rapines (surtout du bois), soit pour espérer du secours. Quand des bandes de pillards sont prises, la répression est sévère. Contre une bande de deux cents errants qui a sévi en Gâtinais et en Berry, en 1782, 70 sont exécutés et mis au pilori sans susciter ni geste ni gloire historiographique.
La défiance des autorités est forte envers les démunis. Seuls ceux qui peuvent répondre (financièrement) de leurs actes auront le droit de porter des armes à feu, dans un temps où l’on s’alarme encore fort des loups, les bêtes les plus féroces entraînant des mythologies. On les voit en tigres ou en monstres inconnus, on les croit incarnations diaboliques, mais ils sont enragés et la défiance accompagne les victimes, qui ont perdu face humaine. On aimerait se débarrasser au plus vite de ces morts-vivants, et tant pis pour la compassion ou l’humanité due aux mourants. On sait bien qu’il faut enterrer au plus vite les bêtes blessées, avant même de savoir si elles sont contaminées.
Certaines régions produisent des travailleurs saisonniers qui vont à la ville, comme les Auvergnats porteurs d’eau. Ils meurent parfois en chemin, plus d’épuisement que de mauvaises rencontres. Les scieurs de long du Velay réussissent parfois et s’établissent comme gendres tandis que les régions qu’ils quittent, ainsi que les colporteurs, déplorent la perte de ces forces vives qui ne reviendront pas, car la ville les « libertise » ; en revanche, ceux qui partent vers le Languedoc et gardent des activités hivernales rurales reviennent pour les travaux d’été.
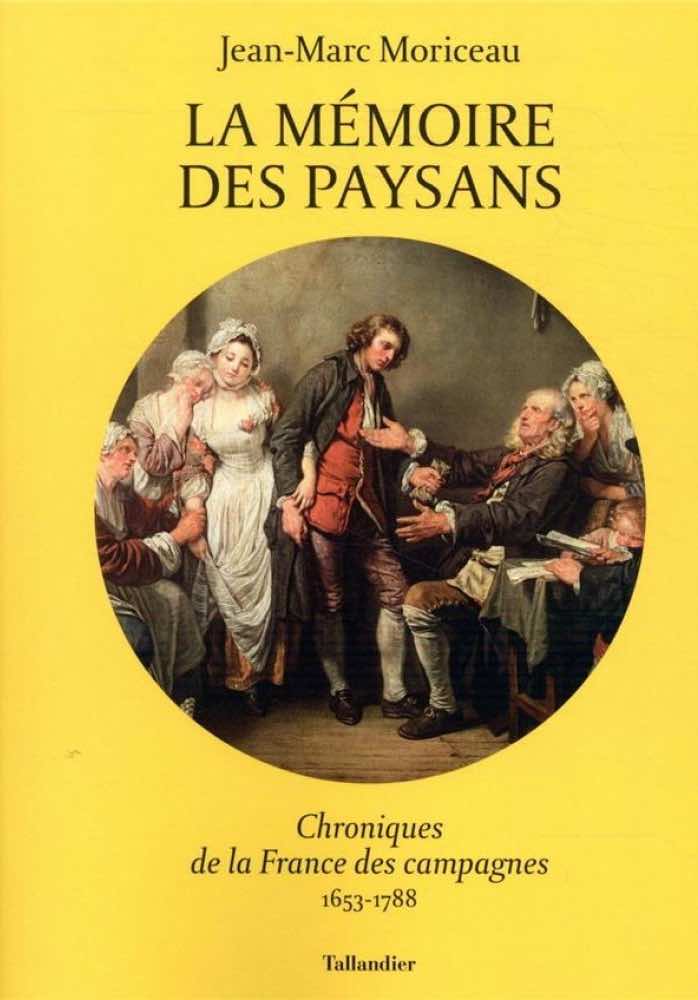
La vie précaire engendre des mouvements durs. Le fermier essaie d’imposer le travail de la moisson à la faux, mais avec les espèces anciennes de blé qui ne mûrissent que tard, en août, et qui ont de hautes tiges, on « scie », on travaille traditionnellement à la faucille. La lutte des moissonneurs pour être correctement payé multiplie les émeutes, les « baccanals » de la région parisienne ; ailleurs, dans le Tarn ou le Comminges, on s’arme contre les dîmes, parfois contre leur doublement ou toute nouvelle interdiction. Les hommes noircissent leur figure ou portent des masques, la communauté sort en « demoiselles » avec de longues chemises par-dessus leurs culottes. On sait combien les règlements forestiers de 1827 relanceront ces pratiques sous Louis-Philippe, particulièrement dans les Pyrénées.
Ces bribes de chroniques n’ont rien d’une litanie du même, à opposer aux créations discursives de la ville. Les campagnes qui ne démarrent pas ne sont pas que l’objet d’un prélèvement fiscal immémorial, ce sont des lieux en mutation, des lieux de contradiction. Cela nous interroge en permanence sur ce « pays réel » de la nation, car c’est ce monde vécu qui va devenir l’arrière-pays de la Révolution française. Le grand mouvement tient à l’émergence du libéralisme agraire après 1766 et à la tentative de reconquérir des terres non labourées qui seront dispensées de droits pendant une vingtaine d’années. Or ces terres servaient aux communautés et l’usage n’en est pas le même si elles sont octroyées aux « feux » de résidents et de forains. Leur disparition pénalise ceux qui n’ont que quelques bêtes et ces pauvres-là ne veulent pas perdre des pâtis ou de nouveaux droits. Les seuls cas où l’affaire se passe sans douleur concernent des collectivités qui n’en ont guère besoin ; sinon, les communautés protestent, et perdent.
Dans les archives, une grande variété d’observateurs, qui pour certains ont commencé très jeunes, à douze ans, consignent d’abord dans ce qui s’apparente à des livres de raison les faits climatiques saillants, d’où découle une idée du quotidien. Le regard multiple de personnes qui ne sont pas de vrais notables, mais bien souvent des curés, et des plus démunis, parfois des médecins, laisse entrevoir qu’il y aura encore mille choses à sortir des suppléments « E » des archives communales versés aux archives départementales. Ces enquêtes sont en cours. L’inventaire en est fait en Gironde, une partie est en ligne ; aussi voit-on souvent apparaître les « Observations » du curé du Puy, petite paroisse de l’Entre-deux-Mers. Certes, ces gens qui savent écrire et veulent témoigner pratiquent un français parfois approximatif, mais, si l’on n’est pas dans l’ordre de l’oralité du quotidien, car les langues minoritaires ne sont pas là, on en saisit l’écho.
Ces relevés donnent la rumeur des temps, le commentaire des jours, et cela rend concret cet abîme de ce qui appartient à nos oublis car on l’a ainsi construit : c’est tellement prosaïque. Or, c’est bien de ces faits supposés minuscules, mais colligés en masse, que découlent les sagas, telles des séries à personnages avec lieux récurrents. En somme, l’archéologie des romans à venir de nos sociétés.












