Hypermondes (13)
Écrivains parmi les plus importants de la science-fiction actuelle, Peter Watts et Ted Chiang sont relativement rares. Surtout le second, dont Expiration n’est, en vingt-cinq ans, que le deuxième livre publié. Ils partagent une grande exigence d’écriture avec l’appartenance au courant de la hard science, qui fonde sa vraisemblance sur les dernières avancées scientifiques. Science à laquelle ils font appel dans les nouvelles d’Expiration et dans le court roman Eriophora, pour scruter nos relations futures à l’intelligence artificielle, mais aussi certaines problématiques contemporaines – l’aliénation douce au travail, la dilapidation de l’énergie – ou intemporelles : l’éducation et le libre arbitre.
Ted Chiang, Expiration. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Théophile Sersiron. Denoël, 464 p., 23 €
Peter Watts, Eriophora. Trad. de l’anglais (Canada) par Gilles Goullet. Le Bélial’, 224 p., 18,90 €
La lecture successive des nouvelles d’Expiration donne le vertige. Un vertige léger, aux limites de la conscience. Comme si l’on avançait sur un sentier forestier pour finir par s’apercevoir qu’on n’est séparé d’un horizon immense que par un simple rideau d’arbres. Sans avoir l’air d’y toucher, dans un style aussi précis que simple en apparence, Ted Chiang trouve à une idée, à un questionnement, un équivalent concret : une invention, une machine fabuleuse, qui lui permettra de le faire tourner et d’en représenter, calmement mais en profondeur, les implications. Comme il est aussi un conteur, on suit ses textes pour les histoires qu’ils sont, avant que leurs perspectives ne se dévoilent petit à petit selon un tempo parfaitement maîtrisé.
Issue de son premier recueil, La tour de Babylone (traduit aux éditions Denoël en 2006), la nouvelle « L’histoire de ta vie » a servi de base au film Premier contact, de Denis Villeneuve. De la même manière, dans Expiration, « La nurse automatique brevetée de Dacey » pourrait être adaptée en long métrage : en seulement seize pages, elle concentre trois générations de vies mélancoliques et poignantes. Si Ted Chiang publie aussi peu, on devine que c’est parce qu’il polit ses récits jusqu’à ce qu’ils aient la force et l’équilibre de classiques instantanés. Au cœur de « La nurse automatique brevetée de Dacey », une question simple – un enfant peut-il être élevé par une machine ? – en contient, comme souvent chez lui, une infiniment plus étendue – quelle part l’attachement affectif prend-il à la formation d’un être ?
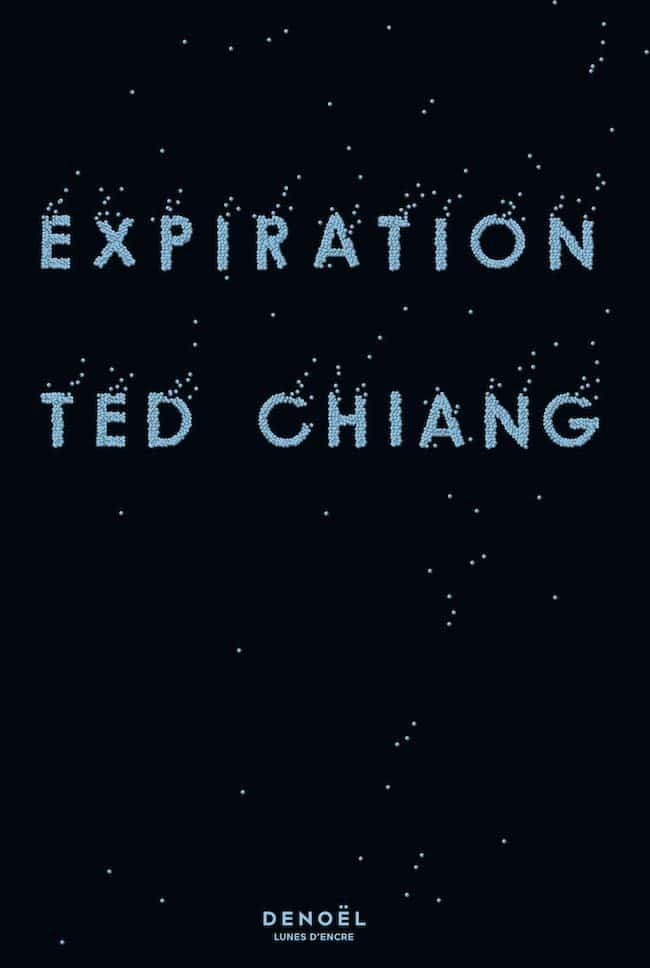
Sous une forme plus développée, « Le cycle de vie des objets logiciels » inverse la proposition fictionnelle : des êtres humains élèvent et s’attachent à des formes de vie artificielles. Se mêle alors à l’éducation la question du libre arbitre, qu’on retrouve dans la très courte « Ce qu’on attend de nous » aussi bien que dans la longue et remarquable novella « L’angoisse est le vertige de la liberté ». De même que Liu Cixin, dans Le problème à trois corps, espionnait à distance une autre planète, ou que Ken Liu observait le passé dans L’homme qui mit fin à l’histoire, Ted Chiang imagine que la physique quantique nous donne un aperçu sur d’autres lignes temporelles où d’autres nous-mêmes auraient fait des choix légèrement différents. Empruntant la forme des Mille et Une Nuits, « Le marchand et la porte de l’alchimiste » renouvelle le voyage dans le temps, d’une manière rendue vraisemblable par la physique contemporaine, mais seulement cette fois pour imaginer ce que cela changerait de revoir le passé sous un jour différent. Une autre façon de réfléchir au sens de notre existence et aux conséquences de nos actes.
Parallèlement aux questions de l’éducation et de l’affection, « La vérité du fait, la vérité de la mémoire » s’intéresse à ce que pourrait être une mémoire totale, grâce à l’enregistrement permanent de nos vies et à des moteurs de recherche quasi instantanés (Google nous y amène presque aujourd’hui). « Le grand silence » traite de l’extinction des espèces ; « Expiration » de l’entropie, sous une forme métaphorique : un monde steampunk s’éteint par dilapidation de l’énergie. S’y ajoute la belle représentation de la pensée sous forme de circulation d’air, de mouvements. Le monde se meurt parce que les pensées ralentissent, se figent. On voit bien en quoi cette idée peut doublement nous intéresser.
Le ton d’« Omphalos » change radicalement, puisque y est décrit un univers conforme aux croyances créationnistes. Un univers réellement vieux de 8 912 ans, où science et religion se confondent. Mais il est rassurant de constater que, même dans un tel monde, Ted Chiang démontre que l’hypothèse créationniste ne fonctionne pas. C’est là un bon exemple de la force de ses créations littéraires : une histoire claire et simple développe en même temps que l’intrigue une démarche intellectuelle rigoureuse. La puissance de ces textes est lente, calme, progressive, mais ils nous poussent à la réflexion sur des questions morales. Si la lecture en est parfois exigeante à cause des concepts scientifiques mobilisés, ils nous rendent potentiellement plus intelligents et plus justes. Meilleurs. Ce que recherchent aussi pour eux-mêmes les personnages principaux d’Expiration, souvent des femmes.
Peter Watts arrive à peu près au même résultat par d’autres moyens. Dense, elliptique, brusque, baroque, son écriture est aux antipodes de celle de Ted Chiang. Eriophora est un space opera étiré dans le temps et l’espace à la démesure de la galaxie. Pourtant, comme dans Vision aveugle et Échopraxie, les autres romans spatiaux de Watts, c’est essentiellement un huis clos circonscrit à un vaisseau entouré de vide. Cela dit, l’Eriophora bénéficie de dimensions colossales : plusieurs dizaines de kilomètres pour un vaisseau-astéroïde propulsé par un mini-trou noir, ce qui affecte fortement son environnement intérieur. On peut s’y perdre ; on ne peut le connaître tout entier.
L’Eriophora construit à travers l’espace des portails pour permettre à l’humanité future de s’y déplacer quasi instantanément. Mais son voyage est si long – soixante-six millions d’années – qu’il se retrouve au début de la novella dans le passé de l’humanité, sans certitude qu’elle existe encore. Pour passer tout ce temps, ses trente mille membres d’équipage restent en hibernation. L’Intelligence Artificielle limitée qui dirige le vaisseau, le « Chimp », n’en réveille quelques-uns que si se présente un problème qu’il ne peut résoudre seul.

De chaque portail achevé, ces voyageurs au long cours espèrent que sortira l’humanité future pour leur dire que la mission est achevée, qu’ils rentrent à la maison. Mais les portails restent vides, ou parfois en jaillit un « démon », pas ou plus humain. La mission n’a pas de fin. Se pose alors la question de l’absurdité de l’existence de ceux qui, pour certains, commencent à se voir comme des travailleurs exploités, sacrifiés.
Eriophora raconte cette histoire d’aliénation molle. Les navigants sont persuadés du bien-fondé de leur mission, on les a éduqués comme ça. Le Chimp n’est pas un dictateur. Il écoute les humains et ne leur veut pas de mal, mais il contrôle et surveille à hauteur de son omniprésence. Faut-il alors se révolter pour reconquérir sa liberté, ou préserver des existences limitées et ce qui a déjà été accompli ? À ce dilemme sont soumis Sunday, la narratrice, et ses collègues.
Comme souvent chez Peter Watts, on évolue dans un univers sombre. Au centre du vaisseau pousse une forêt modifiée aussi obscure que l’océan de Starfish ou les petits vaisseaux hantés par un vampire dans Vision aveugle et Échopraxie. Les problèmes de la dissimulation, de l’accaparement de la connaissance, sont capitaux. Que sait exactement l’autre, adversaire et en même temps partenaire, voire ami, si une telle catégorie existe ? Que cache-t-il ? Comment lui cacher ce qu’on sait ? Chez Peter Watts, on ignore qui regarde, aussi dans Eriophora trouve-t-on de nombreux codes ; le lecteur devra en décrypter un patiemment pour découvrir le texte dissimulé sous le texte.
Cette épopée paranoïaque avait commencé par trois nouvelles, qu’on peut lire dans le recueil Au-delà du gouffre. On y trouvait déjà, contrebalançant la fatalité glacée, la force des liens et de l’empathie. Les relations entre Sunday et le Chimp, entre Sunday et Lian, qu’elle finira par appeler son « amie », ont la finesse et la délicatesse des cryptages qu’invente l’équipage de l’Eriophora. En outre, chez Peter Watts on ne se résigne jamais. On se bat jusqu’au bout.
Dans des styles très différents, Ted Chiang et Peter Watts inventent des fictions dont la force narrative repose sur des extrapolations rigoureuses, mais pour examiner des questions qui nous préoccupent aujourd’hui, et, toujours, la dentelle fragile des rapports affectifs. Humains ou assimilés.












