Depuis la fin du XVIIIe siècle, et l’éloignement relatif sur scène de leurs gloires tutélaires, les théâtres soumis aux stéthoscopes de Diafoirus de plus en plus stridents souffriraient d’une décadence fatale. Crise des théâtres, comme on dirait crise de nerfs : la maladie est d’abord mentale, démontre avec brio Pascale Goetschel, un large éventail de documents à l’appui. Les discours sur la maladie du théâtre servent de fil conducteur à une étude des théories politiques, sociales et littéraires qu’ils articulent. On ressort de cette traversée des siècles admiratif, un peu étourdi par l’ampleur et la minutie de l’enquête fournie par cette autre histoire du théâtre.
Pascale Goetschel, Une autre histoire du théâtre. Discours de crise et pratiques spectaculaires. CNRS Éditions, 407 p., 27 €
L’essor de la presse au cours du XIXe siècle joue un rôle majeur dans la promotion des théories de la décadence, alors même que le public se bouscule aux guichets. Journaux et revues se multiplient, et offrent l’occasion de se forger une réputation d’intellectuels aux nombreux détracteurs de la scène, auteurs qui peinent à se faire jouer, professionnels du spectacle qui veulent faire pression sur l’opinion pour obtenir des réformes. Avec cette spécialité des tribuns français de tout temps, une foule de plaintes et de diagnostics contradictoires s’expriment dans les nouveaux supports – trop ou pas assez de théâtres, de censure morale, de formes de spectacles.
Parmi les principaux accusés, les directeurs de salles, le système du privilège, le prix des places trop haut ou trop bas, le droit des pauvres perçu sur les recettes, le mélange des genres. À la suite de Victor Hugo, nombre de critiques et d’auteurs prêchent pour faire du théâtre un lieu d’éducation politique, morale et artistique du peuple, d’autres redoutent son avilissement. La querelle des Anciens et des Modernes se rejoue sur tous les tons, à toutes les époques. D’aucuns se plaignent d’une surabondance d’œuvres nouvelles telle que les malheureux critiques ne savent plus où donner de la tête, tandis que pour d’autres la pauvreté de la production nationale explique la prolifération d’auteurs étrangers sur nos planches.
À voir la liste des intrus, à côté d’innombrables noms français tombés dans l’oubli, l’ouverture « de la géante porte shakespearienne », puis le succès des Ibsen, Strindberg, Maeterlinck, Tolstoï, Ostrowski, Shaw, Wilde, Hauptmann, donnent à penser que ce public parisien tant décrié n’avait pas si mauvais goût. L’ouverture aux « âmes polaires » et autres porteurs de brumes nordiques est autant dénoncée que l’ouverture à la variété des genres, la multiplication des divertissements concurrents, cafés-concerts, spectacles sportifs, music-hall, cirque, au détriment des arts nobles nationaux, la tragédie et la comédie.

© Jean-Luc Bertini
Si les causes du mal varient selon les époques, la continuité argumentative est frappante. Les années d’avant-guerre allongent la liste des topoi – essor pernicieux de la démocratie, maladie intellectuelle du public, directeurs démagogues assoiffés de profit qui servent les goûts d’une foule inculte et obscène. Désignée à l’époque comme « le gros public », cette foule « sait désormais qu’elle ne dépend plus que d’elle-même et a des mœurs de souveraineté absolue », écrit Alfred Capus dans Le Figaro en 1912.
Le paroxysme est atteint dans L’Action française sous la plume assassine d’un Léon Daudet inspiré par les thèses d’Édouard Drumont. Les deux extrêmes de l’échiquier politique partagent le diagnostic de crise : « En ce sens, le théâtre constitue une bonne illustration de la crainte, réactionnaire ou révolutionnaire, exprimée face au déclin de la civilisation occidentale ». L’anti-modernité « allie pêle-mêle anti-républicanisme, antisémitisme, xénophobie, dénonciation de l’affairisme, anti-parisianisme… ». Ironie suprême, souligne Pascale Goetschel, ces écrivains pourfendeurs de tout bord sont eux-mêmes des hommes de théâtre et font partie de cette bourgeoisie urbaine, lettrée, parisienne, qu’ils dénoncent.
Avec la déclaration de guerre, la crise fantasmée devient réelle. En trois jours, fin juillet 1914, les recettes de la Comédie-Française chutent de 4 000 à 820 francs, puis à 250 le soir de la mobilisation générale. Les théâtres ferment, le personnel part sous les drapeaux, mais, dès mi-novembre, la profession réclame la réouverture des salles et s’organise, auteurs et acteurs acceptent une réduction de leurs émoluments, le spectacle continue malgré le couvre-feu et une succession de fermetures temporaires. Après deux années de fléchissement, les recettes et la production remontent au-dessus des niveaux d’avant-guerre. Le répertoire multiplie les œuvres édifiantes et patriotiques. Les journaux citent en exemple le modèle de Londres où les salles restent ouvertes après le cent trentième raid de l’aviation allemande. Aller au théâtre devient un acte de résistance contre l’ennemi.
Situation d’exception, la guerre marque aussi le retour de la censure, qui passe du ministère de l’Intérieur à la préfecture de police, donnant au préfet « le droit d’interdire toute pièce de théâtre ou toute chanson de café-concert qui ferait l’apologie du crime, de l’antipatriotisme, ou qui serait un outrage public à la pudeur ». En 1916, les tenues de soirée, jugées trop excentriques et coûteuses, doivent être remplacées par des tenues de ville. La sobriété est de mise, l’innovation esthétique sur scène à peu près absente. Autre signe de ce temps de suspens exceptionnel, après avoir bataillé depuis des générations contre le droit des pauvres, le monde du spectacle donne des représentations de bienfaisance, et affecte une part importante des recettes à des œuvres de secours ou de solidarité nationale. Les ateliers de la Comédie-Française confectionnent des vêtements pour les soldats. La victoire sera célébrée dans les salles aux accents de La Marseillaise, de La Brabançonne, des hymnes anglais et américains.
Cependant, les « discours de crise » se poursuivent, sous la plume d’académiciens, auteurs, journalistes, qui, au-delà de leurs divergences, ont le souci d’« affirmer le rôle du théâtre français dans la destinée de la nation au XXe siècle ». On retrouve là encore un avatar de ce « douloureux sentiment du déclin national » éprouvé à la fin du XVIIIe, qui semble durablement inscrit dans nos gènes, la nostalgie du temps où la France dictait mœurs et goûts littéraires à toute l’Europe. À en croire l’auteur et critique Edmond Sée, « public, directeurs, auteurs semblent depuis le début des hostilités, collaborer en vue de l’anéantissement d’une forme d’art où nous étions hier encore inimitables, invincibles » et pour laquelle « sur un autre théâtre on lutte, on combat et on meurt ! » Ibsen et les auteurs allemands sont mis à l’index. Droite et gauche font le procès de la dégradation morale du théâtre avec des arguments identiques, affirme Goetschel. Cela dit, ses citations font une place beaucoup plus large aux récriminations des milieux maurrassiens, nationalistes, catholiques, qui dénoncent « l’erreur démocratique » qu’à leurs opposants. La suppression de la censure a encouragé l’immoralité. Les espoirs d’en finir avec le théâtre juif, boche, mercantile, immoral, antinational, se fondent sur l’idée d’une histoire cyclique : âge d’or, rupture féconde et renouveau.
Au cours des années 1920, le conflit oppose par voie de presse une vision optimiste encouragée par un mouvement réformateur – Vieux-Colombier, Théâtre des Arts, Cartel, Théâtre des jeunes auteurs – à une vision déplorant le manque de renouvellement du répertoire et l’absence d’avant-garde, plaintes que Jacques Copeau rejette avec vigueur, car il ne cesse de solliciter les écrivains, confirmés ou inconnus : « Et ces hommes de l’avenir, je leur tiens leur place chaude et propre en jouant les chefs-d’œuvre du passé. » La rénovation de l’art dramatique s’inscrit dans un mouvement mondial, explique Gaston Baty, dynamique qui permettra au théâtre français de se relever. Fait inédit, Adolphe Aderer ouvre une enquête dans Le Temps pour donner la parole aux spectateurs, qui reformulent d’anciens griefs. La soirée au théâtre est un parcours du combattant : attentes interminables, cherté des places, trafic des billets, taxes, contrôles, mendicité des ouvreuses, strapontins sonores, entractes interminables, inconfort et vétusté des salles. Même si l’augmentation du prix des places et des services reste inférieure à celle du coût de la vie, ce ressenti est fréquent chez des Français habitués à la stabilité monétaire d’avant-guerre. Le secteur théâtral garde sa vitalité malgré la concurrence du cinéma et de la radio. Une comparaison avec la forte expansion américaine n’indique qu’un faible écart entre Paris et New York.
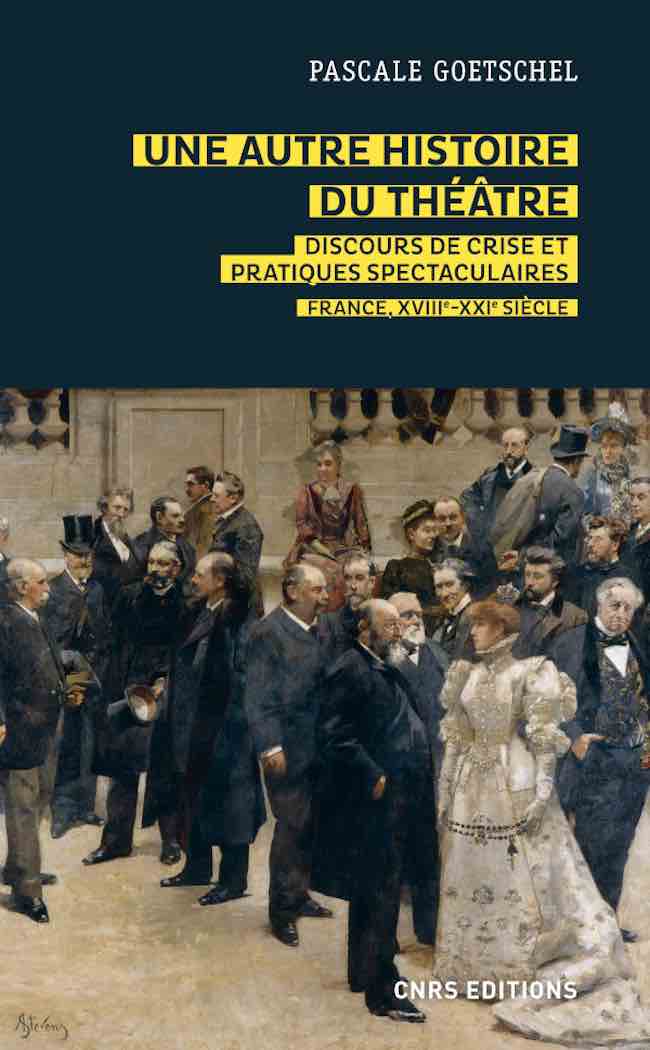
Avec une constance remarquable, chaque évolution sociétale, chaque transformation du paysage urbain, chaque mutation de la scène est perçue comme une menace. Le théâtre est accusé de se faire promoteur de modes, vestimentaires ou autres, dictées par les actrices qui s’intègrent désormais à la bourgeoisie. Malgré la prospérité financière du secteur, les discours alarmistes continuent, les mêmes avec quelques variantes : standardisation industrielle, mercantilisme, absence de nouveautés, modes américaines, invasion de l’étranger, dont le masque peut cacher un juif. D’aucuns font valoir que l’attraction de la France peut rendre à un Paris cosmopolite son rôle de Ville Lumière, mais dans nombre de discours la xénophobie l’emporte. Au cours des années 1930, les rapports et les recherches de solutions à la « crise » se multiplient, tandis que divers auteurs rejouent sur scène le réquisitoire ou la défense de l’art dramatique.
Aux menaces fantasmées s’ajoutent alors des difficultés réelles. En une décennie, le nombre de représentations baisse de plus d’un tiers, des salles ferment ou se reconvertissent en cinémas. Les unions syndicales se font l’écho des discours de crise, dénoncent l’indifférence des pouvoirs publics, organisent des états généraux du théâtre, rédigent des projets de statuts de la profession. Journaux et revues spécialisées, Comœdia en tête, prennent part aux combats, et annoncent la mort du théâtre français, « une vieille connaissance », souligne avec ironie Marcel Achard. Dans les quotidiens politiques, à un bout de l’éventail on dénonce le luxe des mises en scène, à l’autre la dégradation des mœurs. L’art dramatique est un terrain de choix pour les polémistes de tout bord prompts à y détecter le déclin de la société française. Chant du cygne de Comœdia, une enquête de l’été 1936 rassemble les grands noms du théâtre de l’époque, écrivains, metteurs en scène, scénographes, compositeurs, qui appellent de leurs vœux une communion entre élite et peuple, un théâtre populaire sans être vulgaire, capable de concilier préoccupations sociales et exigences artistiques.
L’histoire des discours de crise est aussi une histoire des relations avec l’État, sollicité comme régulateur, censeur ou providence. Une ribambelle de comités, conseils, unions, commissions, associations s’appliquent à organiser le secteur du spectacle. L’État est sommé de remédier aux déficiences des municipalités, trop enclines à transformer les théâtres en salles de cinéma. Le débat continue d’articuler destin du théâtre et avenir de la France, mais les demandes se font plus prosaïques, administratives et financières. Avec la victoire du Front populaire, les rapports et projets de réforme affluent sur le bureau de Jean Zay : lutte contre le chômage, le machinisme, l’embourgeoisement du théâtre populaire, pour la décentralisation et la constitution de troupes régionales, la défense des arts du spectacle, le rayonnement de la France dans les compétitions internationales.
Situation paradoxale sous Vichy, la rupture avec l’idéal démocratique et la législation antisémite ne semblent pas affecter des luttes engagées de longue date contre le chômage des artistes, l’affairisme au théâtre et le déclin de la qualité artistique, conformes aux leçons du Cartel, avant d’être reprises à la Libération par ce programme : « Donner le pas à l’art dramatique sur le simple commerce du spectacle, l’organiser en province, le développer à l’étranger. » Cohabitation et compromis qui mériteraient une analyse plus approfondie, mais, après la première moitié du XIXe siècle qui constitue l’essentiel de l’étude, le rythme de l’enquête s’accélère. Si riche déjà qu’on hésite à formuler des regrets comme l’absence d’index, ou l’atomisation de la bibliographie en une vingtaine de rubriques. Pour la IVe République, la régénération nationale passe par la culture. Les centres dramatiques provinciaux, les maisons de la culture, les théâtres de création fleurissent, la crise est désormais passée du côté du secteur privé. Côté public, la crise du personnage qui domine la dramaturgie des années 1950 serait le prolongement du discours de crise et le moteur d’une révolution des formes.
Les dernières pages brossent un tableau rapide et dense – il y faudra plusieurs volumes supplémentaires – de la contestation culturelle hétérogène amorcée dès avant 1968, déployée ensuite dans des espaces imprévus, dans des créations collectives qui pratiquent le métissage des arts, dans des écritures dramatiques nouvelles, tandis que se développe un nouveau secteur de recherche universitaire, les études théâtrales. De la crise, le théâtre « a fait scène, enseignement, théorisation ». Les intermittents du spectacle prennent le relai, déplacent les enjeux mais continuent à peser sur les décisions politiques. L’actuelle crise sanitaire réactualise les discours anciens, déploration, occasion d’inventer des formes de jeu alternatives, appels pressants aux pouvoirs publics. Encore une fois, les questions, argumentaires, pratiques innovantes, « n’hésitent pas à lier richesse du monde du spectacle et singularité française », associant depuis l’origine « un vif pessimisme culturel et un fort volontarisme mobilisateur », comme le montre avec talent cette autre histoire du théâtre.












