« No bullshit marxism » : telle était la devise du cercle d’intellectuels américains auquel appartenait le sociologue Erik Olin Wright (1947-2019). Elle s’applique parfaitement à cette synthèse socialiste et programmatique. Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle ne réclame pas un bagage quelconque, ne s’égare pas dans des querelles de spécialistes et, surtout, ne s’amuse pas en jongleries verbales et conceptuelles visant à impressionner le lecteur. En l’écrivant, Wright n’avait plus rien à prouver. Il avait occupé des postes prestigieux et écrit de nombreux livres salués. Surtout, il savait qu’il allait être emporté par la maladie. Ce livre posthume n’est pourtant pas un testament, mais une proposition honnête pour tracer des pistes meilleures à l’humanité à venir.
Erik Olin Wright, Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle. Trad. de l’anglais par Christophe Jacquet et Rémy Toulouse. Postface de Laurent Jeanpierre. La Découverte, 184 p., 19 €
Avec lucidité, Wright reconnaît sans peine que le capitalisme a pu, par le biais de l’industrialisation notamment, apporter des bienfaits matériels qui le rendent désirable. Parallèlement, il s’élève sans ambiguïté contre les résultats tragiques des expériences chinoise et soviétique. Cela une fois dit, comment bâtir une société qui ne génère ni autocratie, ni exploitation, ni discriminations, ni inégalités stratosphériques, ni destruction accélérée de l’environnement ?
Sans perdre de temps, Wright dresse un panorama des stratégies mises en place au cours des cent cinquante dernières années pour dépasser le capitalisme : l’écraser (par la voie révolutionnaire), le démanteler (comme l’ont fait les gouvernements scandinaves des années 1970), le domestiquer (expériences social-démocrates), le fuir (des phalanstères aux zadistes), y résister (par l’action syndicale). Jugeant peu probable et peu probante la voie révolutionnaire violente, il porte son attention sur les quatre autres, sans les hiérarchiser. Cette démarche anti-autoritaire caractérise l’ensemble du livre.

Erik Olin Wright (2011) © CC/Rosa Luxemburg-Stiftung
C’est elle que l’on retrouve lorsque Wright examine les dissensions actuelles entre les luttes reposant sur des questions de race et de genre, et les conceptions classistes. On sait aujourd’hui à quel point, en France comme aux États-Unis, les forces progressistes peuvent diverger sur ces questions. La centralité donnée à la notion de classe reste forte dans certaines organisations. Et celles-ci peuvent considérer parfois que le discours anticapitaliste résonne peu dans les combats antiracistes ou LGBT.
Cette interrogation complexe est abordée avec calme par ce spécialiste de la notion de classe que fut Wright. Refusant de chercher le sujet supposément le plus opprimé, ou supposément le plus fédérateur, il déplace la question : « Les intérêts directement liés à ces identités hors classe diffèrent des intérêts de classe, mais les valeurs qui leur sont attachées peuvent rejoindre les valeurs de l’anticapitalisme émancipateur. » Sur ce point crucial comme sur d’autres, Wright vise à déminer plus qu’à approfondir les lignes de faille entre les différentes branches du progressisme. Ces « valeurs » communes aux différents combats progressistes sont l’émancipation, la solidarité, le sens de la communauté et du collectif ou le refus de la domination. Pour Wright, la force de « l’individualisme concurrentiel et le consumérisme privatisé » sapent de la même manière les combats pour les droits et contre les discriminations. Dans des champs politiques fragmentés, la reconnaissance de ces valeurs communes s’impose.
Il s’agit donc selon l’auteur de rassembler des secteurs et des cultures politiques multiples : « pour éroder le capitalisme, il faudra tout autant résister au capitalisme et le fuir que mettre en œuvre une politique concertée de domestication et de démantèlement ». Le projet peut sembler improbable. Mais les quelques rares succès récents des progressistes (comme l’échec de l’installation d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes) ont reposé sur l’alliance de forces hétérogènes, voire antagonistes au premier abord. Wright n’exclut rien, ni la lutte électorale ni les piquets de grève, ni les squats ni les réformes institutionnelles. Partant de l’existant, il insiste avec force sur l’importance d’un message clair, car « si la stratégie d’érosion du capitalisme est parfois implicite dans les luttes sociales et politiques, elle n’est généralement pas mise en avant en tant que principe organisateur central du combat contre l’injustice sociale ». Cet aspect change tout.
Prônant l’unité et l’horizontalité, Wright estime que les différentes stratégies (démanteler, domestiquer, fuir, résister) peuvent s’articuler et se renforcer les unes les autres. Qu’elles proviennent de la base de la société ou de l’État, ces dynamiques combinées entraineraient un effet « d’érosion » sur le capitalisme. Notion clé chez lui, l’érosion consiste « à la fois à limiter le capitalisme en revenant sur la privatisation de fournitures de services et de biens fournis par l’État et à développer de multiples formes d’activité non capitalistes en dehors de l’État ».
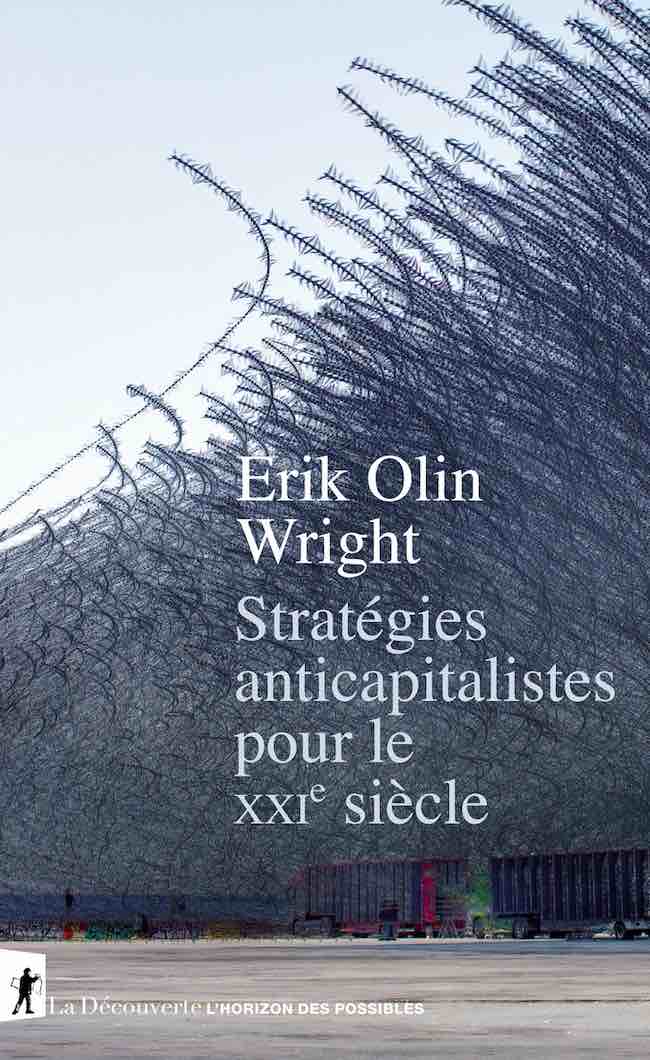
L’érosion évoque la guerre d’usure, mais aussi un temps géologique qui ne rassurera pas les plus pressés, d’autant que Wright ne fixe aucun horizon temporel. Pour étayer cette proposition, il rappelle que le féodalisme n’a pas cédé la place en une nuit au capitalisme, mais qu’il s’est graduellement effacé par la substitution d’activités et de rapports sociaux à d’autres. Il s’agirait d’accroître les tendances déjà existantes dans le tissu institutionnel et économique plutôt que d’attendre le Grand Soir.
Cette conception de l’histoire n’a rien de mécaniste : sans actions humaines concertées, aucune contradiction propre au capitalisme ne le conduira à sa perte. La multiplication des coopératives, des zones autonomes, des législations protectrices, de même que l’amplification de l’économie sociale et solidaire et des services publics, finiraient par miner le système marchand avant de devenir dominant : « L’effet cumulatif des interactions entre changements par le haut et initiatives par le bas doit pouvoir atteindre un point où les relations socialistes créées au sein de l’écosystème économique occupent une place suffisamment grande dans la vie des individus et des communautés pour mettre fin à la domination capitaliste. » Cette conception sera peut-être considérée comme trop gradualiste. Elle manifeste pourtant un certain sens politique en évitant les retours de bâton qui ont suivi des tentatives de changements sociaux brusques et pilotés uniquement par l’État (pensons à la Grèce de Syriza).
Ni « basiste » ni étatiste, ce projet consiste en fait à ne rien fétichiser. Si l’État est nécessaire, sa démocratisation l’est tout autant. Par ailleurs, Wright rassemble un éventail de mesures institutionnelles techniquement réalisables, comme des « établissements de crédit publics spécialisés dans le soutien aux coopératives ». L’auteur étant bien convaincu que l’État ne doit pas être l’opérateur économique dominant, la seule nationalisation qu’il propose est celle des banques, amenées « à prendre en considération les externalités sociales positives des prêts accordés à différents types d’entreprises et de projets ». Le pluralisme et l’horizontalité évoquée dans la stratégie elle-même valent pour l’architecture d’une société socialiste future : « La configuration institutionnelle optimale d’une économie démocratique et égalitaire est probablement un mélange de diverses formes de planification participative, d’entreprises publiques, de coopératives, d’entreprises privées gérées démocratiquement, de marchés et d’autres formes institutionnelles plutôt que la domination exclusive de l’une d’elles. »
Tout cela pourra sembler abstrait. On se permettra de prendre l’exemple concret, connu, existant et fonctionnel d’En attendant Nadeau. Organisation à la gouvernance démocratique, reposant sur le bénévolat, elle choisit de diffuser des analyses sans les faire payer, et sans publicité. Si on suit bien Wright, cette revue contribue, déjà, à éroder le capitalisme.





![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)






