Suspense (37)
Ces temps-ci, les éditeurs republient des auteurs classiques du polar, que ce soit W. H. Burnett, le duo suédois Maj Sjöwall et Per Wahlöö, ou Elmore Leonard. Leurs livres se relisent, parfois avec beaucoup de plaisir, parfois moins, mais d’autres livres, eux contemporains, sont également susceptibles de réjouir et d’intéresser, comme les derniers opus de Mick Herron ou Carlo Lucarelli.
William R. Burnett, Little Caesar. Traduction de l’anglais (États-Unis) par Marcel Duhamel, révisée par Marie-Caroline Aubert. Préface de Benoît Tadié. Gallimard, 288 p., 18 €
Maj Sjöwall et Per Wahlöö, Le policier qui rit. Trad. de l’anglais par Michel Deutsch. Préface de Sean et Nicci French, Jonathan Franzen. Rivages/Noir, 336 p., 9,20 €
Elmore Leonard, Swag. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Élie Robert-Nicoud. Préface de Laurent Chalumeau. Rivages, 349 p., 18 €
Carlo Lucarelli, Une affaire italienne. Trad. de l’italien par Serge Quadruppani. Métailié, 192 p., 20,30 €
Mick Herron, Agent hostile. Trad. de l’anglais par Thomas Luchier. Actes Sud, 334 p., 22 €
Revoici donc Little Caesar (1929), dans une traduction revue et corrigée, précédé de quatre intéressantes pages de préface et d’une petite introduction de l’auteur lui-même faite trente ans plus tard : à la « Série noire », on prend son Burnett au sérieux. Avec raison, puisque le genre lui doit beaucoup. Pour aller vite, William Riley Burnett (1899-1982) a sorti l’histoire de gangsters des « pulps », fait le récit du point de vue des mobsters, utilisé le crime organisé comme quasi-métaphore du fonctionnement social, libéré le style du style.
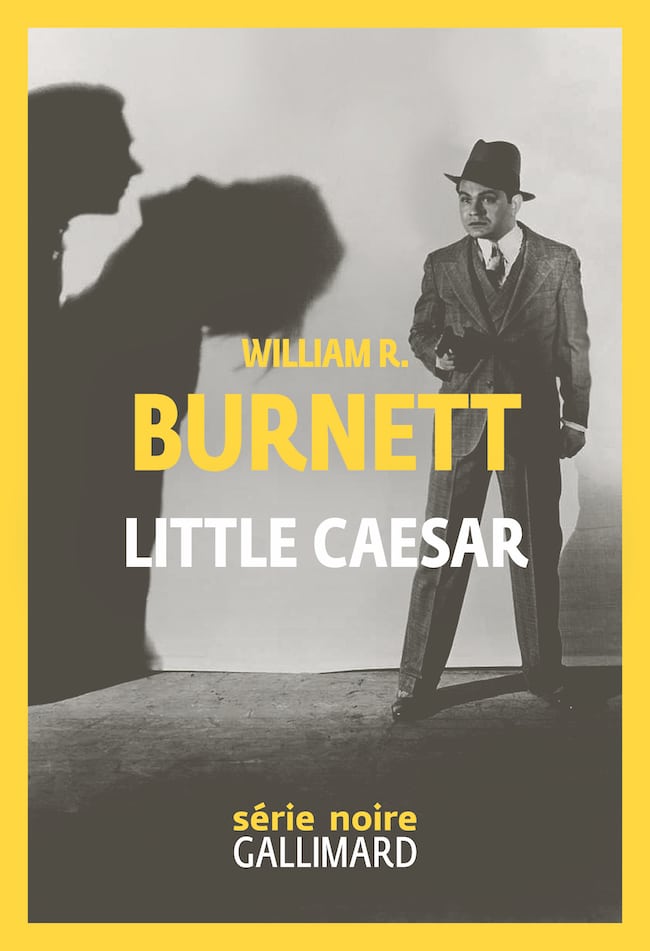
Sans doute, mais on s’ennuie un peu à la relecture de Little Caesar, histoire de Rico, petit malfrat de Chicago qui va monter dans la hiérarchie du crime avant d’être tué – toute référence à des personnes et événements connus n’étant bien sûr pas fortuite. Voudrait-on nous reclasser « livre d’auteur » un ouvrage de seconde zone assez platement écrit et dénué de rythme ? Ou notre tournure d’esprit est-elle insuffisamment archéologique pour nous enthousiasmer ? Restent quelques belles scènes et les coquetteries vestimentaires du héros (« costume noir à rayures roses… chemise bleu pâle… cravate à rayures orange et blanches maintenue par une épingle ornée d’un rubis »), ainsi que ses derniers mots, célèbres grâce au film dans lequel l’acteur Edward G. Robinson les prononce : « Sainte Mère de Dieu, c’est donc la fin de Rico ? » (pour être exact, Robinson dit « Mother of Mercy », le « Mère de Dieu » de Burnett ayant paru trop blasphématoire pour le cinématographe).
Peut-être le lecteur déçu par Burnett trouvera-t-il à se réjouir avec Swag d’Elmore Leonard (1976) qui vient d’être republié. Là aussi il s’agit de gangsters, mais cette fois-ci d’un duo dont les aventures sont traitées sur le mode comique, bien que Leonard ne soit là pas encore au plus drôle de sa forme – il n’en est qu’à son deuxième polar (il en écrira une quarantaine). Dans le livre, Frank Ryan, vendeur de voitures à Détroit, rencontre Ernest Stickley, dit Stick, récemment sorti de taule, lorsque celui-ci vole une auto d’occasion sur le parking de son magasin. Ryan décide alors de changer de métier et de fonder avec Stick une petite start-up de vol à main armée qui se révèle assez performante tant qu’elle suit les « Dix Règles du Parfait Braquage » qu’il a lui-même établies (Règle 1 : toujours être poli au travail, dire s’il vous plaît et merci). Jusqu’au jour où… C’est vif, amusant, très années 1970 pour les costumes, les mœurs, les décors. De bonnes vieilles recettes romanesques faites pour la comédie y sont utilisées avec inventivité et entrain : le « couple » masculin, l’entreprise criminelle bien huilée qui finit par foirer, les complices peu fiables, la femme fatale, les renversements de situations et les réparties.
Par la suite, Elmore Leonard (1925-2013) devint l’auteur à succès (mondial) que l’on sait et déménagea ses livres et ses malfrats sous des cieux criminels différents, comme Miami, qui le fascinait pour son « glitzy crap » et sa culture gangster exotique. Swag est déjà un formidable début, et précède des romans encore plus enlevés comme La Brava (1983), Glitz (1985), Freaky Deaky (1988), Get Shorty (1990), Maximum Bob (1992)… ou d’autres, car l’admirateur de Leonard est susceptible d’avoir sa liste personnelle de « favoris ». En tout cas, ceux qui aimeront Swag pourront retrouver Stick, en Floride justement, dans Le justicier de Miami, écrit sept ans plus tard par un Leonard qui, contrairement à ses habitudes et sans doute par affection pour son sympathique braqueur, le replonge dès sa sortie de prison dans de nouvelles aventures.
Pas de place pour la rigolade dans Le policier qui rit de Maj Sjöwall et Per Wahlöö, dernière réédition du roman de 1968. Mais ça on le savait, car les deux excellents inventeurs du « scandi-noir » (morts respectivement en 2020 et 1975) avaient la fibre critique sérieuse et peu d’indulgence pour les maux du capitalisme, même le plus bonhomme et social-démocrate. Mais, comme le plus souvent cette conscience politique s’accompagnait d’un sens aigu des réalités et des contradictions, d’un talent sûr pour raconter des histoires et créer de bons personnages, leurs dix livres (écrits entre 1965 et 1975) mettant en scène l’inspecteur Martin Beck sont de belles réussites.
Le policier qui rit, quatrième enquête de Beck, se déroule dans l’atmosphère agitée d’un Stockholm secoué par des manifestations contre la guerre du Vietnam. Des tueurs inconnus tuent ou blessent grièvement au fusil mitrailleur le chauffeur d’un bus et les neuf passagers, dont un jeune collègue de Beck qui n’aurait jamais dû se trouver là. La Suède, qui n’avait jusqu’alors jamais connu un tel massacre, est tétanisée. Beck, lui, soumis aux pressions d’une hiérarchie désireuse de voir résoudre l’affaire au plus vite, n’a aucune idée de qui au juste pouvait être visé dans cette attaque et… aucun indice. Bref, c’est très bien. Et pas seulement parce que sans Sjöwall et Wahlöö on n’aurait pas eu de Henning Mankell, d’Ian Runkin, d’Arnaldur Indridason…

Pour une autre nuance de sombre, on se tournera vers le très plaisant et élégant roman de Carlo Lucarelli, Une affaire italienne, où l’on retrouve le commissaire De Luca, absent des librairies depuis une vingtaine d’années. Sa troisième et dernière enquête dans Via delle Oche datait en effet de 1996. Il était apparu pour la première fois dans Carte blanche, exerçant ses talents sous le fascisme et pendant les derniers jours de la république de Salò, à la fois systématiquement désavoué par les fascistes et haï de ceux qui ne l’étaient pas ; dans L’été trouble, à la Libération, il était en fuite, menacé de mort par le CLN (Comitato di Liberazione Nazionale). Dans Via delle Oche, réintégré dans la police de Bologne, il se trouvait mêlé à des luttes de pouvoir lors des élections de 1948. À chaque fois, les circonstances historiques, des intérêts puissants, sa propre obstination à croire en la neutralité, rendaient dérisoires sa vertu morale et son intelligence. D’une manière ou d’une autre, il se retrouvait toujours défait ; ce n’est plus tout à fait le cas dans Une affaire italienne où, ayant appris du machiavélisme de ses employeurs, il finit par avoir le dessus sur tous ses adversaires.
Une affaire italienne se déroule sous la neige, peu avant Noël dans la Bologne de 1953, évoquée à la perfection par un Lucarelli ennemi des leçons d’histoire ou du folklore vintage, plaies habituelles du roman policier historique. Ici, il dessine une Italie juste sortie de la guerre, secouée par des luttes pour la conquête du pouvoir, subissant le durcissement du conflit entre États-Unis et monde soviétique, en passe d’être séduite par les biens, les modes de vie, et le merveilleux jazz… introduits par le plan Marshall.
Une femme est tuée, son mari l’avait été avant elle dans un accident qui se révèle ne pas en avoir été un. De Luca, sorti du placard où l’a relégué son passé politique, doit mener l’enquête, pressé par ses supérieurs d’arriver à une conclusion qui leur convienne et non d’établir une vérité qui pourrait déranger. De Luca, mélancolique et obstiné comme à son habitude, ne l’entend pas de cette oreille, d’autant moins qu’il sent la « patte » des services secrets italiens dans toute l’affaire. Il y laissera presque sa peau.
L’atmosphère calmement inquiétante, les personnages ambigus, les menées secrètes de mystérieux services, créent ici une tension intéressante sans que Lucarelli ait à forcer le trait. Les soupçons se déplacent au fil de l’enquête de De Luca, même si tout le monde, sauf lui, fait de son mieux pour que rien n’avance. Le commissaire découvrira la vérité, mais de justice il ne sera pas question ; et, pour une fois, on l’a dit, le commissaire réussira, avec un aplomb réjouissant de dernière minute, à ne pas faire les frais des machinations d’autrui.
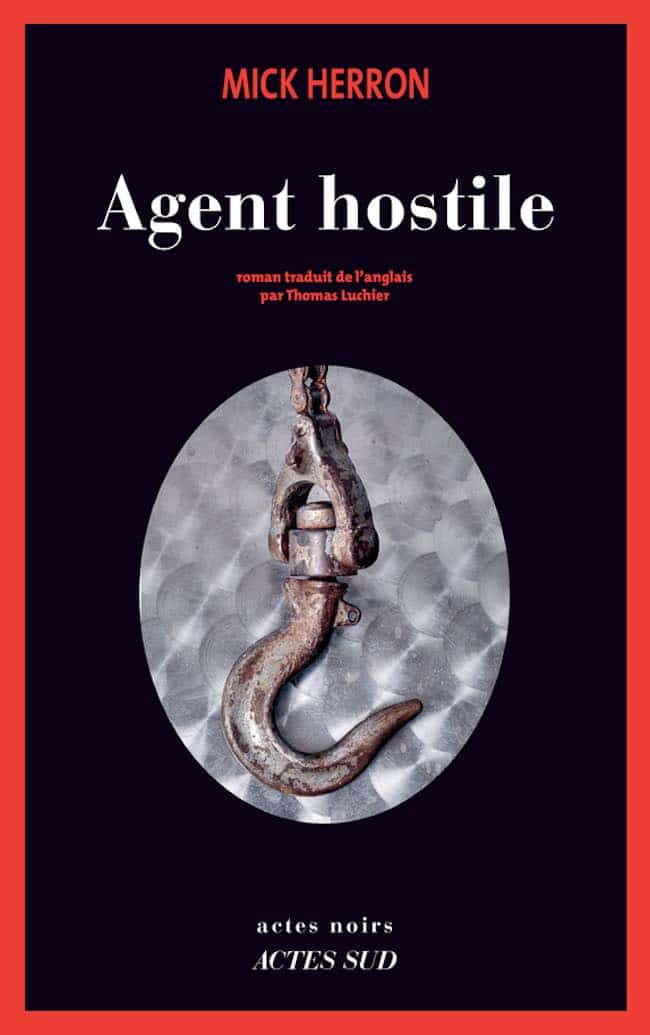
Pour des aventures tout aussi tordues mais moins mélancoliques, le lecteur pourra se tourner vers le dernier Mick Herron, Agent hostile, paru en Grande-Bretagne en 2015 et traduit en français cet automne. Le livre ne fait pas partie de sa célèbre série d’espionnage sur la Slough House (les services secrets bis) mais en reprend certains personnages – le malheureux J. K. Coe, Bad Sam Chapman, et, surtout, dans un rôle essentiel, la formidablement exécrable cheffe du MI5, dame Ingrid Tierney.
Tom Bettany, ex-agent des services secrets, revient en Grande-Bretagne pour l’enterrement de son fils, Liam, qu’il n’avait pas vu depuis dix ans. La police pense que le jeune homme est tombé accidentellement du balcon de son appartement londonien, après avoir fumé un nouveau type de cannabis un peu trop corsé. Tom n’en croit rien. Ses recherches pour faire la lumière sur la mort de son fils le mènent dans les milieux de la drogue, vers le patron de Liam, un développeur de jeux vidéo, mais elles incommodent aussi quelques gros bonnets dont il a déjà croisé le chemin dans une vie antérieure, comme des bosses mafieux et les responsables aux plus hauts échelons du MI5 pour qui il a travaillé. Héros convaincant, qui réussit à être à la fois un dur à cuire et un père en deuil, Bettany se jette dans des situations terrifiantes et désopilantes au fur et à mesure que se déroule une intrigue à double, triple ou même quadruple fond. Tempo parfait, humour noir, dialogues au cordeau, décors londoniens comme si vous y étiez et aviez lu Dickens, fin inattendue. Mick Herron est un as. On le savait.












