Soixante-dix ans après sa parution en anglais, en 1949, 1984 de George Orwell, traduit une première fois en 1950, est tombé dans le domaine public en France ; une période de retraductions s’est alors ouverte, tandis que l’histoire de Winston est sans cesse mobilisée par de multiples discours. Mais que devient la pensée politique d’Orwell dans ses différentes traductions ?
George Orwell, 1984. Trad. de l’anglais par Célia Izoard. Postface de Thierry Discepolo et Celia Izoard. Édition établie par Thierry Discepolo et Claude Rioux. Agone, 450 p., 15 €
George Orwell, Mil neuf cent quatre-vingt-quatre. Trad. de l’anglais et édité par Philippe Jaworski. Gallimard, coll. « Folio Classique », 512 p., 8,60 €
George Orwell, La ferme des animaux. Trad. de l’anglais par Philippe Mortimer. Libertalia, 168 p., 13 €
George Orwell, La ferme des animaux. Trad. de l’anglais par Philippe Jaworski. Gallimard, coll. « Folio », 176 p., 4,50 €
Pendant soixante-huit ans, les choses sont restées simples : lire 1984 en français, c’était ouvrir la traduction d’Amélie Audiberti, publiée par Gallimard en 1950 (un an après la parution du livre en anglais). Pour penser la politique, le totalitarisme et le contrôle des esprits avec les concepts forgés par Orwell, il y avait un vocabulaire bien établi, compréhensible par tous : Big Brother, novlangue, double-pensée, police de la pensée, crime par la pensée… L’éditeur eût-il seulement pris la peine de faire corriger les quelques dizaines d’erreurs grossières, de contresens patents et d’omissions qui l’obèrent, et de toiletter une poignée d’imprécisions ou de maladresses, que cette traduction aurait pu devenir la traduction classique de référence – datée, certes, mais plus que respectable.
En 2018, les éditions Gallimard ont lancé une « nouvelle traduction » (comme il est écrit en couverture), celle de Josée Kamoun. Néoparle et obsoparle, mentopolice et mentocrime… divers mots bizarres ont fait leur apparition dans le lexique franco-orwellien. J’ai exprimé dans ces colonnes mes plus vives réserves à l’égard de ces choix, et de la désinvolture avec laquelle la traductrice, dans le souci de rajeunir le texte, traitait les pages politico-philosophiques .
Et voilà que deux autres traductions viennent de paraître. La première, à nouveau aux éditions Gallimard, est signée Philippe Jaworski. Elle a d’abord été publiée, en octobre dernier, dans un volume de la Pléiade dirigé par lui (Marc Porée en a rendu compte ici même). Elle y est accompagnée d’une notice extrêmement riche, où l’on trouve une analyse littéraire tout à fait remarquable ; c’est, à ma connaissance, la première jamais écrite en français à ce niveau sur ce roman. Trois mois plus tard, cette traduction a reparu séparément dans la collection de poche « Folio classique ». Dans cette édition, les pages de la notice de la Pléiade consacrées aux questions de langue et de traduction sont intégralement reproduites en annexe. Et on retrouve dans la préface du traducteur certaines de ses analyses littéraires, extrêmement condensées.

Statue de George Orwell à Londres (2018) © CC/Ben Sutherland
Mais il y a un sujet sur lequel Philippe Jaworski se fait soudain beaucoup plus affirmatif : « La société de surveillance d’Océanie n’apprenait rien de vraiment nouveau au lecteur de la fin des années 1940, écrit-il, et rien qui ne sera aujourd’hui vite reconnu par le lecteur qui a lu Hannah Arendt, Claude Lefort, Michel Foucault ou tel témoignage d’un rescapé du nazisme ou des camps staliniens. » Le jugement est sans appel : Orwell est un pamphlétaire, un moraliste, un satiriste, un héritier de Swift et de Dickens, un grand romancier… mais pas un penseur. Sur les ressorts ultimes des régimes totalitaires, sur leur nature et leur nouveauté radicale comme systèmes de pouvoir, il ne nous dit rien que nous ne sachions déjà. Comme on le verra, ce point de vue n’est pas sans effet sur les choix du traducteur.
L’autre nouvelle traduction, due à Celia Izoard, est publiée par les éditions Agone – dernier maillon de la lignée de ces petits éditeurs indépendants, militants et compétents (Champ libre dans les années 1980, Ivréa et l’Encyclopédie des Nuisances dans la seconde moitié des années 1990, et Agone, donc, depuis 2008) qui, pendant ces décennies où Gallimard se contentait de réimprimer le bestseller, ont progressivement fait traduire la quasi-intégralité de l’œuvre d’Orwell (les livres de reportage, les romans, les essais, les centaines d’articles, la volumineuse correspondance), l’ont donnée à lire à des publics divers, et ont ainsi rendu possible la reconnaissance d’Orwell comme un auteur de premier plan – un classique pour tous.
Quatre traductions en français de 1984 se côtoient donc aujourd’hui sur les tables des libraires de France. Mais, comme le montre le petit tableau ci-dessous, s’agissant de ses mots, concepts et phrases clé, elles diffèrent considérablement. Il vaut la peine d’examiner quelques-uns de leurs choix, car ils mettent en jeu la compréhension du roman et l’usage politique que ses lecteurs peuvent en faire.
| ORWELL | AUDIBERTI | KAMOUN | JAWORSKI | IZOARD |
| Big Brother is watching you | Big Brother vous regarde | Big Brother te regarde | Le Grand Frère vous surveille | Big Brother te regarde |
| newspeak | (le) novlangue | néoparler | néoparle | (la) novlangue |
| Thought Police | police de la pensée | mentopolice | police de la pensée | police de la pensée |
| Doublethink | double-pensée | doublepenser | doublepense | doublepensée |
| Thoughtcrime | crime de penser | mentocrime | délit de pensée | crime de pensée |
| Proles | prolétaires | prolos | prolétos | proles |
| Controlled insanity | Folie dirigée | Démence maîtrisée | Folie contrôlée | Psychose administrée |
Enfin, un traducteur (Philippe Jaworski) ose Grand Frère ! Le maintien injustifié de Big Brother pendant soixante-dix ans a vidé de son sens le nom du Chef et a fait de celui-ci un être mystérieux, qui ressemble davantage à une divinité extraterrestre ou à une machine monstrueuse qu’à un être humain. La similitude entre le Parti qu’il dirige et l’Organisation secrète des oppositionnels (réelle ou fictive), la Fraternité (Brotherhood), était rendue invisible. Et surtout, on avait oublié que le Chef ne doit pas seulement être craint : il faut aussi l’aimer. « Il aimait le Grand Frère. » C’est la dernière phrase du livre, l’aboutissement de la rééducation de Winston. Face à l’insécurité absolue qu’engendre l’univers de terreur et de haine qu’Il a lui-même créé, le Grand Frère est l’unique protecteur. Curieusement, en traduisant « is watching you » par « vous surveille », Philippe Jaworski perd ce paradoxe et cette ambivalence. Car le Grand Frère ne surveille pas seulement ; il veille aussi, nuit et jour, sur tous et sur chacun. C’est ce qu’oublient toutes les interprétations du roman qui le réduisent à la description d’une société de surveillance. Xi Jinping est bien meilleur lecteur. C’est grâce à Lui que la Chine a remporté la grande victoire contre le covid ; en retour, tous les Chinois lui doivent reconnaissance et affection.
Pourquoi vouloir substituer néoparle à novlangue, et doublepense à double-pensée ? Parce que, explique Philippe Jaworski, newspeak et doublethink ne relèvent pas de l’anglais standard, mais d’une langue nouvelle en cours de fabrication : le newspeak, précisément. Dans cette langue minimale, toute différence entre nom et verbe est abolie. Il n’y a plus que des mots racines indifférenciés, ni noms ni verbes ou les deux à la fois (speak, think), et leurs dérivés (newspeak, doublethink). Pour parvenir – problème délicat – à en offrir des équivalents français, Philippe Jaworski, comme il le dit lui-même, a décidé de ne pas traduire directement mais de transposer au français le procédé de fabrication appliqué à l’anglais par les grammairiens imaginaires de 1984 : il commence par faire de « parle » et de « pense » des mots racines indifférenciés, puis il en dérive « néoparle » et « doublepense », et le tour est joué. C’est ingénieux, subtil, mais ça ne marche pas. Pour une raison bien simple : en français, la différence entre nom et verbe est irréductible ; il n’y a pas de place pour des mots racines indifférenciés. Prenons un exemple rudimentaire. Qu’ont fait les internautes francophones avec les « like » des sites anglophones ? Ils ne sont pas allés inventer un mot racine équivalent, « aime » : ç’aurait été ridicule et personne ne l’aurait utilisé. Spontanément, sur la base du mot racine anglais « like », qu’ils ont conservé, ils ont créé un verbe français, « liker », et le substantif correspondant, « un like ».
Si le newspeak n’était que la parodie swiftienne d’une langue de bois mécanisée et poussée à l’extrême, si Orwell n’avait imaginé que des exemples aussi grotesques que ceux qu’il donne dans l’appendice du roman (comme doublepluscold pour dire « excessivement froid »), la fabrication de ces chimères verbales inutilisables que sont néoparle et doublepense serait sans conséquence. Mais newspeak et doublethink ne sont pas des exemples amusants d’une pseudo-langue délirante. Ce sont des concepts fondamentaux, forgés par Orwell pour servir à la description et à la compréhension des mécanismes intellectuels du contrôle des esprits. Ils n’ont leur équivalent chez aucun autre penseur du totalitarisme, ni chez Arendt, ni même chez Lefort. Il vaudrait mieux que, dans leur traduction française, ces concepts élaborés par le rationaliste, empiriste et défenseur du sens commun qu’était Orwell ne se présentent pas sous des noms impossibles.
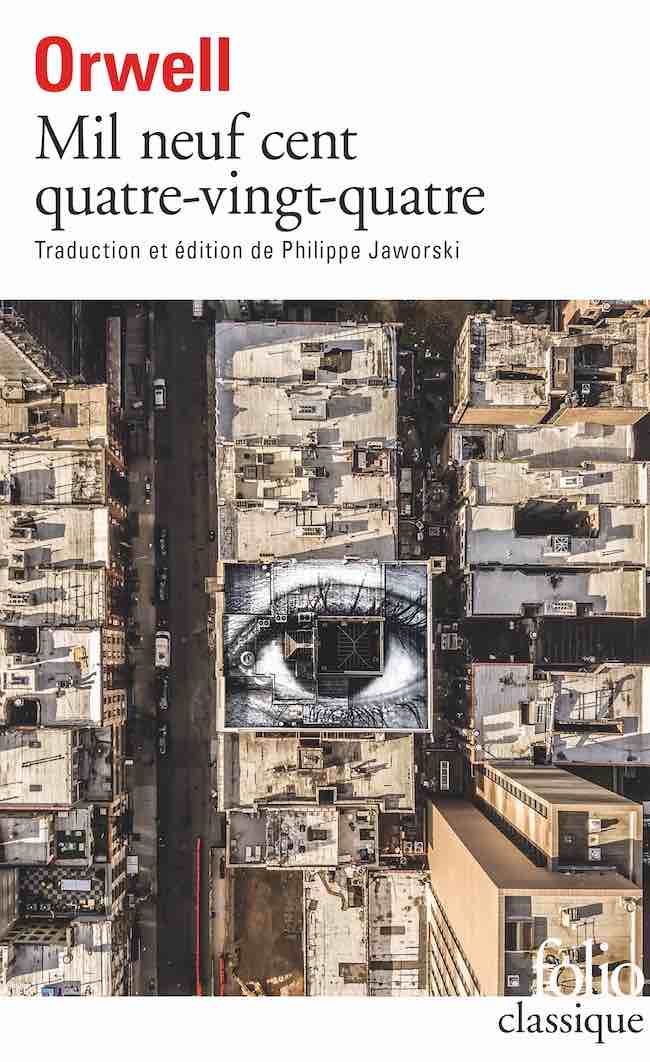
Bien sûr, dans le roman, ces concepts sont la création d’oligarques imaginaires et d’intellectuels à leur service. Mais c’est la conséquence du dispositif sur lequel repose 1984 : Orwell place toutes ses idées sur la nature et les ressorts des régimes totalitaires dans la bouche ou sous la plume de dictateurs d’une nouvelle génération, plus lucides sur eux-mêmes et sur les bases réelles de leur pouvoir que les dirigeants nazis ou bolcheviques. Il n’a pas créé newspeak et doublethink pour qu’ils restent enfermés dans une langue imaginaire ; il voulait les faire entrer dans la langue anglaise, et il y a réussi. Néoparle et doublepense, eux, sont construits pour demeurer dans le monde clos de la fiction et ne jamais entrer dans le français standard.
1984 est une satire politique : elle vise le monde réel ; elle est écrite pour que ses lecteurs fassent, dans ce monde réel, un usage réel de ses mots. Alors que les substantifs novlangue et double-pensée, créés par Amélie Audiberti, sont si facilement compréhensibles et assimilables qu’ils ont été depuis longtemps adoptés par d’innombrables locuteurs et auteurs francophones, néoparle et doublepense sont si étrangers à la langue française qu’ils paraissent relever d’un jargon ésotérique ou du vocabulaire d’une secte philosophique. Si un journaliste entreprend de raconter comment les firmes qui fabriquent des insecticides ont créé des fondations spécialement destinées à chercher toutes les causes possibles du déclin des populations d’abeilles… à l’exception de leurs propres produits, c’est double-pensée qui tombera naturellement sous sa plume, certainement pas doublepense. Et, pour mieux faire entendre à ses lecteurs que l’expression « aux-couleurs-de-la-Chine » est un opérateur langagier qui, accolé à « démocratie », permet aux dirigeants chinois de faire en sorte que ce mot signifie désormais « dictature », il suffira à un analyste politique de dire : « c’est un procédé typique de novlangue », et ses lecteurs auront compris. S’il avait employé néoparle, il les aurait plongés dans la perplexité.
La traduction de Jaworski réserve d’autres surprises. En diverses occurrences, il altère le sens du texte sans qu’on en comprenne la raison. Quand O’Brien proclame devant Winston : « We are the priests of power », il traduit : « Nous sommes le clergé du pouvoir ». Pourquoi écarte-t-il « prêtre » ? Jugerait-il plus pertinent de voir le commissaire politique comme le rouage d’une institution que comme le membre d’une caste sacerdotale ? Mais ce n’est pas l’idée d’Orwell. Ce qui soude entre eux les dirigeants du Parti dans 1984, c’est une mystique du pouvoir. Durant les séances de rééducation qu’il inflige à Winston, O’Brien ne cesse de lui dire qu’il va le purifier, le rendre parfait et sans tache, avant bien sûr de le liquider : il ne sera pas un martyr, mais une victime sacrificielle, qu’il faut préalablement débarrasser de ses souillures. On peut juger cela inapproprié, ou reculer devant de pareilles idées. Mais c’est ce qu’écrit Orwell. De même, pourquoi Jaworski traduit-il thoughtcrime par délit de pensée (et non, comme cela semble aller de soi, crime par la pensée), ce qui l’entraîne ensuite à traduire thought criminal par malpenseur ? Pourquoi affaiblir délibérément ce concept, jusqu’à le fausser, alors que le roman nous explique que le thoughtcrime – avoir, par exemple, le projet de tenir un journal à l’abri du télécran – est « le crime essentiel [essential crime] qui contient tous les autres » ? On se perd en conjectures.
Et puis, il y a l’entrée en scène des prolétos. Pour désigner les prolétaires – la classe des sans-parti, 85 % de la population –, Orwell utilise une forme abrégée de proletarians en vigueur depuis des décennies : the proles. Ce mot, explique Philippe Jaworski, « est relativement neutre en anglais ». Il refuse de le traduire par prolos (ce qu’a fait Josée Kamoun), car il juge ce terme « chargé de connotations méprisantes ou comiques ». (On pourrait discuter ce point : la pratique qui consiste pour un groupe dominé à retourner avec fierté un terme péjoratif n’est pas rare. Mais admettons.)
Qu’est-il proposé à la place ? Prolétos, qu’il emprunte à l’espéranto, où proleto signifie prolétaire. Cette solution laisse pantois. Le mot sonne comme un sobriquet, et il est tout sauf neutre. On le croirait inventé par des mondains de la Belle Époque venus s’encanailler à Belleville, et prononcé dans l’entre-soi avec un petit sourire amusé, tout de condescendance et de mépris. La traduction de proles n’est pas une question secondaire, car le slogan « if there is a hope, it lies in the proles » court comme un leitmotiv au fil du roman. Quand Winston, dans les premiers chapitres, déambule dans les quartiers populaires, cette formule lui apparaît comme « une palpable absurdité ». Mais, au terme de son cheminement intellectuel et moral (1984 étant, à certains égards, un roman d’éducation), juste avant d’être arrêté, quand il regarde depuis la fenêtre de sa mansarde l’imposante blanchisseuse qui chante dans la cour en étendant son linge, il a réussi à lui donner un sens : le Parti est la mort, les prolétaires sont la vie ; ils chantent, le Parti ne chante pas ; ils ont sauvegardé quelque chose de la décence commune ; ils sont l’avenir. Il importe qu’à cet instant le mot pour désigner les prolétaires ne porte aucune marque de mépris.
On se tourne alors vers l’autre nouvelle traduction, celle de Celia Izoard, dans l’espoir d’une solution. Mais c’est pour découvrir… qu’elle n’a pas traduit : elle a conservé le mot prole. Cette incompréhensible reculade a un effet immédiat : « prole » en français sonne comme le nom d’une espèce de fleur ou de papillon. Les prolétaires seraient-ils d’une autre espèce que les membres du Parti ? Il est vrai que, dans ce système de caste qu’est la société de 1984, les dominants et les dominés ne se mélangent pas. Mais la question de savoir ce que signifie « être humain », et qui le demeure encore dans l’univers totalitaire, est un des enjeux du roman. « Les prolétaires ne sont pas des humains », chuchotent entre eux les membres du Parti. Au terme de son parcours, à l’instant d’être arrêté, Winston retourne cette idée : l’inhumanité, c’est le Parti ; l’humanité, ce sont les prolétaires. On en vient à penser que Celia Izoard aurait été mieux inspirée de rester dans les traces d’Audiberti, comme elle l’a fait pour les autres mots clé, et de s’en tenir à « prolétaires ».
Pour le reste, la traduction de Celia Izoard est, de loin, la plus scrupuleuse des quatre ; mais cette modestie devant le texte se paie parfois d’une certaine gaucherie et, plus généralement, d’un manque de rythme et de relief. Le plain style d’Orwell – ce style simple et familier qui est sa marque de fabrique – n’est pourtant pas un style plat : il est incisif, direct, rugueux, brutal parfois ; les images sont concrètes ; les phrases, denses. En créer un équivalent français est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. D’autant que traductrices et traducteurs ont sous les yeux la maxime première de l’auteur, exprimée dans « La politique et la langue anglaise » (repris dans Tels, tels étaient nos plaisirs et autres essais, Ivréa & l’Encyclopédie des Nuisances, 2005) : « Ce qui importe avant tout, c’est que le sens gouverne le choix des mots, et non l’inverse. En matière de prose, la pire des choses que l’on puisse faire avec les mots est de s’abandonner à eux. » Autrement dit : ne laissez jamais les mots s’envoler d’eux-mêmes, encore moins s’engendrer les uns les autres. Orwell ne laisse pas de grands espaces de fantaisie à ses traducteurs ; leurs marges de manœuvre sont étroites.
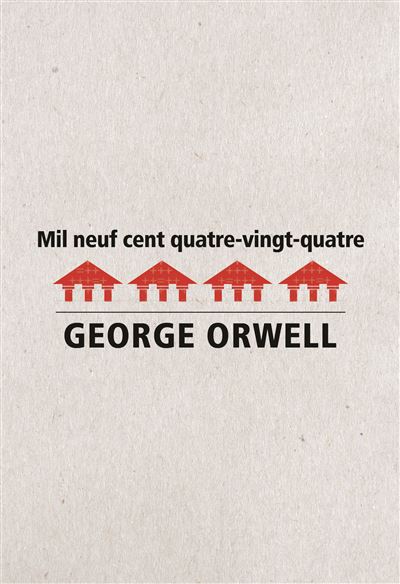
Une autre maxime, tirée du même essai, vise à calmer les ardeurs théoriciennes : « N’utilisez jamais une expression étrangère, un terme scientifique ou spécialisé si vous pouvez leur trouver un équivalent dans la langue de tous les jours. » Elle devrait protéger contre les tentations de la sur-traduction et de la surinterprétation. Celia Izoard n’y échappe pas toujours – par exemple, quand controlled insanity devient sous sa plume « psychose administrée ». « Folie contrôlée » était-il trop simple ? Est-ce un écho de l’idée selon laquelle une société totalitaire est le paroxysme de la « société administrée » hyper-rationnelle ? (Cette vision classique, qui vient notamment d’Adorno, court en filigrane dans la postface qu’elle a cosignée avec Thierry Discepolo. Mais ce n’est certainement pas celle d’Orwell.)
En tout cas, par la faute de cette surcharge interprétative, on passe complètement à côté d’une idée qui, pour être très simple, n’en est pas moins une des plus fortes et des plus originales du roman. Les dirigeants totalitaires ont construit un univers délirant, où ils prétendent contrôler le passé (en le réécrivant) et la réalité extérieure (en décidant du vrai et du faux jusque dans les sciences de la nature). La folie est inhérente aux régimes totalitaires ; elle y est structurelle, et c’est parmi leurs dirigeants qu’elle culmine. Mais, comme dit Orwell, réalité et vérité n’en continuent pas moins d’exister dans leur dos. Pour conserver leur pouvoir, ils doivent garder un pied dans le réel. Et, pour cela, contrôler la folie qui est en eux. Sans en guérir toutefois, car elle est indissociable de leur pouvoir absolu. C’est un problème que tous les systèmes totalitaires, d’hier et d’aujourd’hui, ont rencontré. Les Khmers rouges ont sombré pour n’avoir pas maitrisé leur démence. En Chine, au contraire, après les dix années de folie mal contrôlée de la Révolution culturelle, Deng Xiaoping a repris les choses en main. Sans renoncer à la folie, bien entendu : encore aujourd’hui, le massacre de la place Tian’anmen (1989) n’a jamais eu lieu.
La situation éditoriale de La ferme des animaux, l’autre bestseller orwellien, est un peu semblable à celle de 1984. Pendant très longtemps, il n’y a eu qu’une seule traduction, celle de Jean Quéval (Ivréa, 1981, plus tard reprise en « Folio »). Deux nouvelles traductions viennent de paraître coup sur coup. D’abord, celle du même Philippe Jaworski dans la Pléiade, immédiatement rééditée, elle aussi, en format poche. Mais la notice et toutes les notes ont disparu ! Les jeunes générations seraient-elles si remarquablement informées sur l’affrontement Staline-Trotski, sur le stakhanovisme ou sur la conférence de Téhéran en 1943 (parodiée à la dernière page du roman) qu’elles n’auraient besoin d’aucune information pour décrypter cette satire allégorique et chronologique de la révolution russe et de ses suites ? Ou souhaite-t-on qu’elles le lisent comme « un conte de fées » (c’est le sous-titre du roman), au premier degré ?
Une autre traduction de La ferme des animaux, par Philippe Mortimer, vient de paraître aux éditions Libertalia. On y trouve les indispensables notes de bas de page, mais aussi (en annexe) les deux préfaces écrites par Orwell pour ce livre, et surtout (intégralement citée dans la préface du traducteur) sa lettre du 5 décembre 1946 à Dwight Macdonald où il explique, avec la plus grande précision, la signification politique qu’il donne à son roman. L’évolution de la révolution russe, conclut-il, « était entièrement prévisible […] en raison de la nature même du parti bolchevik. Ce que j’ai tenté de dire, c’est : « Vous ne pouvez pas faire la révolution si vous ne la faites pas vous-même. Il ne peut y avoir de dictature bienfaisante » ».
Comme on voit, contrairement à ce que voudrait nous faire croire une interprétation conservatrice de la pensée d’Orwell assez répandue aujourd’hui, il ne dit pas : « Toutes les révolutions aboutissent à des dictatures ». Il dit : si vous ne voulez pas que la révolution à laquelle vous aspirez dégénère en dictature, faites-la vous-même et ne laissez pas les dictateurs s’en emparer. Comme toujours chez lui, il n’y a ni déterminisme, ni loi de l’histoire. L’issue dépend de nous. Orwell est, comme Machiavel, un penseur de la contingence et de la volonté. Parmi les penseurs de gauche, c’est une qualité plutôt rare.



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)








