Si l’on admet que la pensée critique, au sens non négatif du terme, doit prendre acte de la réalité effective sans l’accepter pour autant, il importe de bien analyser les tendances à l’œuvre afin de manifester ce qui doit être combattu et ce qu’il convient de défendre ou de promouvoir. De ce point de vue, le livre du philosophe Pierre Crétois est précieux. Abordant une question que les mouvements sociaux des dernières années ont placée au centre de leurs revendications – le « commun » –, La part commune donne à comprendre tout en proposant une assise pour des perspectives politiques en train de se dessiner.
Pierre Crétois, La part commune. Critique de la propriété privée. Amsterdam, 207 p., 16 €
C’est un fait que la question du commun s’affirme, depuis un certain temps déjà, comme centrale pour qui refuse la dynamique néolibérale à laquelle l’État ne saurait s’opposer puisqu’il en est devenu l’agent. Soyons clair et précisons avec Pierre Dardot et Christian Laval, auteurs d’un important ouvrage sur le sujet (Commun, La Découverte, 2014), qu’il ne s’agit nullement de la réaffirmation d’une Idée éternelle (celle du communisme) ayant un temps été occultée, mais bien de l’émergence d’une nouvelle orientation critique s’opposant à ce qu’ils considèrent comme « la tendance majeure de notre époque : l’extension de la propriété privée à toutes les sphères de la société, de la culture et du vivant ».
Le sous-titre de l’ouvrage de Pierre Crétois, Critique de la propriété privée, prend ici tout son sens, indiquant clairement qu’il s’inscrit dans un courant de recherches visant « un renouvellement de la théorie de la propriété en droit, en économie et en philosophie ». Une telle option suppose de reconnaître que la notion de propriété n’est pas parfaitement définie, et que le croire, s’imaginer qu’elle va de soi, tient d’une idéologie tenant pour naturel ce qui relève d’une construction sociale. Lutter contre cette pensée, qui reste largement dominante, suppose donc un rappel historique faisant paraître la manière dont s’est affirmée l’idée selon laquelle « la propriété est un droit naturel (I) acquis par le travail (II) qui récompense un mérite (III) et sur lequel nul n’a le droit d’interférer (IV) ».
Ces quatre thèses constitutives de ce que l’auteur nomme « l’idéologie propriétaire », d’abord affirmées par John Locke au chapitre V de son Second traité du gouvernement civil (1690), seront déterminantes pour toute la pensée moderne du droit, comme l’atteste l’article 544 du Code civil, énonçant depuis 1804 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La tension que manifeste cet article, qui postule l’absoluité d’un droit devant toutefois s’inscrire dans les limites de la loi, vaut comme un indice des difficultés de cette conception classique de la propriété. De fait, l’analyse des conséquences qu’elle induit permet de « récuser l’idée que la propriété soit le droit absolu d’un homme isolé sur ce qui lui appartient ». À considérer les choses de la sorte, on s’avère en effet incapable de régler des conflits de propriété.
Pierre Crétois présente alors avec une grande clarté des débats ayant eu cours outre-Atlantique, afin de faire valoir que, en dépit des amendements proposés par ses défenseurs, le droit absolu de propriété reste incomplet ou indéterminé dans la mesure où l’on ne peut trancher les éventuels litiges par simple référence à ce droit. Cela se perçoit aisément à partir d’un exemple cocasse, souvent cité dans les études juridiques et opportunément rappelé dans l’ouvrage : peut-on interdire à un individu de dresser des poteaux de bois sur son terrain au prétexte qu’ils peuvent déchirer le dirigeable du voisin ? Si le juge a pu le penser, c’est bien parce qu’il a retenu une intention morale en considérant que les pieux ne visaient qu’à empêcher l’usage de cet appareil, c’est-à-dire qu’ils n’avaient d’autre fonction que de nuire au voisin.

Arizona (2007) © Jean-Luc Bertini
Après avoir montré les impasses des tentatives de fonder l’appropriation privative par le travail, toujours tributaire de ressources qu’il n’a pu produire lui-même, ou par le mérite, dont l’analyse montre très vite qu’il est un concept des plus indéterminés, Pierre Crétois s’emploie à dénoncer ce qu’il nomme en clin d’œil à Marx une « robinsonnade ». Il s’agit pour lui de montrer que les biens ne peuvent jamais être envisagés simplement en eux-mêmes, isolés ou séparés de l’environnement ou de l’écosystème dans lequel ils s’inscrivent. Cela suppose la remise en question d’une des oppositions les plus évidentes pour les juristes, puisqu’elle semble dériver directement de la summa divisio distinguant les personnes et les choses, l’opposition des droits personnels reliant les hommes entre eux et des droits réels les reliant à leurs biens. Si les premiers sont envisagés à partir de conventions ou de contrats, ce ne serait pas le cas des seconds ; ce que l’auteur réfute en considérant que « l’hypothèse d’un contrat » est « la plus convaincante d’un point de vue philosophique » pour justifier le droit de propriété. Il faut bien voir, en effet, que ce droit se distingue de la simple possession dans la mesure où il se trouve respecté par tous. Autant dire qu’il s’affirme ainsi comme droit sur les autres (droit d’imposer le respect du mien) avant d’être droit sur les choses – ce qui en fait toute la spécificité.
Pierre Crétois fait alors valoir que le fondement de l’obligation faite à chacun de respecter ce qui appartient à autrui « ne peut pas être seulement moral, mais doit être également (et peut-être avant tout) politique, c’est-à-dire collectivement discuté et accepté ». Il retrouve ainsi Rousseau pour qui seul le contrat social peut être source du droit de propriété, lequel se trouve de la sorte subordonné au bien commun. C’est là un point central qui, laissant entendre qu’il y a « toujours irréductiblement du commun dans le propre », conduit à un changement de la conception des droits de propriété. Ceux-ci ne peuvent plus être simplement compris comme « des droits de se séparer », mais doivent être perçus comme « des règles d’organisation reliant les membres d’une communauté humaine ». Aussi n’est-il pas étonnant que notre auteur fasse référence à l’économiste institutionnaliste John Commons (1862-1945), dont les idées ont eu une grande influence, notamment sur Elinor Ostrom, qui a travaillé à une économie politique des communs et dont Pierre Dardot et Christian Laval assurent qu’elle renoue « avec les traditions de pensée du socialisme qui faisait de la coopération l’antidote à la logique capitaliste de la concurrence ».
Pour finir, Pierre Crétois tâche de repenser notre rapport aux choses en insistant sur le fait que ce qui importe est « la jouissance de leurs fonctionnalités » et que « s’approprier les choses est, de ce point de vue, indifférent ». C’est là une thèse stimulante, mais qui pourrait bien marquer les limites de La part commune : tout se passe, en effet, comme si l’idéologie du propriétaire qui y est dénoncée avec vigueur n’était qu’une expression d’une signification imaginaire centrale, au sens que Cornelius Castoriadis donne à ce terme, structurant les sociétés occidentales modernes tout comme elle façonne les mentalités des individus, de sorte que sa remise en cause ne peut être envisagée isolément.
C’est ainsi qu’on peut s’étonner de la peine prise par l’auteur à mettre en lumière les conséquences intenables, d’un point de vue moral, des vues de l’économiste anglais Ronald Coase, connu pour avoir tenté de régler le problème des « externalités négatives », c’est-à-dire les effets nocifs pour l’environnement de l’activité d’un agent économique, dans le seul cadre marchand. Ses analyses lui valurent certes le prix Nobel, mais cela n’en dit-il pas davantage sur une époque prenant au sérieux l’image de l’homo economicus ainsi que le caractère autorégulateur des marchés que sur leur pertinence ?
On peut également s’interroger sur l’importance accordée par Pierre Crétois aux thèses soutenues par Amartya Sen et Martha Nussbaum concernant les « capabilités », c’est-à-dire les aptitudes à la réalisation ou les possibilités effectives pour chacun d’être et d’agir librement, qui, si pertinentes qu’elles soient en ce qui concerne le bien-être individuel, semblent insuffisantes pour une réactivation de la politique comprise, toujours avec Castoriadis, comme activité collective visant l’institution comme telle. Mais cela n’enlève rien à l’intérêt de l’ouvrage, cela montre seulement que l’implacable déconstruction de l’idéologie du propriétaire qu’il présente semble déborder ses intentions.








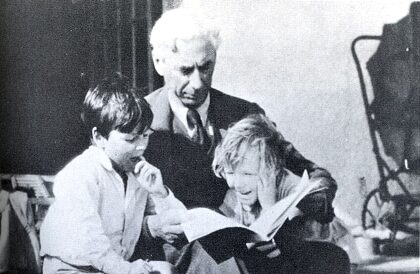



![Theodor W. Adorno, Trois études sur Hegel [1970], tr. de l’allemand par le Groupe du Collège international de philosophie, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 168 p. Theodor W. Adorno, La « Critique de la raison pure » de Kant [1959], tr. de l’allemand par Michèle Cohen-Halimi, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 540 p. Theodor W. Adorno, Leçons sur l’histoire et sur la liberté (1964-1965),](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/11/Paul_Klee_Seiltanzer_1923.jpg)