La carrière politique de Machiavel commence trois mois avant l’exécution de Savonarole et s’achève avec sa mort, six semaines après le sac de Rome par les troupes impériales. Soit toute une « vie en guerres », comme le souligne fort justement le sous-titre de Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, qui parlent en experts d’une œuvre dont ils ont eux-mêmes traduit plusieurs textes canoniques. Leur propre combat se livre discrètement dans les notes contre les anti-machiavel de tout bord, ceux qui voudraient réduire le ferrailleur à un théoricien ignorant des choses militaires, ou opposer le Machiavel du Prince à celui des Discours, ou ceux comme Leo Strauss qu’ils situent à la source de la pensée néoconservatrice américaine, qui a elle-même inspiré des critiques français comme Pierre Manent. Leurs armes, ce sont les missives diplomatiques et les rapports de mission qui viennent à point éclairer les formulations parfois énigmatiques du Florentin.
Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini, Machiavel. Une vie en guerres. Passés/Composés, 615 p., 27 €
Parmi ses tout premiers écrits politiques, sitôt son entrée au service de la chancellerie, une lettre de mars 1498 rapportant les prêches incendiaires de Savonarole suffirait à montrer pourquoi on le lit et l’analyse encore de nos jours avec tant de passion : « à mon avis, accuse-t-il, il seconde les temps et colore ses mensonges ». Le prêtre de San Marco appelait aux armes ses concitoyens contre les tyrans ennemis de la République florentine, qui se trouvaient être d’abord les siens.
Le parcours de Machiavel pendant les premières décennies du XVIe siècle offre une histoire détaillée de la diplomatie florentine, qui, au lieu de poursuivre la guerre par d’autres moyens, tente désespérément de l’éviter, à son grand péril. Les guerres ont commencé avec l’arrivée des troupes françaises dans la péninsule. Que vient faire Charles VIII en Italie ? Récupérer la couronne de Naples héritée de sa famille d’Anjou, de ce « bon roi René » sans sou ni maille moqué par les chroniqueurs étrangers. Ses successeurs se laisseront prendre comme lui au rêve italien, rêves et appétits de conquête où ils entraînent leurs cousins couronnés. Érasme les fustigera tous dans sa Complainte de la paix, écrite à quelques années du Prince, adressée aux grands monarques d’Europe qui, au lieu de rester sagement chez eux, ne songent qu’à étendre leurs territoires.
Une vie en guerres suit Machiavel pas à pas, lettre à lettre, dans ses diverses missions. Historien du présent, il rédige ses missives et règle sa pensée sur l’urgence du moment. Une pensée toujours en alerte, déjà ébauchée dans ses premiers écrits, qui va nourrir sa réflexion sur les aléas de la république de Florence. L’instabilité permanente entretenue par les divisions internes éclaire les propos répétés du secrétaire des Dix sur la fortuna, et la virtù qui s’applique à la saisir au vol. La France, l’Espagne, l’Empire et la papauté se disputent la suprématie sur la péninsule. Outre la menace étrangère, l’agitation est endémique dans les villes sujettes de Florence convoitées par ses voisins, César Borgia qui ambitionne d’être « le roi de Toscane » et veut faire changer le gouvernement de la République, les Orsini et Vitelli qui veulent y faire revenir les Médicis. Cette fois, c’est l’allié français de Florence qui tient leurs ambitions en respect et soumet la cité rebelle d’Arezzo.
Dans ces jeux mouvants d’alliance, de défection, de revirement, de trahison, Machiavel informe les Dix que « si les mots et les discussions montrent l’accord, les ordres et les préparatifs montrent la guerre ». Son mandat, écouter et transmettre, le conduit à entrer autant que faire se peut dans la pensée du Borgia pour deviner ce qu’il prépare. Sa conviction personnelle, c’est que ce modèle non nommé du Prince finira par l’emporter, notamment parce qu’il s’applique à se constituer ses « armes propres ». Un poème, le Decennale, retrace la décennie d’épreuves depuis l’arrivée des « troupes barbares » de Charles VIII pour mieux plaider la nécessité d’armer la cité. Il parvient à faire admettre aux gouvernants l’urgence de créer une milice florentine, l’ordinanza, dont il organise le recrutement (selon l’âge, la situation de famille), les effectifs, l’armement, les uniformes, les bannières (de couleur variable selon les communes du contado mais portant toutes le lion en signe de ralliement), les périodes d’exercice (au rythme des travaux agricoles), la discipline, les sanctions en cas d’absentéisme, la chaîne de commandement, les « montres » qui assurent le lien permanent entre le militaire et le politique, et « quelque peu de religion » afin de rendre les soldats « plus obéissants ». Des règles susceptibles d’évoluer si la situation l’exige : une crise peut être l’occasion de réformer, car Machiavel sait faire preuve d’une « véritable inventivité normative », soulignent les auteurs. Sa créativité empirique se déploie à mesure que les questions, les imprévus, se présentent effectivement.
Sa mission en Allemagne auprès du nouvel empereur contribue à la « longue expérience des choses modernes » dont il se prévaut dans la dédicace du Prince. Maximilien, roi des Romains, se veut rex Italiae et réclame le soutien financier de Florence pour son couronnement, en échange de sa protection, la promesse de préserver la « sûreté » de la ville. La mission de Machiavel, qui doit naviguer à vue entre les parties prenantes est si complexe qu’« aucun homme, s’il n’était prophète, ne pourrait tomber juste si ce n’est par hasard ». On se croirait dans une scène de Jules César, la pièce la plus machiavélienne de Shakespeare : « There is a tide in the affairs of men / Which, taken at the flood, leads on to fortune. » Pour finir, les armes tranchent le débat : pendant les pourparlers, les troupes allemandes ne cessent d’affluer, mais les Vénitiens s’opposent à leur passage, et Maximilien perd ses terres du Frioul. Le Rapport des choses d’Allemagne détaille « la nature » de l’empereur : dépensier donc toujours à court d’argent, indécis, écoutant tout le monde et personne, peu soutenu par l’Allemagne où règne la désunion, il offre le parfait contre-exemple de ce que doit être la conduite d’un prince. Cette désunion d’une Allemagne fractionnée en petites Suisses, villes franches, princes et empereur, qui sera analysée dans les Discours, pointe de façon oblique les faiblesses et les hésitations de la politique militaire florentine. Loin de faire la guerre depuis son bureau, Machiavel « voltigeait d’armée en armée », conclura le diplomate Iacopo Pitti de sa lecture des archives. Le secrétaire organise en personne le blocus et la soumission de Pise, qui marque le sommet de sa carrière politique.

Portrait de Machiavel (XVe-XVIe siècle) © BIU Santé (Paris)
Florence se retrouve prise entre le Vatican et les Français lorsque le nouveau pape, Jules II, entreprend de les chasser d’Italie. Machiavel est alors chargé d’une mission délicate, dissuader le pape de les attaquer sans pour autant se brouiller avec lui, car, lui écrit le gonfalonier, « si un pape ami ne vaut pas grand-chose, ennemi il vous nuit beaucoup », « vous ne pouvez lui faire la guerre ouvertement sans que le monde entier ne devienne votre ennemi ». Machiavel précisera plus tard quelle place il accorde au religieux dans le champ politique, en prônant une religion civique qui sera jugée sacrilège. Pour l’instant, Louis XII menace de faire déposer le pape par un concile et de se partager l’Italie avec l’empereur, et réclame l’envoi de troupes florentines. Machiavel obtient que les troupes restent en Toscane, mais la guerre d’Italie aura bien lieu, comme il le pressent. L’Espagne se ligue avec le pape et les Vénitiens contre la France. Le soutien des Suisses à la Sainte-Ligue est décisif, renforçant sa conviction que « le nerf et le fondement » d’une armée, c’est l’infanterie. Il a mis en place l’ordonnance des fantassins, dont l’efficacité fut prouvée par les anciens Romains, il doit maintenant recruter les premiers chevau-légers, et rédige l’ordinanza de’ cavalli.
L’arrivée des troupes espagnoles sur le territoire florentin marque la fin de la république, et le retour des Médicis. Machiavel s’empresse de les mettre en garde contre un retour au statu quo ante qu’espèrent les Grandi, les ennemis aristocratiques du peuple et du gonfalonier déchu. Sans succès. Le Grand Conseil, le conseil des Quatre-Vingts et la milice sont supprimés, lui-même est démis de ses fonctions. S’il est prêt à collaborer au gouvernement Médicis, voire à entrer au service de leur cousin le nouveau pape Léon X, on ne saurait l’accuser, comme ce fut fréquent, de trahison, de reniement ou de ralliement, insistent les auteurs : fort de sa double expérience – actions et lectures –, il veut continuer à prendre part au grand jeu diplomatique et garder une relation ouverte avec les puissants car c’est son métier, l’arte dello stato.
Ici commence la rédaction de l’essai sur les principats dont il espère, sinon un retour en grâce, du moins un retour aux affaires. Là encore nous sommes conviés à la suivre pas à pas car elle s’écarte du plan strict annoncé en ouverture, sa réflexion évolue à mesure des questions soulevées en cours de route. Deux longues missives sur la situation internationale rédigées en même temps ou peu après empruntent plusieurs passages au Prince. Machiavel a fréquenté les trois figures centrales de son essai, Louis XII, César Borgia, Jules II – trois « princes nouveaux » dans la mesure où ils n’étaient pas destinés à la fonction qu’ils occupent –, analysant leur nature et leurs mauvais choix, dont la fortune les a parfois sauvés. Il ne faut pas voir en eux des modèles, préviennent les auteurs, mais des « embrayeurs de la pensée », le but de ce laboratoire politique étant proclamé en fin d’ouvrage, une « Exhortation à libérer l’Italie des barbares ». Le texte circule en manuscrit dans les cercles de pouvoir européens, où la rupture franche avec le modèle traditionnel du prince chrétien ouvre une longue histoire de réactions admiratives ou violemment hostiles.
Deux autres écrits majeurs sont composés pendant cette période d’inaction relative, L’art de la guerre et les Discours sur la première décade de Tite-Live. L’absence de datation précise complique la tâche qui vise à les situer comme ses textes précédents dans la continuité de son projet. Alors qu’il entendait dédier Le Prince aux Médicis (Julien ou Laurent selon les moments), les Discours s’adressent aux jeunes patriciens avec qui il converse dans les jardins Rucellai avec le souhait de leur transmettre son expérience. Il ne suit pas méthodiquement les chapitres de Tite-Live mais choisit, parmi les faits, les figures héroïques du passé, les lois qui conservèrent la vertu de cette république, tout ce qui peut refléter le présent de Florence, et œuvrer ainsi à sa survie. Il prend le contrepied de l’opinion commune sur les Romains, par exemple quand il rappelle l’importance du peuple, le nerf de la force qui a permis à cette petite cité d’étendre son empire et de repousser toutes les menaces ennemies pendant des siècles sans faire appel à des troupes étrangères. Ce qui lui permet d’établir un lien entre liberté, tumultes, bonnes lois, bonne fortune et bonne armée. Loin de déplorer comme les historiens de Rome les conflits entre le Sénat et la plèbe, il juge que l’action des tribuns a eu des effets bénéfiques tant qu’elle a permis de maintenir un équilibre des « humeurs » au sein de la cité, mais est devenue négative avec l’affaire des Gracques, qui n’ont pas su forger une alliance avec le peuple. D’où l’importance d’analyser les conflits endémiques de la société florentine, alors que la tradition politique met l’accent sur la concorde et refuse de penser la nécessité du recours à la force dans les situations d’urgence. La république romaine élisait des dictateurs à titre temporaire pour remettre de l’ordre, mais « les tribuns, les consuls et le sénat conservaient leur autorité, et le dictateur ne pouvait pas la leur enlever ».
Les Discours sont un texte de combat. Principaux accusés, la faiblesse des armes italiennes, l’ignorance des ordres anciens, les « péchés » des princes. Les Suisses y figurent aux côtés des Romains pour la vertu de leurs armes propres, contre Athènes, Sparte, Carthage ou Venise. Les meilleurs régimes étant vulnérables à la corruption, ils doivent se renouveler par un retour régulier à leurs fondations s’ils veulent résister à l’usure du temps cyclique.
Certains des avis de Machiavel varient en fonction de la conjoncture – « les forteresses peuvent donc être utiles ou non, selon les temps » – mais il reste constant sur les grands axes de sa pensée politique. Les trois essais se complètent, et se répètent en partie, d’où aussi de nombreuses redites dans le commentaire qui les étudie de près. Dans L’art de la guerre, le seul des trois publié de son vivant, Machiavel insiste sur le lien d’amour qui doit unir les soldats à leur patrie et à leurs chefs pour garantir la vertu des armes, et il explicite le modèle d’ordinanza qu’il préconise, capable à la fois de se battre « à portée d’épée » comme les Romains contre l’infanterie ennemie, et avec des piques comme les Suisses contre la cavalerie.
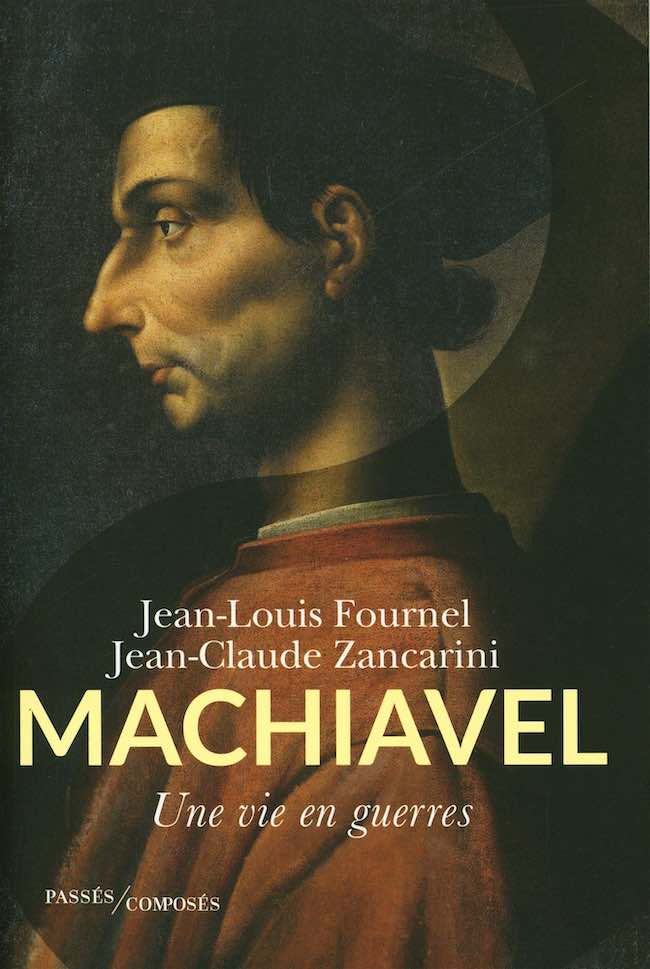
Après huit ans de pénitence, Machiavel entre au service des Médicis comme historiographe de Florence, et bientôt il donne son point de vue sur les institutions florentines dans un Discursus florentinarum rerum. L’essentiel pour lui c’est le Grand Conseil, qui permet aux citoyens de participer au gouvernement de la république, tandis que les Médicis garderaient le contrôle de la police et des armées, car jamais il n’est question de laisser le peuple prendre le pouvoir. Faute de s’allier à l’universale des citoyens, ils s’exposent à « mille désagréments insupportables » car il y a dans la cité « une très grande égalité ». Mais une conjuration met fin à l’éventualité alors en débat d’un retour aux institutions républicaines.
C’est au cours des missions modestes qu’on lui confie désormais qu’il noue une amitié avec Francesco Guicciardini, futur auteur de l’Histoire d’Italie, malgré leurs divergences intellectuelles et politiques. Leurs échanges épistolaires traitent aussi bien des « choses du monde » que de leurs affaires privées, sentimentales ou financières, et des travaux littéraires de Machiavel, moins éloignés de sa réflexion politique qu’il n’y paraît. Ainsi, La Mandragola, que Guicciardini lui offre de faire représenter au carnaval de Faenza, développe sur le mode comique une action qui permet à l’héroïne de culbuter la fortune, changer de nature et parvenir à ses fins.
Les Histoires florentines sont un exercice délicat quand il faut raconter celle des Médicis sans offenser les maîtres présents de Florence ou de Rome, ni réduire leur responsabilité dans les divisions permanentes de la cité en sectes et partis, toujours nocives car indifférentes au bien commun, alors que celles des anciens Romains ont pu donner naissance à de bonnes lois. Quand la capture de François Ier à Pavie met toute l’Italie à la merci des troupes de Charles Quint, Machiavel persuade le pape Clément VII, encore un Médicis, de créer une ordinanza en Romagne, mais les conflits toujours vifs entre guelfes et gibelins rendront la chose difficile, objecte Guicciardini, et en effet, moins de deux mois plus tard, le projet est enterré. L’année suivante, Machiavel est chargé d’organiser les fortifications de Florence. Il se dépense sans compter, négocie, court d’une garnison à l’autre. La ligue de Cognac se constitue contre les troupes impériales, mais le pape et les Florentins espèrent encore acheter la paix à prix d’or, tandis que les Français comme les Vénitiens se montrent peu enclins à se battre pour des alliés aussi timorés. La suite donne tristement raison à l’auteur de L’art de la guerre.
Pour Fournel et Zancarini, le fil rouge de la vie de Machiavel, c’est l’enchaînement de ses écrits. Tous, dans leurs genres divers, vont dans le même sens : « Il s’agit toujours de sauver la république et de l’ordonner, quelles que puissent être les nécessités de la fortune. » On ne saurait souhaiter meilleur sort à leur livre que de guider nos politiciens dans une relecture éclairée des Discours sur la sauvegarde des républiques.











![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)
