Trois revues qui donnent envie de penser, de remettre en cause les fausses évidences, de relire aussi : Tracés considère l’enjeu central de l’angoisse, Germinal la place et le rôle du politique et Europe consacre une livraison à Virginia Woolf.
Tracés, n° 38
Voici avec Tracés une revue trop confidentielle mais qui a le mérite de traiter de faits de civilisation avec l’originalité et le sérieux qui conviennent à de jeunes chercheurs. L’appel à des cas de figure qui remettent l’angoisse au cœur du rapport à l’institution et de la production sociale dans son cadre autant politique que d’individuation rend la lecture plus productive encore que l’on ne croirait. L’angoisse n’est pas la peur, qui a un objet, et cette approche se distingue nettement du numéro du Centre de création industrielle de Beaubourg et de sa revue Traverses qui réalisa en 1982 un numéro sur la peur. La société bouge, le positionnement du sujet plus encore. Les peurs d’époque, du cancer à la guerre, des bombardements de 1944 vus par Pierre Pachet enfant au guerrier de l’Antiquité étudié par Nicole Loraux, accompagnaient une méditation sur l’échange impossible de la sécurité/insécurité dans le cadre d’un néoconservatisme asservissant, Paul Virilio et Jean Baudrillard à la clé.
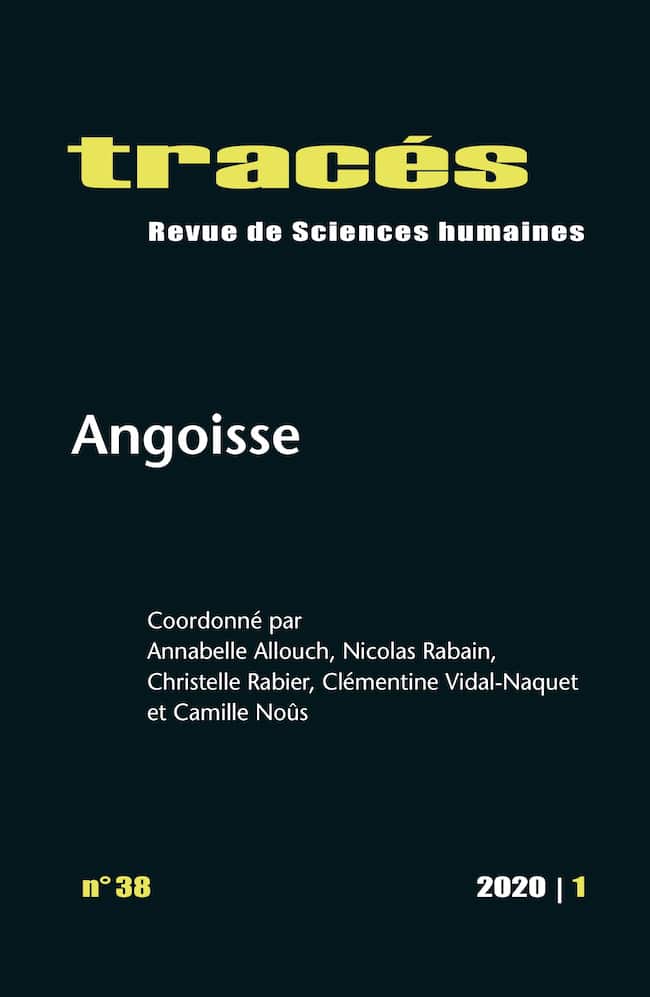
L’angoisse de ce numéro de Tracés est non pas une « trace » ou un marqueur de notre temps ; elle est traquée dans sa puissance ontique, personnelle, intériorisée, qui relève autant du lien de l’individu à la société que de la psychanalyse. Cette configuration a certes été posée dès 1981 par Robert Castel comme inhérente au néolibéralisme, mais les cas de figure choisis ici donnent un aperçu de nouvelles modalités d’insertion de tous et de chacun, qu’il s’agisse de parents de mineurs transgenres, statistiquement rares, ou de jeunes professeurs des écoles, nettement plus nombreux, ou encore de lieux de pouvoir auxquels on ne songe guère, comme l’élite dominante de la Singapour postcoloniale. « Faire du stress son métier » est aussi le lot des artistes et des musiciens qui remettent en jeu leur jeu, leurs émotions, le corps qui pense et joue à chacune de leurs performances.
On ne dira pas que la réussite de ce numéro est de faire vivre au lecteur l’angoisse dont il est question, mais de le faire réfléchir en fonction de ce qu’il a lui-même expérimenté. Ce retour aux sciences humaines devient la reconnaissance de la Kulturwissenschaft. La bibliographie, avec Kierkegaard et Freud outre l’intuition sur le rôle des formes par le retour à Aby Warburg et à Ernst Cassirer, rend ce numéro indispensable à quiconque travaillera sur des configurations anxiogènes, dans la plénitude des basculements de la phobie à l’angoisse. On dira plus encore que ce numéro toujours clair et de haute tenue aide chacun de nous à situer, à objectiver donc, ce que tout l’environnement entend lui faire intérioriser. Les sciences humaines en reprennent leur meilleur sens. M. B.
Plus d’informations sur la revue Tracés en suivant ce lien.
Germinal, n° 1
Toute nouvelle revue relance nos appétences de lecture, et c’est toujours une bonne nouvelle, a fortiori quand elle n’est pas parisienne, et c’est une équipe décalée mais très normalienne, d’ailleurs fortement signalée comme telle en des temps où l’on décrie tout individu marqué d’une vraie formation. Ce groupe nanti d’une quarantaine de talents et posé sous les auspices de Patrick Boucheron, Philippe Descola et Patrick Weil (pardon à tous ceux qui ne sont pas nommés) a sorti un livre-revue d’une belle maquette – cela compte aussi – aux presses du Bord de l’eau, sises à Lormont près de Bordeaux. La quatrième de couverture se targue de promouvoir une « république écologique et sociale », charmant vœu pieux qui n’a jamais fait de mal à quiconque, mais les modalités de la réflexion nous importent davantage. L’alternance de textes de fond, les témoignages et la diversité des générations qui participent au volume sont rafraîchissants.
Saluons d’abord le respect porté à un fait de société récent, les Gilets jaunes, dont l’écho est donné par des témoignages de protagonistes variés de lieux, d’âges et de pratiques. Ces femmes et ces hommes pensent le monde avec dignité et deux ans de recul font que plus personne ne se permet de les inférioriser. On peut avoir des adversaires, non des ennemis, sauf à dériver vers les « populismes », terme qui hante les analystes de toutes les disciplines.
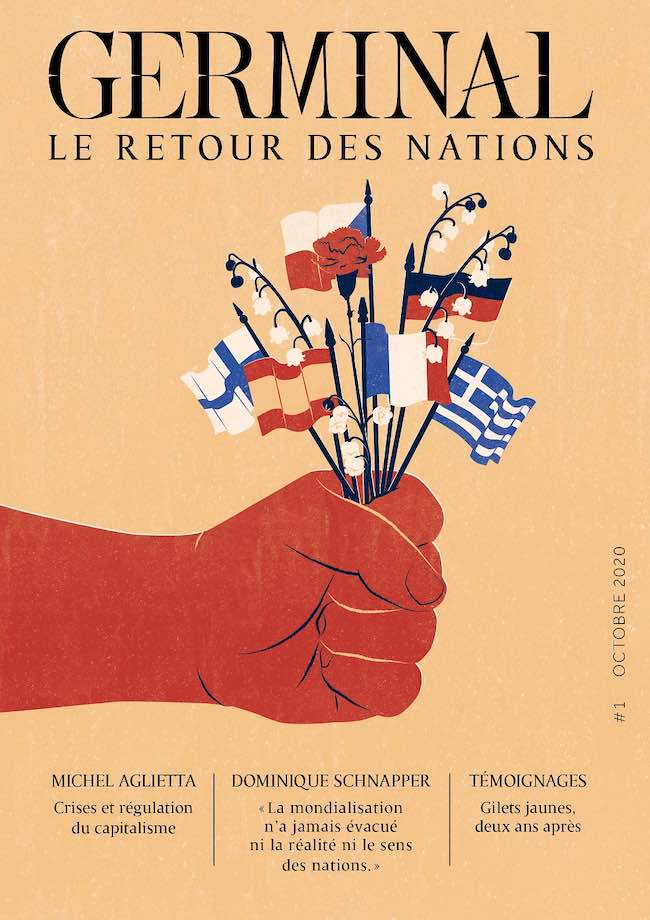
Le volume envisage la matrice morphologique de nos sociétés et les règles possibles, tant dans l’espace et le temps que par leurs formes. Des affaires d’échelle pour les juristes et les spécialistes du travail, d’époque aussi pour les déterminations sociétales scrutées par les historiens. Le tour d’horizon récapitule les régulations et les sociabilités politiques possibles, la protection, le statut du travail en prise avec le marché. Les présentes mutations ouvrent des horizons pour le pire comme pour d’évanescents espoirs. Mais point de nostalgie possible pour des formes toujours remaniées que savent évoquer avec précision et fluidité tant Thomas Branthôme pour sa réflexion sur la nation, « soleil noir de la modernité », parcourant les derniers siècles que le même Thomas Branthôme cavalcadant sur les millénaires avec Alexandre Escudier drapé dans le langage et l’hommage à Jean Baechler ; et, en vieux professeur qu’il est, Michel Aglietta reprend les mécaniques possibles face aux bouleversements du présent avec une absolue limpidité. Les exemples fusent, les perspectives et références oubliées interrogent les possibilités de reconstruction du monde, jadis la petite ville puis la nation comme des échelons moyens pas seulement perçus comme obsolètes vu leur fonction entre un amont et un aval, les capitalisations et prédations d’hier parallèlement aux systèmes qui font lien et ne sont pas que rapports de force. Oui, c’est bien de tout cela que nous avons besoin pour tenir un discours de cohérence – un discours cohérent, et un discours qui ne nie pas des portions entières de nos concitoyens ou de l’humanité quand se déplacent des problèmes.
Et c’est bien l’effort pour tenir tout ensemble, le travail, la monnaie, les rapports sociaux, l’entreprise, la financiarisation, le désir d’argent, outre les rapports de puissance à puissance, qui devient la tâche de l’intellectuel. C’est pourquoi chacun dans sa spécialité se fait un point d’honneur de restituer le mécano conceptuel du temps, le nôtre, celui des médias, en se tenant hors du babillage ordinaire. On en revient alors au poids politique de la monnaie, l’échangeur inévitable des pratiques de la financiarisation et de ses effets sur le travail. Politiquement en suspens et au cœur des fonctionnements possibles entre société concrète lourde des besoins de redistribution et la petite échelle des rivalités sino-américaines dans laquelle l’Europe navigue, le volume laisse le lecteur à ses méditations sans trop se leurrer au sujet de la meilleure à la pire des hypothèses. M. B.
Plus d’informations sur la revue Germinal en suivant ce lien.
Europe, n° 1101-1102
En un temps de confinements prolongés, il est judicieux de lire le numéro que la revue Europe consacre à Virginia Woolf essentiellement, et à Jean-Paul Goux : il faut prendre des « notes sur la vie », réaménager le monde ou le regard porté sur lui. L’attention vigilante de Woolf « à la chose qui est là et en dehors de nous » s’y prête ; la matière même de ses textes structurés par le temps et la mort – ce qu’Annie Ernaux nomme « le gouffre du temps » – oblige à la réflexion. La plasticité de la phrase semblable « à la vie qui est un halo lumineux, une pellicule diaphane qui nous enveloppe de l’aube de la conscience à sa fin », la nuée de pensées, cet essaim en perpétuel mouvement, traduisent une polarisation particulière autour des sensations, des émotions, et des perceptions formées par un langage constitué de « mots vivants » qui traversent les corps.
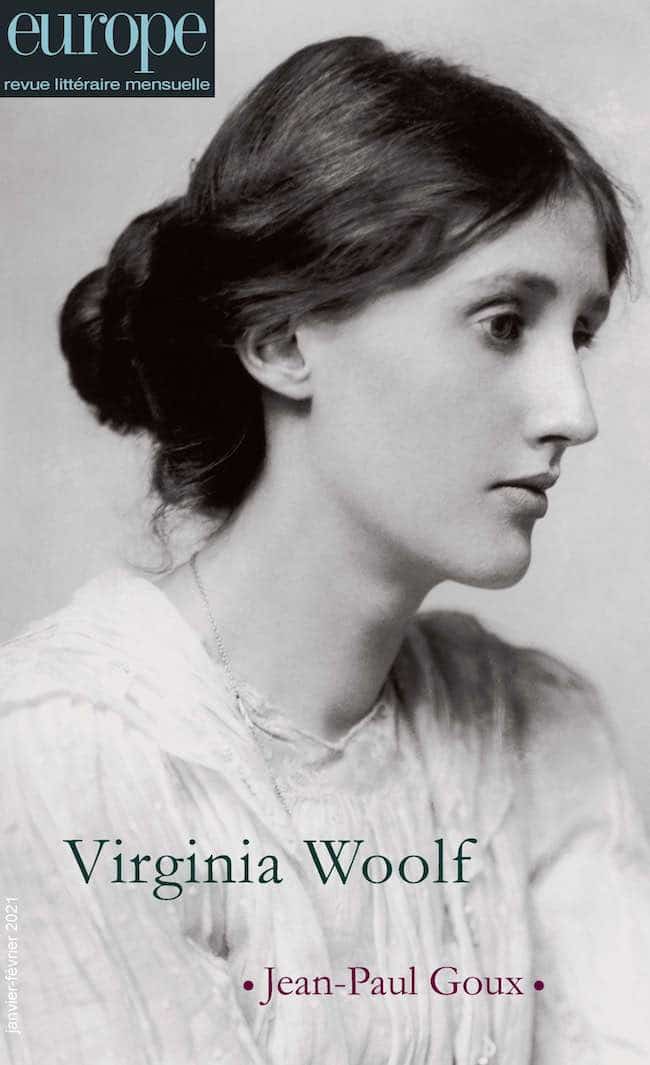
Qu’il pleuve à verse sous un brouillard évanescent pour l’une, que l’endroit soit piteux, « on aurait dit un décor de manège, bondé » (le Cheddar dans le Somerset), pour l’autre, la correspondance de Virginia Woolf avec sa sœur, Vanessa Bell, est passionnante, Elles parlent de tout, de rien, avec légèreté ou gravité, se languissent de leurs promenades le long de la falaise, décrivent ce qu’elles viennent de faire, le long d’une « corniche tout au bord d’une crevasse rouge ». Virginia précise qu’elle n’a « aucune envie de périr ». Qu’elles évoquent « des passions irrationnelles et muettes », s’inventent des images à partir de la forme des vagues, qu’elles dissertent sur la pensée de Moore, de Browning, ou sur la chance de se marier, voire sur le rythme, le soin apporté à une lettre, la peine d’une fillette « racrapotée » dans le train, tout concourt à nous faire envier l’intimité qui se profile, et à nous convaincre que l’on n’écrit « qu’à une seule personne ».
« Oui, je crois que je me suis résignée à l’idée que je ne serai jamais un écrivain populaire […] J’écrirai ce qui me plaît, et on en pensera ce qu’on voudra. » « Un journal à la page », de Frédérique Amselle, imagine un rapprochement étonnant entre Woolf et Agamben, dans un essai convaincant sur la contemporanéité.
Quant à « l’histoire d’un haut-le-cœur » éprouvé par Woolf à la lecture du manuscrit de Joyce, Ulysse, elle est exemplaire. L’écrivaine trouve que le roman est une « fumisterie », et ne conçoit pas la nécessité de le lire, alors qu’elle est plongée avec ravissement dans Proust !
Il y a une parenté entre le roman anglais et le roman français. Il n’est qu’à saisir la proximité féministe entre The Years et Les années.
Certes, occuper une chambre à soi, n’est-ce pas la promesse, in fine, d’évoluer, comme d’accéder à son propre désir ? S. R.-J.




![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)







