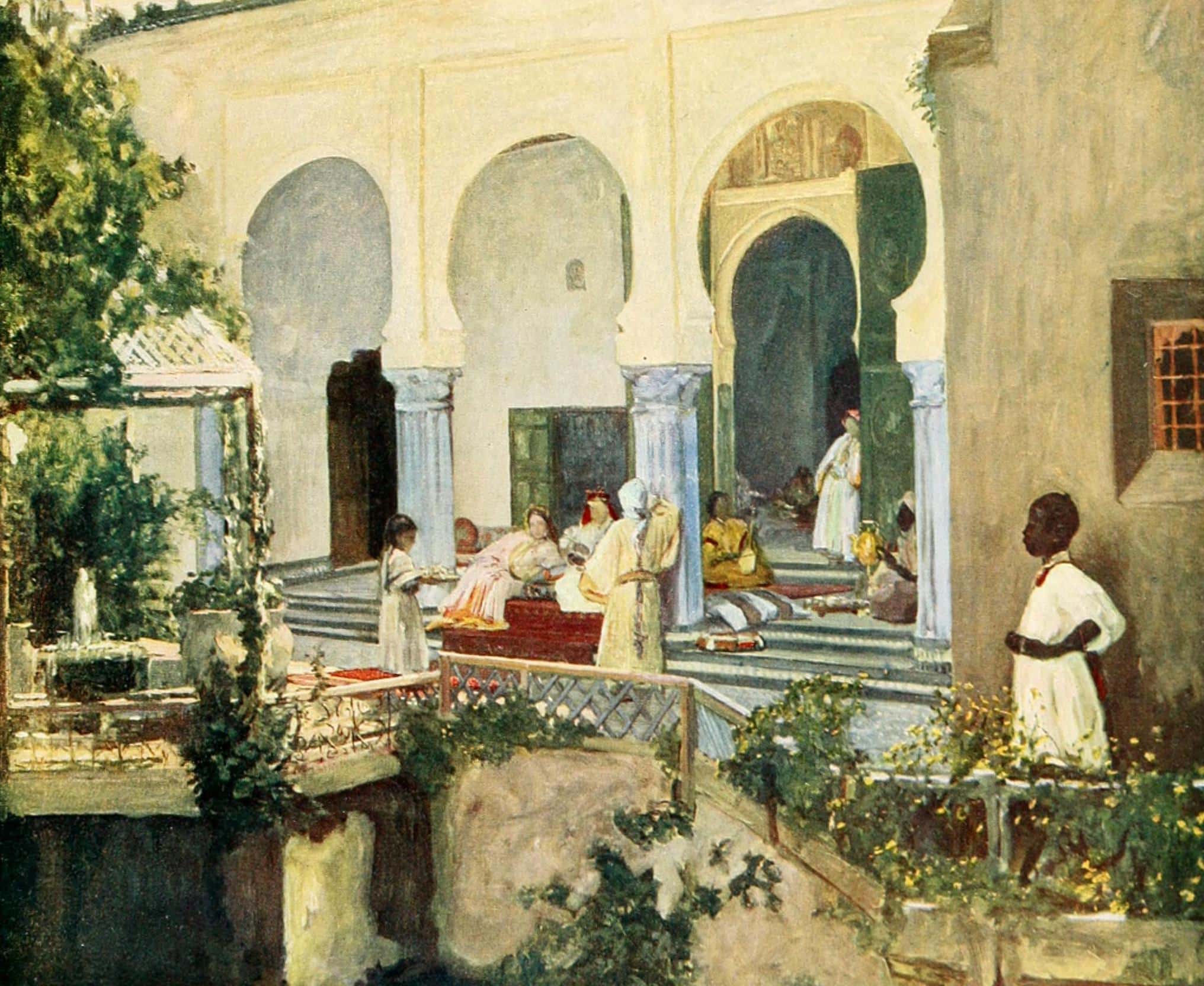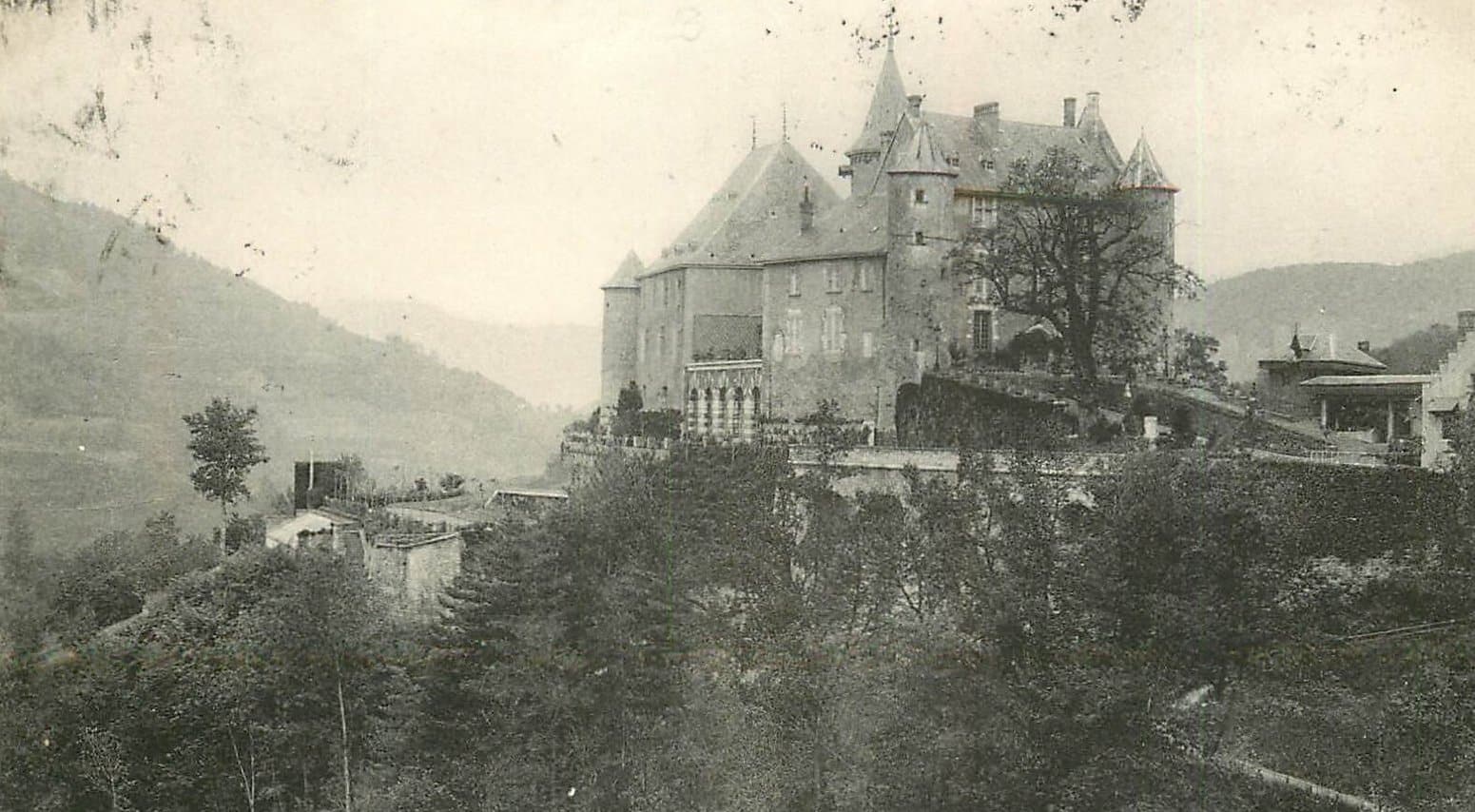Deux livres ont été laissés par Jacques Le Brun au moment de sa mort, en avril 2020. Le premier, Le Christ imaginaire au XVIIe siècle, aurait pu ne pas être le dernier d’une série de livres – La jouissance et le trouble et Sœur et amante. Les biographies spirituelles féminines du XVIIe siècle (Droz, 2004 et 2013) – dans lesquels l’auteur avait entrepris depuis plusieurs années de ressaisir les fils directeurs d’une vie de travail. Le second, au contraire, n’a très probablement vu le jour que parce que Jacques Le Brun avait perdu la vie : La chapelle de la rue Blomet est essentiellement un ouvrage posthume, non pas inachevé, mais destiné à n’être ouvert que comme un testament.
Jacques Le Brun, Le Christ imaginaire au XVIIe siècle. Jérôme Millon, 222 p., 19 €
Jacques Le Brun, La chapelle de la rue Blomet. Les Belles Lettres, coll. « Encre marine », 96 p., 16,90 €
Aussi, seule la contingence de la mort, soudaine (le Covid-19 a emporté Jacques Le Brun en quelques jours), réunit ces deux ouvrages. S’il ne faut pas les séparer ici, c’est parce qu’entre eux circule une secrète assonance, dont on pourrait faire entendre la tonalité majeure en disant qu’elle nous dit ce que cela peut signifier d’être « historien », et ceci d’autant plus profondément peut-être que Jacques Le Brun était un « agrégé des lettres », selon la désignation antérieure à 1959, et que l’histoire fut donc pour lui comme une sorte de vocation que l’on ne saurait réduire à une domiciliation disciplinaire ; elle fut plutôt une certaine manière d’habiter une culture aussi bien littéraire que philosophique, théologique qu’anthropologique, ou encore (mais pas moins) psychanalytique.
Le Christ imaginaire au XVIIe siècle, qui réunit huit études échelonnées sur plus d’une trentaine d’années, raconte l’épuisement progressif du « grand récit » évangélique. Par celui-ci, le Verbe incarné disait tout ce qu’il fallait savoir de lui et s’auto-suffisait dans l’expression d’une vie confondue avec une parole. On voulut cependant en savoir plus, dans une irrésistible tentation de basculer ce Verbe incarné dans un corps sanctifié – puisque aussi bien il vaut mieux s’adresser à ses saints qu’au Bon Dieu. Mais tout cela, les narrateurs de la vie de Jésus ne le firent qu’avec crainte et tremblement, ne cessant de consumer leur plume dans une révérence inquiète à ce grand récit auquel ils auraient dû se tenir, jusqu’à ce que finalement le Jésus de Renan, en 1863, achevât la conversion humaine, trop humaine du Fils de Dieu.
C’est cependant un terme hors champ, car Le Brun reste pour l’essentiel attaché au XVIIe siècle, dans lequel il lui semble pouvoir observer tout à la fois l’amplification et le crépuscule de ce procès en biographie de Celui qui dictait la vie. Être historien, ici, c’est faire apparaître comment les marges du récit évangélique – et d’abord l’enfance de Jésus, qui est au cœur de ce livre – finissent par en dévorer le centre, mais c’est aussi se demander pourquoi, au-delà de l’aspiration aux saints qui traverse toute la geste chrétienne, ce centre est à ce point débordé. C’est bien parce que le tombeau est vide qu’il faut, assis sur sa margelle, raconter des histoires, combler ce vide, et c’est bien pour cela aussi que l’histoire de ces histoires est peut-être toujours déjà à l’épreuve d’un épuisement.

Jacques Le Brun (2019) © Jérôme Panconi
Mais c’est bien pour cela aussi – et ce fut une constante du travail de Jacques Le Brun – qu’il est très difficile de prononcer la fin de l’histoire. Repensons par exemple au dernier des livres qui, pour lui, après Le pur amour de Platon à Lacan (Seuil, 2002) et Le pouvoir d’abdiquer. Essai sur la déchéance volontaire (Gallimard, 2009), s’inscrivait dans cette quête anachronique d’un retour de l’histoire sur ses propres pas : Dieu, un pur rien. Angelus Silesius, poésie, métaphysique et mystique (Seuil, 2019). Dans ce livre, Le Brun s’intéressait à la répétition poétique d’une écriture théologique désenchantée par le déchirement de la chrétienté, et qui, cependant, par ses ressorts, réveillait de ses cendres une théologie qui, elle-même, dans les nécessités de sa propre langue, avait pu user de ces métaphores qu’elle pensait vives, et que le poète revivifiait, en quelque sorte in extremis.
Si faire histoire, c’est cela, si c’est parcourir dans les deux sens un espace de temps dans lequel le terme révèle l’origine en révélant dans cette origine le terme qu’elle contenait déjà, alors La chapelle de la rue Blomet pourra, sans nul doute, être lu en toute intimité avec Le Christ imaginaire. Car ce petit livre peut être compris – ouvrons une voie, ce sera au lecteur d’en découvrir mille autres – comme le récit d’une entrée en histoire, ce qui était plus haut appelé une vocation.
Ici, ce n’est pas le tombeau qui est vide, c’est une chapelle, dans laquelle se rend, enfant, celui que le récit désigne comme un « il » – peut-être parce que ce récit nous parvient depuis une autre rive ? L’enfant est dans la chapelle, il lève les yeux qu’il ne devrait pas lever au moment où seul le sacrement s’élève, et il ne voit rien ; ou plus précisément, il voit « rien ». Mais il découvre aussi, dans ce moment de solitude, que seules les hauteurs de la chapelle sont vides. En bas, il y a du monde, il y a la communauté des fidèles. Et l’enfant songe alors, dans un surprenant retournement – qu’il découvre ou qu’il révèle, peu importe, dans cette spirale – que c’est parce qu’il n’y a rien à voir qu’il faut faire corps car ce corps tient lieu de ce qui n’est pas. L’enfant ressort de cette chapelle – il a alors sept ans – athée et chrétien. Comment cet oxymore se défera lui-même, la suite du récit le dira. Mais ce qu’il importe ici de souligner, c’est que c’est de ce corps-là, l’Église, que Jacques Le Brun décidera de faire l’histoire, et que cela ne peut être qu’une histoire, tendue entre deux vides, celui d’un tombeau et celui des hauteurs d’une chapelle.
Il y a aussi un autre corps dans ce livre, celui de « il ». Il y a aussi d’autres histoires, d’autres héritages. Il y a beaucoup de choses, et sans doute en aura-t-on vu rarement autant dans un aussi petit livre, qui ne se résume pas. Mais on pourra ensuite revenir au Christ imaginaire, circuler entre ces deux livres (par exemple, entre cet enfant-là et l’enfant Jésus, telle ou telle autre effusion de sang, tel ou tel autre cœur enveloppé sur son secret), sur une table toute désolée de la mort de leur auteur, mais consolée de cette circulation, du duo qui s’instaure entre ces deux derniers chants, les plus beaux à l’exception de tous ceux que nous avait déjà donnés Jacques Le Brun dans le cours d’une vie longue et brève.