Deux ouvrages stimulants questionnent les bouleversements que les publications scientifiques ont connus historiquement et plus récemment. Dans Au bureau de la revue, Valérie Tesnière analyse méticuleusement les différentes mutations qui ont affecté un tel support depuis le XIXe siècle. Par l’entremise d’une histoire matérielle, elle redonne toute sa place à cette forme particulière dans l’économie de la connaissance. Le livre collectif dirigé par Étienne Anheim et Livia Foraison, L’édition en sciences humaines et sociales, complète le premier ouvrage en livrant un diagnostic fouillé de la « phase critique » aujourd’hui à l’œuvre dans le secteur éditorial.
Valérie Tesnière, Au bureau de la revue. Une histoire de la publication scientifique (XIXe-XXe siècle). EHESS, coll. « En temps & lieux », 416 p., 25,80 €
Étienne Anheim et Livia Foraison (dir.), L’édition en sciences humaines et sociales. Enjeux et défis. EHESS, coll. « Cas de figure », 400 p., 15 €
S’il fallait se persuader du postulat de Valérie Tesnière, une « histoire matérielle au long cours des pratiques intellectuelles », il suffirait de lire quelques-unes des lettres échangées par Georges Bataille et Éric Weil lorsqu’ils s’occupaient conjointement de Critique (éditées par Sylvie Patron dans À en-tête de Critique, Lignes/IMEC, 2014) – une revue curieusement absente de l’ouvrage. On y voit à l’œuvre, semaine après semaine, la fabrique concrète de la revue – choix des livres à recenser, des auteurs à solliciter, de l’imprimeur à changer, etc. – et on y devine l’incidence naissante de celle-ci sur l’histoire des idées.
Nul besoin en effet de défendre aujourd’hui la thèse que les savoirs ne sont pas transparents et que leur matérialité joue un rôle indéniable – l’histoire et l’anthropologie des pratiques savantes l’ont amplement démontré depuis longtemps. Valérie Tesnière s’inscrit ainsi à la suite d’une telle perspective, notamment une histoire du livre qui a ses titres de noblesse (Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, Roger Chartier, Robert Darnton) et ses renouvellements récents, notamment en Allemagne (par exemple Oliver Römer sur l’histoire éditoriale de la sociologie et Morten Paul sur l’éditeur Suhrkamp).
De fait, son analyse est particulièrement solide, documentée et érudite. Si l’ouvrage se focalise davantage sur un long XIXe siècle et relègue quelque peu les sciences sociales à l’arrière-plan – peu de revues de sociologie, de géographie, d’ethnologie et d’économie font l’objet d’une véritable attention –, il dissèque néanmoins très finement les évolutions – oubliées pour certaines – qui régissent un tel support éditorial. Dans les communautés savantes, publier n’allait pas de soi, l’oral ayant longtemps été prisé. Ce n’est donc qu’à partir des années 1850 que le périodique est devenu un mode de communication reconnu, une mutation qui s’explique également par un idéal de démocratisation des connaissances et l’essor de la presse.
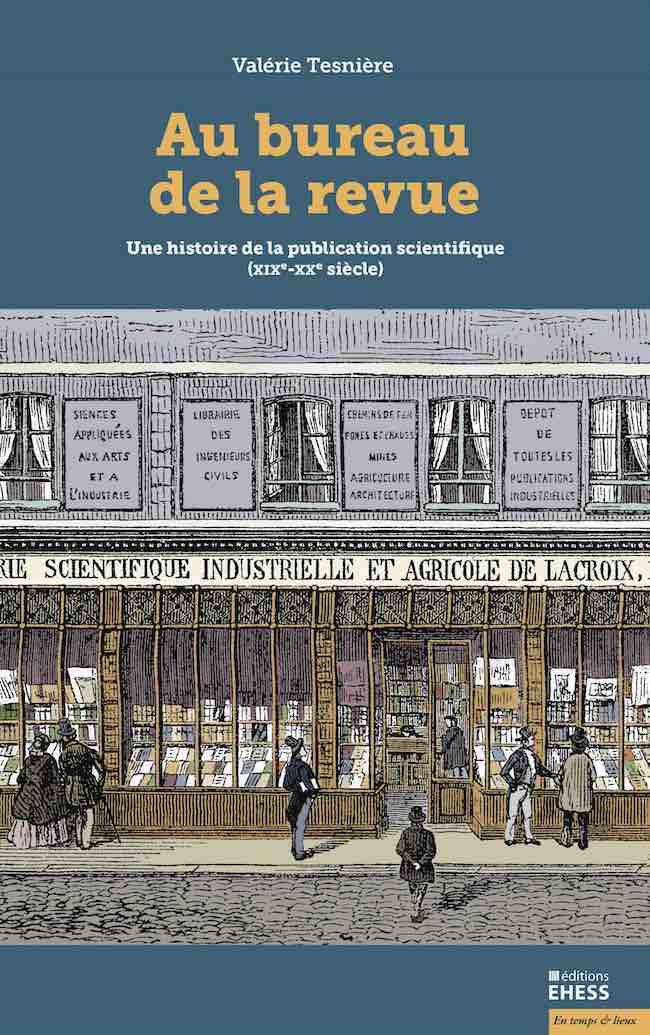
Mais le développement des revues scientifiques s’ancre surtout dans des logiques internes, puisqu’elles deviennent des instances de légitimation où se joue l’obtention d’une reconnaissance par les pairs. Se constitue en somme « une économie de la connaissance ». Alors que la création des revues était initialement le résultat d’actions individuelles de professeurs d’université ou d’entrepreneurs de science, comme les frères Dalloz dans le domaine du droit, la situation change à partir des années 1880. Désormais, « l’université française et les institutions qui s’y rattachent sont montées en puissance » et « la revue sert les carrières académiques des uns et des autres, favorisant les élections à l’Institut ou à des chaires universitaires ».
Un des intérêts majeurs de l’ouvrage réside dans cette étude des dispositifs matériels qui ordonnent ce support : présentation du périodique avec mention ou non des directeurs, des comités de rédaction ou de lecture – peu fréquents avant 1914 –, tirage moyen du titre, ce qui suppose la définition d’un lectorat, etc. Valérie Tesnière s’attache longuement à deux caractéristiques qui fondent une telle économie de l’écrit : la forme du sommaire et celle de l’article scientifique. Le sommaire pourrait paraître anecdotique ; l’auteure montre qu’il n’en est rien. L’organisation de ce dernier dévoile « mieux que toute autre source l’évolution des revues à vocation scientifique au cours du XIXe siècle ». Plus fondamentalement encore, étudier le choix et l’agencement de rubriques permet de récuser la distinction entre histoire matérielle et histoire intellectuelle des savoirs, l’une et l’autre étant intimement liées. L’auteure convoque le cas de Théodule Ribot, qui s’inspire de Mind, « tant sur la forme que sur le fond », pour créer la Revue philosophique et promouvoir son approche psychologique.
L’enquête, déjà considérable, de Valérie Tesnière pourrait trouver ici matière à prolongement ou à déclinaison en montrant davantage en quoi cette organisation traduit une ambition scientifique. Le recours à L’Année sociologique serait particulièrement approprié pour une telle démonstration : dans les premiers numéros, les rubriques et leur désignation résultaient du projet durkheimien de constituer la sociologie comme la science sociale en majesté, comme l’a analysé Thomas Hirsch (Le temps des sociétés, EHESS, 2016). Le sommaire ne peut alors que traduire les soubresauts de la sociologie, notamment après 1945, comme en témoigne l’helléniste Louis Gernet, qui regrette la perte de cette unité organique originelle : « Oui, L’Année Sociologique n’est pas ce qu’il aurait fallu. J’ai été moi-même assez ahuri quand j’ai vu l’empirisme et l’anarchie qui avaient présidé au classement » (lettre à Jacques Berque, 20 novembre 1949).
Il en est de même pour l’article scientifique. Valérie Tesnière explore là encore une des formes majeures de l’érudition contemporaine, dont la structure se codifie essentiellement au XXe siècle. L’injonction académique a pesé de tout son poids : faire carrière, c’est publier. La formalisation, moins précoce en sciences sociales, est également une réponse à la spécialisation des pratiques scientifiques : « un des traits les plus remarquables de l’article contemporain est d’avoir élaboré un système de repères par les sous-titres, les légendes des graphiques, la numérotation des citations, etc. Cela permet à des scientifiques avertis de naviguer aisément dans les différentes parties et d’extraire rapidement les fragments signifiants ou les passages recherchés de théorie, méthode, résultats et conclusions, sans avoir nécessairement lu le texte d’un bout à l’autre ».
Sans attendre l’arrivée d’internet, les revues ont été confrontées à de nouveaux enjeux depuis la Seconde Guerre mondiale. Le renchérissement des coûts d’impression, l’internationalisation du champ scientifique et la prédominance de l’anglais ont accentué ce processus de normalisation éditoriale. L’auteure analyse ainsi comment certains périodiques ont développé des « politiques de “marque” », c’est-à-dire des stratégies de rayonnement international. Dès le début des années 1970, les Annales de l’Institut Pasteur mettent en place un comité de rédaction international et acceptent des articles en anglais, renforçant ainsi la visibilité du titre. L’évolution est rapide : si « en 1972, la revue a publié dans l’année 96 articles, dont 18 en anglais », en 1984 tous les textes sont rédigés dans cette langue – une évolution enregistrée avec l’incorporation de la revue dans le groupe éditorial Elsevier, qui souhaite pénétrer le marché français. En sciences humaines et sociales, la même politique est désormais à l’œuvre, bien qu’elle ait été développée plus tardivement. Les Annales, titre de référence dans la discipline historique, ont développé une version anglaise et, plus récemment, un partenariat avec Cambridge University Press. Différence significative toutefois entre les deux revues, les Annales gardent une version en français, ce qui témoigne que le type de lectorat visé par les sciences humaines ne recoupe pas celui des sciences physiques, biologiques ou médicales.

Ce faisant, l’historienne rejoint ici le vaste panorama dressé par L’édition en sciences humaines et sociales, qui multiplie les études de cas. Sans surprise, les deux ouvrages s’accordent sur un même diagnostic : internet et l’augmentation exponentielle du nombre de publications en ligne engagent de nouvelles formes de communication du savoir ; de nouvelles formes de travail et de lecture également. C’est tout l’intérêt des deux livres que de redessiner la cartographie des questionnements autour de ces transformations. Quand Valérie Tesnière souligne la fragmentation du contenu des revues avec la généralisation de l’accès en ligne – ce qu’on peut comprendre à sa suite comme la remise en cause d’un travail collectif, à savoir la constitution d’un dossier cohérent pour chaque numéro –, le collectif dirigé par Étienne Anheim et Livia Foraison s’appesantit sur les enjeux de la science ouverte et de ses nouveaux usages (plateformes de diffusion, archives ouvertes, réseaux sociaux académiques). L’édition en sciences humaines et sociales complète et prolonge donc utilement l’entreprise de Valérie Tesnière, en recourant notamment au témoignage des acteurs de la chaîne éditoriale : traducteurs, éditeurs, directeurs de publications, bibliothécaires, etc., des noms qu’il faudrait féminiser tant la place des femmes y est prépondérante.
Les deux ouvrages, denses et foisonnants, regorgent de renseignements et de connaissances – d’où l’aspect itératif de certains développements – mais ouvrent finalement le questionnaire plutôt qu’ils ne le referment. Valérie Tesnière paraît plus circonspecte sur le devenir de publications scientifiques fragiles (notamment dans le cas français), qui « ont depuis longtemps perdu la partie » par rapport aux différents lieux de débat sur internet. Étienne Anheim et Livia Foraison soulignent néanmoins qu’on « n’a jamais publié autant de sciences humaines et sociales que dans les dernières années » et « jamais il ne s’en est autant lu, sur du papier ou sur des écrans ».
Quel avenir alors pour la publication scientifique entre revues de flux et de dossiers, exerçant pour certaines un pouvoir crucial sur les carrières ? Grand cas a été fait récemment de la disparition de certains titres – Les Temps modernes, Le Débat –, mais c’est oublier que les revues meurent aussi ; et surtout que de nouvelles publications apparaissent : Les Carnets du paysage (Actes Sud), Sensibilités (Anamosa), Zilsel (Éditions du Croquant), pour ne mentionner que trois revues dans des domaines différents qui sont aussi de très beaux objets. Peut-être qu’un avenir qui échapperait en partie à l’atomisation des contenus en ligne et à la normalisation des standards internationaux passe par la création d’interstices idiosyncrasiques, à la fois matériels et intellectuels ; à la manière de certaines revues – les Actes de la recherche en sciences sociales pour ne citer qu’elle – qui avaient su inventer de nouvelles formes et vivifier le débat d’idées.







![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)
