Dans la profusion des livres qui ont paru ces derniers mois autour du bicentenaire de la mort de Napoléon, en voici un qui tranche. Par sa masse d’abord : 880 pages de texte, 30 cartes, 180 pages de notes, 60 de bibliographie (plus de 1 100 titres cités) et 40 pour l’index. Mais surtout par son ambition planétaire et son choix délibéré d’élargir sinon de modifier entièrement la perspective familière. Et, comme pour signifier d’emblée que, malgré son titre, Les guerres napoléoniennes, l’ouvrage d’Alexander Mikaberidze n’est pas centré exclusivement sur la personne et le rôle de l’Empereur, sa couverture relègue l’inévitable image de Bonaparte caracolant au Grand Saint-Bernard dans une sorte de nuit bleue, éclipsé par le disque lumineux d’un monde qu’il ne domine pas.
Alexander Mikaberidze, Les guerres napoléoniennes. Une histoire globale. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Thierry Piélat. Flammarion, 1 184 p., 39 €
L’auteur, né Géorgien, de culture russe, enseignant dans une université américaine et passionné depuis son enfance par le héros français le plus connu dans le monde, incarne par son parcours personnel une forme d’universalité sans frontières. On retrouve celle-ci dans la multiplicité des langues mobilisées pour la bibliographie : les 945 livres ou articles mentionnés au titre de la littérature secondaire ont été publiés dans 16 langues différentes – dont le géorgien, le turc, le bulgare, le danois, le finnois, le suédois, le néerlandais… Il sera donc difficile au lecteur moyen de remonter chaque fois à la source, mais on fera confiance à Alexander Mikaberidze. La majeure partie des œuvres référencées sont heureusement citées dans des langues plus courantes : le français (21 %), le russe et l’allemand (4 % chacun), l’espagnol et l’italien (1,5 et 1 %). La part du lion revient néanmoins à l’anglais (64 %), et c’est peut-être l’un des revers de cette histoire mondialisée : elle est vue largement à travers le prisme de l’historiographie anglo-saxonne, même si cette dernière n’est évidemment pas unanime. Pour le lecteur français, ce peut être une chance de regarder le monde autrement, de relativiser le schéma auquel il était habitué.
À cet égard, on peut regretter que les éditeurs n’aient pas fait l’effort de retrouver les références des éditions originales ou des traductions en français de certains ouvrages disponibles dans notre langue. Il est curieux de se voir renvoyé à des traductions anglaises de Bergeron, Chastenet, Chaussinand-Nogaret, Colson, Godechot ou Madelin ; ou de ne trouver citées que les éditions anglaises d’ouvrages ayant été traduits en français (Englund, Liéven, Hazareesingh, notamment), ou la seule version anglaise d’ouvrages écrits en russe ou en allemand (alors même que certains ont été, de surcroît, traduits en français). Ce défaut serait facile à corriger lors d’une nouvelle édition.

« La bataille de Tudela » par January Suchodolski (1827)
Il y a fort à parier en effet que cette histoire des guerres napoléoniennes, qui est en réalité une histoire des relations internationales à l’époque de Napoléon, servira longtemps de référence. Alexander Mikaberidze s’inscrit dans la suite de quelques grands ancêtres comme Albert Sorel, Émile Bourgeois, Édouard Driault ou André Fugier, côté français, John Holland Rose ou Paul Schroeder côté anglais [1]. Il se distingue cependant de ses devanciers en ce qu’il se limite presque entièrement, après deux chapitres introductifs, aux années proprement napoléoniennes (1799-1815) ; et surtout en accordant une attention bien plus grande aux régions non européennes. Celles-ci sont présentées le plus souvent dans la perspective de leurs histoires particulières et pas seulement comme des enjeux de la grande guerre franco-anglaise, même si cette dernière les affecte largement.
La trame du livre est d’abord chronologique, s’agissant des rapports de la France et des autres puissances de l’Europe, même si certains aspects du conflit se déroulent outre-mer. Puis six chapitres thématiques traitent des marges : la Scandinavie, l’Empire ottoman, l’Iran, les opérations périphériques de la Navy, l’Inde, les Amériques. Les trois derniers chapitres reprennent la trame du récit principal avant le chapitre de conclusion. Et ce sont les parties consacrées au reste du monde qui paraissent évidemment les plus nouvelles : elles fournissent un luxe de détails inhabituels et souvent passionnants, qui élargissent notre perception de l’histoire mondiale et permettent à l’occasion d’éclairer certains enjeux de notre présent. Elles montrent aussi Londres et Paris s’observant de près dans les quatre parties du monde, Napoléon prenant souvent l’initiative, mais étant finalement tenu en échec, pour des raisons liées à la fois aux faiblesses structurelles de la France et à une certaine inconséquence de son action diplomatique.
S’agissant des matières les plus connues, le récit de Mikaberidze, étayé par de très bonnes cartes, est globalement sûr et ses jugements recevables. On regrettera certaines erreurs de détail, qui sont peut-être dues à la traduction (par ailleurs excellente). Une énumération complète serait fastidieuse, mais une relecture attentive devra éliminer ces quelques imperfections [2] pour les éditions à venir d’un livre appelé à faire autorité. On regrettera aussi l’absence de Stein dans le récit des événements de 1812-1813, alors qu’il y tient un rôle essentiel, ainsi que le manque de nuances dans la présentation du rôle de Bonaparte lors du recès germanique de 1802-1803.
Quelques points de forme aussi. Pourquoi écrire plus d’une fois « un historien (anglais, allemand…) écrit », au lieu de le nommer ? Cela éviterait au lecteur d’avoir à chercher dans les notes de qui il s’agit, alors même que le maniement d’un volume de cette taille, imprimé sur papier bible, n’a rien de pratique – et cela d’autant plus que rien n’indique en haut des pages de notes dans quel chapitre on se trouve. Autre point gênant, la manière (de plus en plus répandue, hélas) de désigner le moindre personnage par la kyrielle de ses prénoms, voire de ses titres et noms complémentaires : cela ralentit la lecture sans utilité puisque ces indications sont reprises dans l’index ; on économiserait de surcroît une bonne vingtaine de pages au total.
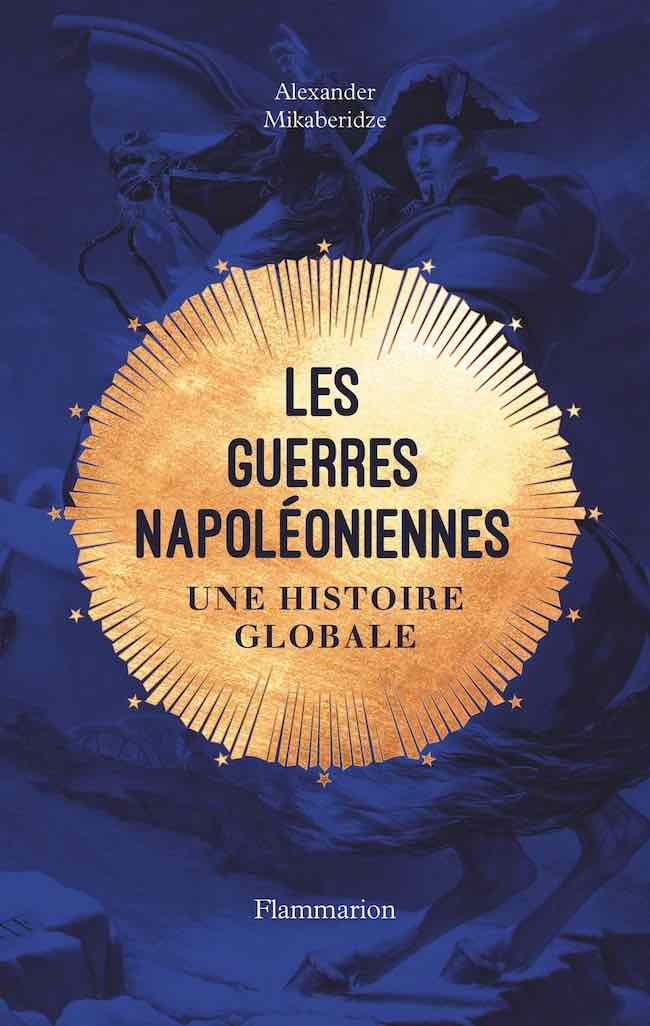
Mais l’essentiel n’est pas là : cette somme remarquable est fiable et quasiment exhaustive. Alexander Mikaberidze montre que « les guerres napoléoniennes », si elles comportent une dimension idéologique héritée de la Révolution française, sont aussi le prolongement de la rivalité séculaire avec la Grande-Bretagne pour la domination de la planète. L’affrontement se déroule sur tous les continents et toutes les mers du globe, comme déjà la guerre de Sept Ans un demi-siècle plus tôt. Il est inexpiable et la France n’avait sans doute pas les atouts pour l’emporter, même si sa domination sur l’Europe, portée par le génie de Napoléon, a pu faire illusion quelque temps.
En 1810, la France ne disposait plus d’aucun point d’appui outre-mer et se trouvait comme enfermée derrière les parapets de la vieille Europe. On ne peut s’empêcher pourtant de se demander, à plusieurs reprises, si les erreurs commises par l’Empereur n’ont pas offert à son adversaire des avantages déterminants : l’abandon des alliances perse et ottomane dans l’ivresse de Tilsit ; l’invasion de l’Espagne qui ouvre un second front terrestre et procure le marché sud-américain aux Anglais ; la désignation de Bernadotte comme roi de Suède ; et la guerre portée en Russie au moment même où les États-Unis déclaraient la guerre à leur ancienne métropole et lui portaient des coups assez rudes. Avec le temps, sans ces erreurs, et grâce au lancement des dizaines de navires en construction à Anvers ou à Venise, un avenir différent était peut-être concevable. Mais Napoléon, c’est le revers de son génie audacieux, et sans doute aussi l’effet de sa jeunesse, n’a jamais su laisser du temps au temps.
Reste le bilan. Ces vingt années auront façonné le visage du XIXe siècle. La Grande-Bretagne sera désormais la seule grande puissance, la Russie remplaçant la France comme sa principale rivale. L’Europe a pris une avance décisive sur le reste du monde : c’est alors que survient la « grande divergence ». De Napoléon, il restera le mythe et le rêve.
Un livre solide et très recommandable, donc, qui témoigne d’un savoir immense et parfaitement dominé, une masse de connaissances qu’il est rare de trouver réunies chez un seul auteur. L’étudiant pourra y recourir comme à un manuel actualisé pour connaître l’histoire internationale de la période dans toutes ses dimensions. Le lecteur curieux y découvrira des épisodes pittoresques, tels que l’odyssée de la frégate Phaéton à Nagasaki, la bataille navale de 1812 sur le lac Érié ou les aléas de la guerre russo-iranienne sur les rives de l’Araxe. Avec d’autant plus de plaisir que le livre est écrit de façon très fluide et se lit aisément.
-
Albert Sorel, L’Europe et la Révolution française, 8 vol., 1887-1904 ; Émile Bourgeois, Manuel historique de politique étrangère, tome 2 : Les révolutions (1789-1830), 1920 ; Édouard Driault, Napoléon et l’Europe, 5 vol., 1910-1927 ; André Fugier, La Révolution française et l’empire napoléonien, tome 4 de Pierre Renouvin (dir.), Histoire des relations internationales, 1954 ; John H. Rose, The Revolutionary and Napoleonic Era 1789-1815, 1894 ; Paul W. Schroeder, The Transformation of European Politics (1763-1848), 1994.
-
Citons ainsi ce Premier ministre George Hammond (p. 73) ou ce Carnot ministre de la Guerre en 1793 (p. 86) ; « Gouverneur » est le prénom de Morris et pas sa fonction (p. 106) ; les Français n’ont pas « pris » trois forteresses en 1800 (p. 129) ; le comte de Boigne était rentré d’Inde dès 1796 (p. 137) ; il n’est pas exact que des princes du Saint-Empire aient soutenu les armées révolutionnaires (p. 155) ; la fraternité n’a pas fait partie de la devise française avant 1848 (p. 156) ; il y a eu 4 500 morts à Eylau, le double si l’on inclut les Russes, non « des dizaines de milliers » (p. 326) ; les « realistas » sont des royalistes et non des réalistes (p. 403) ; c’est l’Elbe (fleuve), et non l’île d’Elbe, qui est bloqué (p. 482) ; la première occupation anglaise du Cap date de 1795 (p. 629), etc.












