Musulmans et non-musulmans paraissent s’accorder sur l’idée d’une irréductibilité de l’islam à la laïcité républicaine. Le sous-entendu étant que la séparation du politique et du religieux est un des acquis de la modernité, l’islam serait ainsi renvoyé vers des positions réactionnaires dont la hantise de la féminité ne serait qu’une illustration parmi d’autres. Voilà de lourds préjugés dont Anoush Ganjipour, dans son essai L’ambivalence politique de l’islam, fait litière. Croyants et incroyants, nous avons tous à y gagner.
Anoush Ganjipour, L’ambivalence politique de l’islam. Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 392 p., 24 €
La distinction christique entre Dieu et César a donné un fondement théologique à la laïcité. Dans la mesure où l’islam la récuse, il nous semble aller de soi qu’aussi bien la laïcité que toute théologie politique lui serait impensable. Pour un musulman, la politique ne saurait avoir la moindre autonomie par rapport à la théologie, celle-ci – et ses serviteurs patentés – devant tout régenter. Ce n’est pas que les Églises chrétiennes n’auraient pas cherché à exercer un pouvoir considérable dans la société, mais l’institution même de l’Église fait de celle-ci un organe différent du politique. Leo Strauss traçait ainsi la ligne de partage entre le christianisme d’une part, le judaïsme et l’islam de l’autre : avec la primauté absolue qu’ils accordent à la Loi (divine), juifs et musulmans partageraient un même refus de toute autonomie du politique, celui-ci n’ayant d’autre liberté que d’appliquer la Loi en faisant de celle-ci la source de toutes ses lois.
Ainsi s’expliquerait la difficulté d’être musulman dans un pays accoutumé à reconnaître une autonomie du politique par rapport au religieux. Les musulmans seraient donc enfermés dans une désastreuse alternative : ou bien abandonner une spécificité essentielle à leur religion au profit de ce que les sociétés occidentales tiennent pour (souhaitable) modernité ; ou bien se couper de ce qui fait la modernité, pour s’enfermer dans un islamisme qui ne peut avoir d’autre issue qu’une violence stérile. Le récent livre d’Anoush Gangipour vient à point pour apporter un peu de lumière dans ce débat essentiel de la politique actuelle et de la théologie qui la fonde.
Au printemps 2015, Les Temps modernes, une revue pas vraiment connue pour sa bigoterie et son islamisme militants, lui avait confié le soin de coordonner un numéro intitulé « Dieu, l’islam et l’État ». Cette année, le jeune philosophe iranien développe sa réflexion sur ce thème dans son Ambivalence politique de l’islam. Ce n’est pas un ouvrage militant, dans un sens ou dans un autre, mais une réflexion proprement philosophique dont on peut comparer l’ambition à celle de Carl Schmitt dans sa Théologie politique de 1922, à ceci près que l’un est musulman et l’autre catholique – et qu’un siècle les sépare.

Anoush Ganjipour © Astrid di Crollalanza
Lorsque Ganjipour parle d’ambivalence, le mot doit être pris dans son sens précis et pas comme un vague équivalent d’ambiguïté. Aux yeux de l’auteur, en effet, cette ambivalence est à la fois la principale clé pour comprendre ce qu’il en est d’une théologie politique musulmane, et le concept qui en fait toute la richesse. L’importance pour l’islam de cette ambivalence pourrait être comparée à celle de la séparation entre Dieu et César pour le christianisme, séparation qui fonde celle, non moins radicale, entre clercs et laïcs. Des deux côtés, c’est de la source des lois qu’il s’agit, dans leur (éventuel) rapport à la Loi divine. Disons que, de manière générale, le christianisme est à tout point de vue une théologie de la rupture, et pas seulement par rapport à la pensée juive, rupture entre la loi et la chair, entre la lettre et l’esprit, entre le spirituel et le temporel. Il n’en va pas ainsi pour l’islam, qui cherche l’unité entre la Loi (divine) et la loi (politique).
C’est d’ailleurs une difficulté majeure, qui contribue à expliquer le divorce entre chiisme et sunnisme. Si, en effet, les lois (de l’État) doivent être fondées sur la Loi (de Dieu), quelle différence peut-il y avoir entre les deux, et peut-on seulement dire « les deux » ? Le christianisme est fondé sur cette dualité, qu’il pense dans la séparation, tout au long de l’Histoire, entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, laquelle n’est accessible qu’après que l’Histoire a suivi la totalité de son cours, avec le retour glorieux du Christ, promesse formulée à la toute fin de l’Apocalypse de Jean, à la dernière page donc de la Bible chrétienne.
Les musulmans n’attendent évidemment pas le retour glorieux du Christ. Ce que le christianisme confie à l’historicité (avec, donc, des coupures selon le temps), l’islam le pense dans le présent, sans pareille coupure. Dans un vocabulaire emprunté au christianisme, on pourrait dire que la charia est la loi d’une Jérusalem céleste dont la présence actuelle fait problème. Sa dimension historique explique pourquoi la théologie politique chrétienne admet très bien que subsiste un écart entre les lois et la Loi, quitte bien sûr à ce que l’Église fasse tout ce qui est en son pouvoir pour rapprocher les lois de la Loi qu’elle représente sur terre. Tel est le sens d’une politique démocrate-chrétienne.
Mais, n’en déplaise à Erdoğan, il ne peut y avoir de parti démocrate-musulman comparable aux partis démocrates-chrétiens de l’Union européenne, car la logique de l’islam fait de la possibilité même d’un gouvernement islamique une forme d’hérésie vis-à-vis de la Loi. Ce serait considérer que la Jérusalem céleste peut être d’ores et déjà présente. Ou, pour le dire en termes politiques ordinaires, aucune forme de gouvernement ne pourrait appliquer véritablement l’authentique charia, même au prix d’une insupportable dictature. L’aporie théologico-politique de l’islam peut être formulée ainsi : « aussi bien l’islam légaliste que l’islam spirituel sont politiques et en même temps antipolitiques. Ils conduisent à la fois à une pensée d’État et à une politique subversive ». Cette aporie est une richesse car c’est en s’y confrontant que la pensée musulmane peut développer de riches propositions.
Une fois admis que le règne de la charia était impossible dans la réalité terrestre tout en demeurant la Loi divine, reste à formuler ce que pourrait être une théologie politique musulmane. Ganjipour entreprend de montrer que toutes les oppositions sur lesquelles est construit le christianisme renvoient à « deux paradigmes d’autorité » qui cohabitent, le pastoral et le monarchique. L’important étant cette irréductible cohabitation : ni alternative, ni opposition dialectisable, juste une ambivalence dont il n’y a pas lieu de vouloir sortir.

Il n’est pas étonnant que, en refusant les coupures chrétiennes, on retrouve l’inspiration platonicienne dont les fondateurs du christianisme ont tenu à se distinguer tout en ne l’ignorant pas, s’agissant des Pères grecs. Et plus précisément l’émanatisme des néoplatoniciens tardo-antiques. Quand Plotin (VI, 9) interprète le mythe de Minos, le roi divin, il parle d’une fréquentation (sunousia) avec « là-haut », à travers laquelle « le toucher (épaphè) divin fécondait Minos pour cette législation ». Plotin explique ainsi qu’édicter la loi c’est produire des images (eidola) de cette fréquentation. Autant dire que le sujet de cette législation n’est pas le roi divin mais la divinité elle-même. Ganjipour qualifie ce mode de relation avec le divin de « passivité active », dans le cadre de laquelle « la médiation du philosophe-roi, homme divinisé à la fois passif et actif, permet de prolonger sans hiatus cet ordre monarchique dans la communauté des hommes ». Voilà comment la notion islamique de l’autorité a pu se trouver préparée par le néoplatonisme. Une telle influence n’a rien de surprenant : même si Ganjipour n’y fait pas allusion, on peut évoquer les travaux de Michel Tardieu sur l’importance historique prise par l’école platonicienne de Harran (Carrhes) dans l’élaboration philosophique de l’islam.
Peu avant la révolution de 1979, Khomeyni « commence à parler de la République comme forme de l’État islamique à venir ». Un journaliste français lui demande en quel sens il entend ce mot et il répond : « dans le sens où elle existe partout ». Flatterie adressée au pays qui l’accueille ou tactique destinée à rassurer les Occidentaux ? On ne sait, mais le plus probable est qu’il pensait simplement au livre de Platon qui porte ce titre et au balancement entre le thème du philosophe-roi et celui du pasteur tel qu’il est développé dans un dialogue tardif, Le Politique. Si la pensée politique revient à penser la transformation du Pasteur en Léviathan, on peut voir en Carl Schmitt et en Khomeyni « deux lecteurs de Platon, deux théoriciens modernes de la guidance politique ».
Il va de soi, néanmoins, que tout platonicien n’est pas censé être croyant au sens où il reconnaîtrait une forme d’être à la transcendance. Dans la hiérarchie néoplatonicienne, la transcendance n’est pas celle d’un être mais celle de l’Un, « au-delà de tout être » comme écrit Platon dans La République. Le problème majeur que pose le monothéisme, aussi bien musulman que chrétien, n’est pas l’unicité divine mais le fait de ramener l’Un transcendant au rang d’attribut de cet être que l’on nomme Dieu et en qui l’on voit à la fois le Créateur universel et une sorte d’inspecteur des consciences.








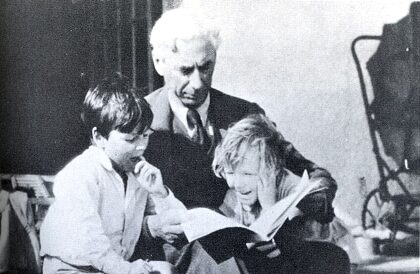



![Theodor W. Adorno, Trois études sur Hegel [1970], tr. de l’allemand par le Groupe du Collège international de philosophie, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 168 p. Theodor W. Adorno, La « Critique de la raison pure » de Kant [1959], tr. de l’allemand par Michèle Cohen-Halimi, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 540 p. Theodor W. Adorno, Leçons sur l’histoire et sur la liberté (1964-1965),](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/11/Paul_Klee_Seiltanzer_1923.jpg)