 Dans la lignée d’Intérieur, publié en 2013, et de Cave, à paraître en septembre prochain, Thomas Clerc décrit son environnement familier avec la même précision implacable et y découvre un étrange malaise.
Dans la lignée d’Intérieur, publié en 2013, et de Cave, à paraître en septembre prochain, Thomas Clerc décrit son environnement familier avec la même précision implacable et y découvre un étrange malaise.
Les murs blancs, les murs nus m’apaisent. Pour travailler, pour vivre et le reste, j’ai besoin d’une nudité, d’une blancheur que l’on dit parfois camérale. Les murs de ma maison sont blancs. Ma chambre elle-même, entièrement blanche, démeublée, sans livres et sans images, a la douceur austère d’une cellule. Ma salle de bains aussi est pavée de carreaux blancs, qui étaient là avant moi. Je n’ai pas choisi ce carrelage standard, ce degré zéro auquel on n’a pas fait l’affront d’ajouter un motif en épi de blé ou une fleur — cela se voit plus fréquemment dans les cuisines. La mienne est à l’unisson du reste, sans fioritures. Le blanc intérieur est propre au vingtième siècle. Le vingtième siècle a voulu rompre avec les temps obscurs. Le vieux monde était sombre, poussiéreux, surchargé. Le monde moderne a été clair, net ; il s’est voulu propre.
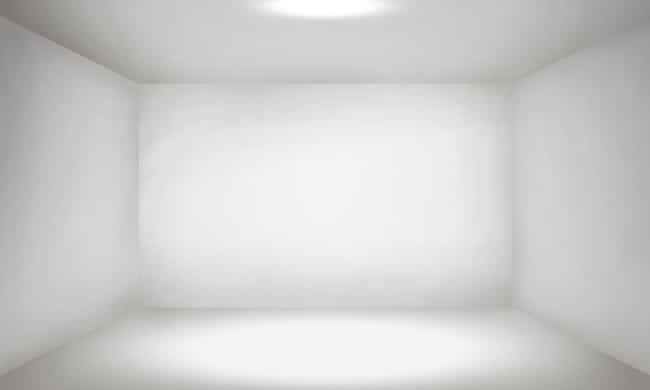
Chambre vide © D.R.
Dans cette cuisine toute neuve, dont le sol noir fait ressortir la crudité lumineuse, j’ai remarqué l’autre jour une trace sur l’un des murs, celui qui est en retrait de la cuisinière. C’est en m’affairant que l’imperfection m’a sauté aux yeux, sa couleur marronnasse étirée sur deux centimètres carrés et sa forme d’île aux reliefs déchiquetés. Sans doute une projection de graisse, à laquelle est exposée la pièce par principe. Je me suis approché de la tache, j’ai passé mon doigt dessus mais je n’ai rien senti. Ce n’était pas de la graisse, ce n’est pas non plus une croûte que j’aurais pu gratter sous l’ongle ; elle revêt plutôt l’apparence d’une auréole un peu floue, baveuse, comme certains tatouages mal faits sur une peau vieillie.
Une trace sur un mur blanc défie l’homme méticuleux que je m’efforce d’être ; elle humilie ce décor bien ordonné où j’ai tâché de trouver le calme. Je me verrais bien poursuivre une existence cadrée par cette ambiance de grand cube blanc, que j’ai construite avec opiniâtreté. Cette tache dérange mes plans, m’obsède. Je prends tout dysfonctionnement pour une affaire personnelle. J’ai sorti une éponge double face et je l’ai passée sous l’eau puis sur le mur. La tache n’a pas bougé ; j’essuie avec davantage de conviction mais sans succès : ce n’est pas quelque traînée alimentaire qu’il est aisé de faire disparaître mais une marque sans origine précise, une imperfection dont je ne peux identifier la cause. On dirait qu’elle sourd du mur, qu’elle le colonise. J’essaie alors avec le côté vert de l’éponge, celui qui gratte. Je frotte un peu plus fort comme si j’étais entraîné par la rugosité, la crinière du grattoir. Du coup, le blanc s’orne d’une seconde traînée, verte cette fois : j’ai voulu bien faire, et me voici avec une portion de mur abîmée deux fois. J’essaie en réhumidifiant l’éponge du côté jaune d’effacer la traînée produite par le grattoir, mais le mal est fait, le vert se lit nettement sur le blanc et n’a pas effacé l’auréole marronnasse à l’origine du désordre ; elle l’a au contraire soulignée. La journée commençait bien, pourtant. Elle se présente maintenant sous des couleurs moins obligeantes. J’ai beau refrotter le petit pan de mur avec le côté jaune de l’éponge, je n’arrive à rien de positif. Par la fenêtre ouverte, j’entends les ahanements des joueurs de tennis : dans la cour, la télévision retransmet le tournoi de Roland-Garros à un volume de four moyen. La tache est toujours là, comme une transpiration qui aurait modifié l’essence immaculée du mur ; et la trace verte du grattoir s’est incrustée, tout en se délayant, en rayures agressives. Peut-être qu’on ne la remarquera pas, mais le blanc a ceci d’implacable qu’il fait ressortir le moindre accident de surface. J’ai la sensation triste d’avoir défiguré mon espace. D’avoir agi à contre-courant, et de devoir agir de nouveau, d’ajouter un acte sans gloire à un autre. Quelques années plus tard, les nouveaux propriétaires remarquèrent, sur le blanc encore net du mur, une petite zone recouverte d’une couche de peinture blanche, mais d’un blanc autre, cassé.
Thomas Clerc












