Republier aujourd’hui Irmgard Keun, c’est rendre justice à celle qui fut dans les années 1930 une des plumes majeures de la littérature allemande, admirée et encouragée dès ses débuts par des écrivains aussi importants qu’Alfred Döblin. Son premier roman, traduit en français en 1933 sous le titre Gilgi découvre la vie, fut immédiatement adapté au cinéma. Après une longue éclipse dont sa mise à l’index par le régime nazi n’est sans doute pas seule responsable, les lecteurs français ont déjà pu redécouvrir quelques-unes de ses œuvres, parmi lesquelles le magnifique Après minuit (Belfond, 2014), témoignage précieux sur la société allemande de l’immédiat avant-guerre. La reparution du roman Une vie étincelante confirme la place éminente tenue par la jeune romancière dans le courant de la Nouvelle Objectivité, immortalisé par des peintres comme Christian Schad ou Georg Grosz.
Irmgard Keun, Une vie étincelante. Trad. de l’allemand par Dominique Autrand. Éditions du Typhon, coll. « Après la tempête », 208 p., 19 €
Le roman d’Irmgard Keun a d’abord été traduit en français par Clara Malraux, sous le titre La jeune fille en soie artificielle (Gallimard, 1934), repris de l’allemand Das kunstseidene Mädchen. Au terme de longues années de quasi-oubli en France, les éditions Balland le republièrent en 1982 sous le même titre, mais traduit cette fois par Dominique Autrand : c’est cette même traduction révisée que proposent aujourd’hui les éditions du Typhon, mais sous un nouveau nom.
Une vie étincelante prend la forme d’un journal ou, plus exactement, comme le dit la narratrice (Doris, une jeune fille de dix-huit ans), d’« une sorte de film », ce qui cadre mieux avec le personnage et son époque. Il relate les quelques mois de l’année 1931 au cours desquels elle quitte ses parents, sa ville natale et son emploi subalterne chez un avocat pour tenter de devenir une actrice célèbre, une « vedette ». Irmgard Keun elle-même n’avait-elle pas caressé l’espoir d’une carrière au théâtre avant de se vouer à l’écriture ? Une première tentative de son héroïne s’achève pitoyablement sur un départ précipité pour Berlin, un manteau de fourrure volé sur le dos : elle ne se séparera plus de ce vêtement, symbole du luxe qu’elle ne peut s’offrir, mais auquel elle estime avoir droit.
Elle arrive à Berlin en septembre 1931, le jour même où Pierre Laval et Aristide Briand s’y rendent pour rencontrer le chancelier Brüning. Évidemment, rien ne se passera comme elle l’avait prévu, et la grande ville où le nazisme monte en même temps que le chômage risque d’avoir raison de ses espérances. Alors que la république de Weimar agonise, l’ascenseur social est en panne et la société se désagrège ; les pauvres, les petits et même les classes moyennes s’enfoncent dans la misère (comme on le voit aussi dans le célèbre roman de Hans Fallada Quoi de neuf, petit homme ?). Quelle place alors pour les femmes, celles qui travaillent et perdent leur emploi ? Celles qui restent au foyer et subissent la violence de maris avinés qui se vengent sur elles du malheur qui les accable ? Sans parler des enfants qu’elles hésitent à avoir dans un tel monde… Pour survivre, certaines basculent dans la prostitution, occasionnelle ou non.
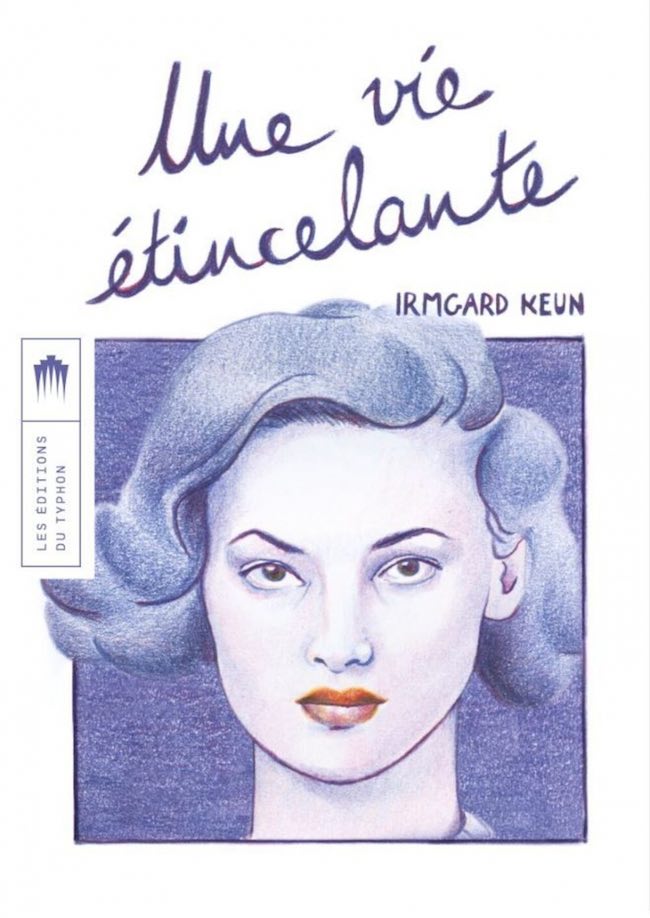
Doris, plus volontaire que les autres, ne se laisse ni abattre ni dominer, incarnation parfaite de la femme issue du courant d’émancipation des années 1920 que la Nouvelle Objectivité veut magnifier, libre, courageuse et sensuelle. Mais comment devenir assez riche pour gagner son indépendance ? Après que son premier amour l’a trahie pour épouser une fille de meilleure condition, Doris est bien décidée à se servir des hommes pour s’élever socialement. Non pour profiter de l’aisance d’une femme entretenue, mais pour avoir l’argent indispensable à sa réussite, réaliser son rêve de tenir enfin le haut de l’affiche. Le chemin qu’elle prend est hardi et périlleux, le danger de finir aussi mal que Nana est grand.
Mais l’époque a changé, la jeune fille ambitieuse des années trente se croit assez forte pour jouer avec le feu, pour peu qu’elle garde toujours l’initiative et la maîtrise de ses actes. C’est une battante, prête à prendre des risques, tenaillée par l’urgence de vivre et de profiter de sa jeunesse : « quelquefois, il y a des miroirs dans lesquels je suis une vieille femme. Ce sera comme ça dans trente ans ». L’infortune et la pauvreté, loin de la décourager, lui servent d’aiguillon, car « quand on est heureux, on cesse d’aller de l’avant ». Hélas, la progression peut aussi s’interrompre, et Doris se retrouve abandonnée plusieurs fois sans ressources dans la bien nommée « salle d’attente » d’une gare, hésitant entre un nouveau départ et le terminus de ses illusions.
Elle classe les hommes selon le prix des cigarettes qu’ils fument et les désigne d’abord par leur métier, leur fonction, ou un détail physique, ridicule de préférence : un bon moyen de les instrumentaliser, de moquer les attributs de leur pouvoir, et de s’affranchir de leur domination. On voit ainsi défiler « La Lune rouge », « l’entreprise de textiles », « une boule toute rose et très gaie », « la Mousse Verte » (parce qu’il « avait une voix comme de la mousse vert foncé »), « la famille Onyx » (parce que « le mari possède de l’onyx, des actions, et des cheveux blancs qui se tiennent tout droit sur sa tête et qui se croient beaux »), et ainsi de suite. Tous ces bourgeois sont croqués en quelques mots bien sentis, caricaturés à la manière de Georg Grosz ou d’Otto Dix, et sans que cette méchante satire épargne pour autant les pauvres comme Gustav-la-Pédale, « un petit bout de misère dégobillé ».
Si Doris tente de se hisser dans l’échelle sociale par la séduction, elle se heurte rapidement à un obstacle quasi infranchissable : son manque de culture. Elle n’est pas ignare, mais elle a besoin qu’on la guide, sachant qu’« on ne peut demander d’aide à personne et [qu’]un professeur, ça coûte un argent fou ». Les enjeux politiques lui échappent, elle n’a pas les clés pour s’insérer dans la société à laquelle elle aspire, et pas davantage le diplôme qui lui donnerait accès à une profession lucrative : la grande force de ce roman, c’est de faire de l’instruction et de la culture le véritable marqueur social par-delà les origines et la richesse. Et le handicap est grand pour les femmes de ce temps-là.
Le titre allemand, « La jeune fille en soie artificielle », soulignait la fragilité d’une héroïne condamnée au toc et à l’imitation. « On ne devrait jamais porter de la soie artificielle avec un homme, ça se chiffonne si vite », confie Doris : la soie naturelle serait un signe tangible de sa réussite, mais sortir de la précarité n’est pas simple. Quand un homme lui offre enfin le confort dont elle rêve, il est marié, il ne l’épousera pas. Ou c’est un escroc qu’on vient arrêter. Celui auquel elle pense à la fin du roman est un ouvrier, au chômage certes mais digne – et donc à sa portée. Mais ce n’est qu’une des issues possibles, d’autres existent, sauf celle que Doris a obstinément exclue : le retour à un travail de bureau, forcément « moche » et surtout mal payé !
Doris n’a cependant pas le cœur sec, certains des hommes qu’elle approche lui plaisent, peut-être parce que les blessures qu’ils ont reçues durant la Grande Guerre (on ne sait pas encore qu’il s’en prépare une autre) les rendent plus humains. Avec Ernst par exemple, qui la respecte et lui offre fugitivement la perspective d’une nouvelle vie, elle accepte de jouer le rôle de la bonne ménagère, mais jamais celui de la femme soumise car, dit-elle, « je travaille avec vous parce que j’y trouve mon plaisir et pas par peur de perdre mes moyens de subsistance ». Digne et indépendante jusqu’au bout, elle lui accorde sa confiance, lui donne à lire ce qu’elle écrit au jour le jour, mais refuse obstinément sa proposition de rendre le manteau volé et de retourner à un travail honnête, avec un salaire de misère qui lui fermerait l’avenir.
Un autre homme contraste avec les personnages douteux qu’elle rencontre, lui aussi est un blessé de guerre, un aveugle avec qui Doris se prend d’amitié : elle devient ses yeux, elle lui raconte la ville qu’il ne peut voir, et la poésie de sa langue populaire illumine le roman. Car l’autrice a doté sa narratrice d’un regard aiguisé et d’un talent de conteuse exempt des scories qu’aurait pu lui apporter la « culture » qu’elle n’a pas. Doris décrit les choses telles qu’elles les voit, les ressent, les enregistre. Ce café par exemple, fréquenté par des Russes : « Les hommes ont comme des petites brosses à dents au-dessus des lèvres – l’orchestre chante – cette langue, c’est comme de la mayonnaise onctueuse, fluide – quelle douceur, mon Dieu. Le plafond est gris-vert […] la musique, ce sont des crânes chauves et des violons – une femme avec un corsage jaune rit en russe ». Encore un des charmes de ce roman, comme si les mots remplaçaient le pinceau du peintre ou la caméra du cinéaste au terme d’un minutieux travail d’écriture (soigneusement relayé par la traductrice).
Dans le contexte actuel, alors que le combat des femmes occupe la place que l’on sait, le retour dans l’actualité d’Irmgard Keun et de sa jeune héroïne Doris obnubilée par son désir d’émancipation et de réussite sociale ne saurait mieux tomber. Notre temps n’a d’ailleurs aucune peine à entrer en résonance avec celui du roman, un temps de doute, de crise et de montée de la violence : sachant comment tout cela a déjà fini une première fois, on craint confusément que l’Histoire vienne à se répéter. Si l’autrice et sa créature font si bien le lien entre les années où elles ont vécu et les nôtres, c’est peut-être aussi parce qu’elles ont su porter avant l’heure un female gaze sur leur entourage.












