Les univers alternatifs créés par Philip K. Dick s’effondrent très vite, remarque David Lapoujade dans L’altération des mondes. Reliant chez l’auteur d’Ubik la notion de monde à celle de psychisme, la vérité à la subjectivité, le philosophe insiste sur l’importance du délire, de la paranoïa – et sur leurs points communs avec la religion et les drogues – pour représenter des sociétés de plus en plus soumises aux machines et au contrôle, fussent-ils invisibles et insidieux. En une analyse aussi précise que stimulante, David Lapoujade nous montre comment la désagrégation apparente des romans de Philip K. Dick peut se lire comme une stratégie pour réformer des sociétés « invivables ».
David Lapoujade, L’altération des mondes. Versions de Philip K. Dick. Minuit, 160 p., 16 €
David Lapoujade a écrit sur Deleuze (dont il a édité deux recueils de textes posthumes), Bergson, Emerson, ou encore Henry James. Après la parution des nouvelles complètes de Philip K. Dick dans la collection « Quarto », l’automne dernier, le fait qu’un tel auteur lui consacre un livre constitue une nouvelle preuve que la science-fiction est de plus en plus prise au sérieux. Son introduction la définit comme création de mondes. Or, ceux de Philip K. Dick sont singulièrement fragiles et changeants : « j’aime créer des mondes qui tombent vraiment en morceaux au bout de deux jours », écrivait-il. « J’aime les voir se désagréger et j’aime voir ce que font les personnages du roman lorsqu’ils sont confrontés à ce problème. » D’après David Lapoujade, on peut relier cette caractéristique au fait que nos sociétés contemporaines fonctionnent elles-mêmes comme un roman de science-fiction, « les informations sur l’état présent du monde » devenant « une succession de récits d’anticipation sur son état futur ». L’information se multipliant, l’effet en est « écrasant ». Aujourd’hui, chaque information contient potentiellement une alerte quant au destin du monde.
Ainsi, la SF dickienne serait un moyen d’explorer « les profondeurs du réel pour deviner quels nouveaux délires y sont déjà à l’œuvre ». La notion de délire est cruciale pour un écrivain qui, souvent explicitement, a mis la maladie mentale au centre de son œuvre. Les clans de la lune alphane se déroule sur un satellite transformé en asile psychiatrique, Glissement de temps sur Mars adopte le point de vue d’un jeune schizophrène, les « précogs » de « Rapport minoritaire » sont « idiots » et « attardés », etc. Souvent aidés par des drogues ou par un état particulier, « semi-vie » ou coma, voire par le fanatisme religieux, les protagonistes livrent leur version délirante de la réalité. Mais David Lapoujade montre non seulement que ces délires permettent d’envisager des possibles, mais aussi qu’ils constituent une réponse individuelle à l’aliénation de notre société du contrôle.
À une réalité qu’il sait n’être qu’artifice ou même folie, le délirant, souligne David Lapoujade, oppose la vérité de sa version. L’auteur rapproche cet affrontement de la lutte entre le psychiatre et le fou décrite par Michel Foucault dans Le pouvoir psychiatrique. Chez K. Dick, la « réalité » est dénoncée comme une vision subjective parmi d’autres, imposée trompeusement comme vérité universelle. Elle n’est que la projection d’un psychisme, un ensemble de normes sociales, voire un mensonge délibéré imposé par un pouvoir qui en a les moyens. Ainsi, dans L’œil dans le ciel, « le monde passe par des transformations successives en fonction des valeurs morales, convictions politiques et croyances de chacun des personnages » plongés dans le coma. En conséquence, comme Palmer Eldritch dans Le Dieu venu du Centaure, « dans les romans de Dick, les dealers sont aussi puissants que des dieux puisqu’ils fournissent des mondes ».
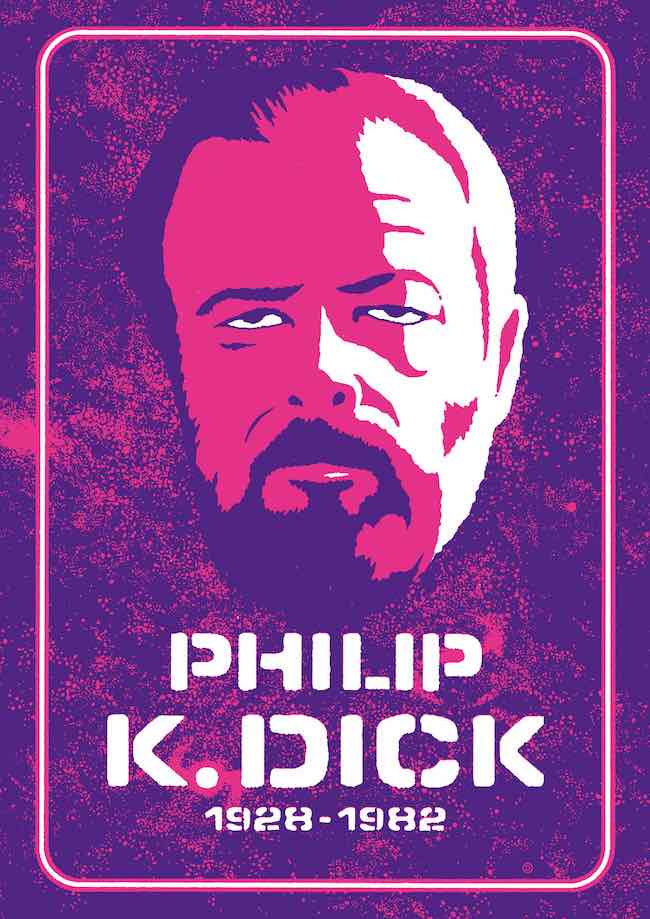
Qui contrôle la production des apparences contrôle le monde. Dans La vérité avant-dernière, les dirigeants maintiennent la plus grande partie de la population enfermée au sein de cités-usines souterraines en lui faisant croire qu’une guerre totale ravage la surface de la planète. David Lapoujade montre comment cette vision de la réalité peut s’appliquer à notre société contemporaine à travers l’opposition qu’on retrouve chez Philip K. Dick entre machines et humains : « Les nouvelles technologies n’ont pas pour objet de transformer le monde existant, mais de le remplacer par des mondes artificiels ». L’écrivain californien voyait les États-Unis des années 1950 comme un monde en « toc », « un vrai parc d’attraction pour gamins prolongés ». Pour « confronter le toc à lui-même », il s’approprie les moyens de la société de consommation : multiplication des objets, comme les Poupées Pat du Dieu venu du Centaure et d’« Au temps de Poupée Pat » ou les répliques imparfaites de « Copies non conformes », addiction au jeu dans « Qui perd gagne », techniques de vente agressives dans « Marché captif » ou « Foster, vous êtes mort ! », formes publicitaires dans Ubik, désir d’achat partout.
Cependant, le développement des machines menace aussi l’humain dans son existence même. Les textes de Philip K. Dick abondent en faux humains, androïdes ou envahisseurs extraterrestres. Mais surtout les machines intelligentes, concurrençant l’humain, l’étouffant sous leurs services, lui imposent leur mode de fonctionnement, leur vision, leur monde. Dès « Les défenseurs » en 1952, bien que poussés par de bonnes intentions, des robots trompent les hommes sur la réalité. Les machines entravent la pluralité des possibles, la souplesse adaptative, le changement, comme les usines intelligentes d’« Autofab » délivrent imperturbablement leur inutile production malgré l’épuisement des ressources naturelles.
Pour contrôler un monde « instable, précaire », à l’information quasi instantanée, il faut produire sa réalité en continu en mettant « la technologie au service du contrôle des vies ». Les mondes de Philip K. Dick, pourtant mort en 1982, sont donc propres à décrire le fonctionnement du nôtre, la même technologie servant à la prolifération de l’information et à un contrôle et à une surveillance accrus. Dans « Souvenirs à vendre », même la mémoire de Douglas Quail est manipulée, et le crapaud électrique de la fin de Blade Runner peut être vu comme le symbole d’une réalité entièrement factice.
Heureusement, les romans et nouvelles de K. Dick contiennent aussi la solution. Reprenant la distinction de Lévi-Strauss entre ingénieur et bricoleur, David Lapoujade note la présence dans l’œuvre dickienne de réparateurs, de rafistoleurs – depuis le père de famille qui construit une barge dans son jardin (« Le constructeur ») jusqu’à l’ingénieur de « Clause de salaire » se transformant en bricoleur pour recouvrer la mémoire, en passant par le réparateur de « swibble » (« Visite d’entretien »). Par opposition avec les « machines parfaites mais irréparables », le bricoleur chez K. Dick est capable « d’assembler des fragments de mondes hétérogènes de manière à circuler entre eux ». Grâce à l’empathie, qualité proprement humaine, le bricoleur s’adapte à l’instabilité du monde moderne, sans pour autant le contraindre dans une représentation normative, que sa rigidité rendrait fausse.
La bonne nouvelle, conclut David Lapoujade, c’est que, selon Philip K. Dick, le monde est réparable : « Il ne s’agit pas de penser de grandes totalités hors de portée de toute action individuelle (« la » société, « le » capitalisme, « le » monde) sinon pour montrer comment elles s’effondrent. Si Dick les fait s’effondrer, c’est pour les reconstruire, les rafistoler autrement. Nous allons reconstruire un monde, mais à notre manière, avec les moyens du bord. C’est ainsi que se forment des alliances, communautés ou bandes de réparateurs chez Dick. […] La réalité du monde n’est pas donnée, elle est à construire et ce qu’elle deviendra dépend de la part active de chaque individu, des actions qu’il entreprend avec d’autres, ici et maintenant ». Là-dessus aussi, les romans de Philip K. Dick, hétéroclites, non linéaires, imprévisibles, sont en phase avec notre époque.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)





![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)




