 Si le blanc est une couleur, ou son absence, il est également un son, ou son absence, c’est-à-dire le silence. N’utilise-t-on pas, pour signifier qu’un personnage se tait, dans un roman, une pièce de théâtre, l’expression « un blanc » ?
Si le blanc est une couleur, ou son absence, il est également un son, ou son absence, c’est-à-dire le silence. N’utilise-t-on pas, pour signifier qu’un personnage se tait, dans un roman, une pièce de théâtre, l’expression « un blanc » ?
Le blanc serait par conséquent, dans ce cas-là, le laps de temps pendant lequel les mots sont en attente, l’action également, il génère un suspense bénéfique : « Que va-t-il se passer à présent ? À quoi l’auteur nous prépare-t-il ? » La surprise ne vient pas que d’une logique du sens, perturbée, bousculée, mais aussi d’un collapse ou d’un choc langagier, de la présence simultanée de deux termes, deux idées qu’on n’a pas l’habitude d’associer. C’est le fonctionnement de la comparaison ou de la métaphore.
Dans la littérature, le blanc est visuel – espaces entre les mots ou marges, interlignages – tout autant que sonore. C’est ce mélange, cette confusion, que traduisit peut-être ce qu’on nomma dans les années 1970 et 1980 la « lecture blanche », en poésie.
Je ne saurais pas dire qui inventa l’expression. Mais je puis, en revanche, citer sans hésiter celui qui en lança la mode. En 1981, Jacques Roubaud publiait un livre qui fit merveille chez les poètes : Dors, précédé de Dire la poésie (Gallimard). Il y théorisait, sous la forme d’un poème, la manière de lire, pour soi ou un public, sa poésie ou celle des autres.

Jacques Roubaud © Jean-Luc Bertini
Précisons toutefois qu’il pratiquait déjà depuis plusieurs années la manière en question. Les lectures, à l’époque, étaient monnaie courante, les lieux qui les accueillaient nombreux, officiels ou privés, extérieurs ou cloîtrés. Et Jacques Roubaud, dont la notoriété grandissait peu à peu, se produisait souvent : il aimait ça, ce qui se comprenait rien qu’à le voir surgir, grand corps déjà un peu voûté, sourire en coin dans un visage en contrepoint imperturbable.
Poète remarqué et valorisé par Aragon et Elsa Triolet, comme un certain nombre d’autres, il avait fait partie des invités de la soirée du Récamier, qui eut lieu en 1965, et qui avait pour objectif de faire connaître au grand public la jeune poésie française. Antoine Vitez était également présent à cette soirée, mais en tant que lecteur et acteur.
Vous souvenez-vous de la diction des grands poètes d’autrefois, Apollinaire, Aragon, Éluard… ? Elle nous est devenue insupportable. La lecture du Récamier assura probablement une transition entre cette diction-là et celle de la nouvelle génération. Est-ce en réaction contre la grandiloquence, l’emphase, le sentimentalisme de leurs aînés, que les jeunes poètes de l’époque s’orientèrent vers une diction plus sobre, plus mesurée ? On peut le croire.
Toujours est-il que Jacques Roubaud ne lisait pas comme ces anciens, dont il admirait pourtant les œuvres. La plupart des poètes de sa génération non plus. Mais la lecture blanche de Roubaud se différenciait de celle de ses imitateurs. Nous allons voir en quoi.
« La diction que j’expérimente est au contraire
monotone répétitive imperméable indifférente
endort et attend et récidive la voix reste
semblable à la voix qu’elle était dans les lieux les
moments de la composition »
Oui mais. Si la lecture est blanche, c’est-à-dire neutre et terne, elle demeure habitée, du moins chez Jacques Roubaud et quelques autres de talent (comme Dominique Fourcade, qui lut son livre en cours, Son blanc du un – quel titre ! – dans le hall de Chaillot). Chez eux, de même que la couleur du blanc existe, par contraste, par reflets ou par imperfection, le son du blanc n’est pas silence, la lecture blanche est contredite ou combattue ou vivifiée, pour le lecteur, par la pensée de sa composition, la vue des arbres par la fenêtre, pour l’auditeur « écoutant ou dormant ou poursuivant quelque voie intérieure parallèle ».
La blancheur bruit d’impertinences, ou d’impatiences, du désir de durer. Ainsi, disant les poèmes de Dors dans la chambre où il les compose, regardant les nuages par la fenêtre, Jacques Roubaud se demande comment il saurait d’où venait le vent s’il n’y avait pas « la branche de grenadier frottant les vitres basses ». La question occupe son esprit tandis qu’il laisse aller sa voix, lentement, sourdement, pour permettre au poème de se prolonger un peu au-delà de son achèvement. De même, dans une salle de Villeneuve-lès-Avignon, il retrouve « des dispositions semblables de calme d’indifférence d’éloignement » qui font que les poèmes « d’une certaine manière gelée » ne sont pas complètement arrêtés.
La lecture blanche, du fait de sa neutralité, de son ascèse, permet à son auteur d’éviter de penser au contenu des vers. Et, concentré qu’il est sur l’écriture proprement dite – l’agencement des mots, les intervalles, la ponctuation –, « perméable aux sollicitations du moment », il fait bouger le texte même de manière infime, il change une lettre, un point, le maintenant ainsi dans un état de variation quasi perpétuelle comme s’il n’y avait « pas de vraie version ».
« On dit comme on contemple. » La formule est superbe. On reçoit « l’impulsion de nouveaux départs ». « Dans l’île lente de la voix » (autre formule à retenir), le poète laisse sourdre l’imprévu, le hasard, l’invention. Il déplie devant nous, « dans le creux entre deux pages ouvertes », la blancheur qui permet l’invention, il accueille ce à quoi il ne s’attendait pas, venu de l’inconscient, rejoignant Freud dont pourtant il se dit éloigné.
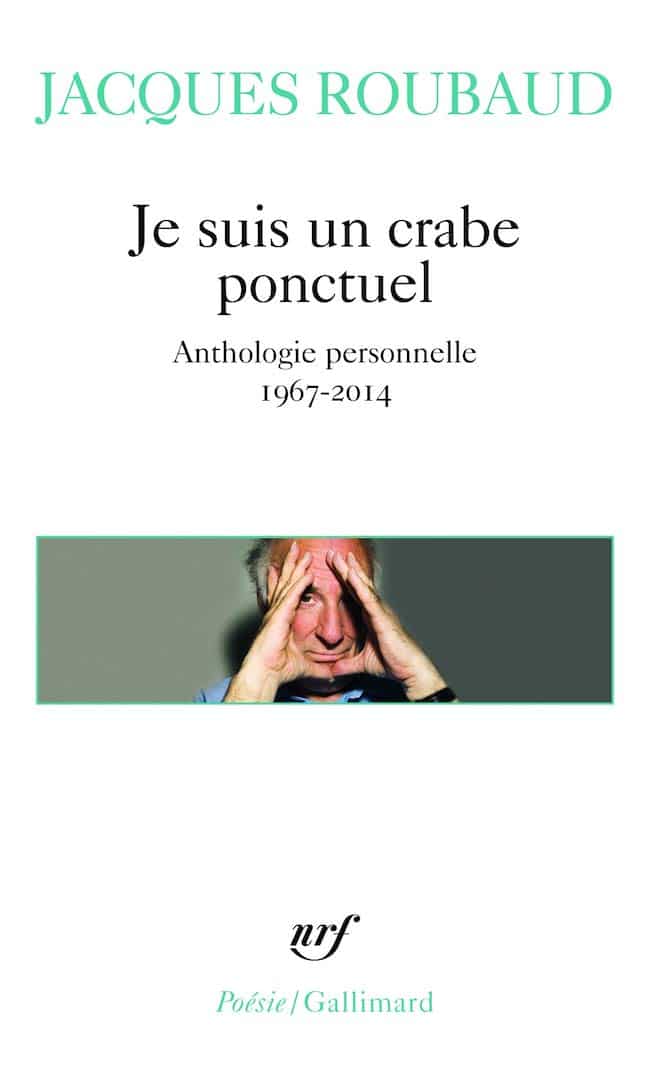
Contrairement à celles de ses imitateurs, ennuyeux, à l’accent sépulcral, donnant à leurs lectures des airs de rituels, de messes poétiques, les lectures de Roubaud étaient toujours très attendues, joueuses et drôles, parfois sublimes, comme celle que j’entendis voici trois ans au TNP de Lyon. Sa voix audible, bien qu’affaiblie par une santé précaire, son grand corps davantage incliné qu’autrefois, égrena lentement, avec clarté et précision, des rondeaux, des sonnets empruntés au volume de 1981, Je suis un crabe ponctuel.
Ces considérations sur l’art de dire le texte écrit à notre époque (car le dire de Roubaud est toujours actuel) nous conduisent au théâtre. Roubaud s’y est intéressé, comme les gens de théâtre s’intéressent aux poèmes : ils sont poètes à leur manière de spécialistes des tréteaux. Eux savent ce que parler veut dire, seuls devant un public, ils y ont réfléchi. Ainsi Antoine Vitez, qui connaissait Roubaud et l’estimait beaucoup. Leurs doctrines en matière de lecture n’étaient pas opposées, au contraire, elles possédaient des ressemblances dans la mesure où tous les deux souhaitaient revenir à un état premier, à un degré zéro de la lecture, un état d’innocence, de blancheur, ou de neutralité, duquel pourrait surgir un art nouveau du dire : « la situation première, c’est toujours moi devant vous, qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que je viens vous raconter ? », écrit Vitez dans son Journal. Et dans la présentation de sa traduction d’un volume de Yannis Ritsos, il écrit qu’il faut faire entendre « la voix comme un corps nu, parce qu’elle est du corps, elle en est la trace dans l’air ». Sa lecture est technique et a-sentimentale, son savoir-faire de comédien ne cache pas le texte, il le sert au contraire ; s’attachant à sa forme, il le met en valeur et le rend d’autant plus accessible.
Échapper au jeu des masques que suscite immanquablement un art parvenu à son terme, pratiquer la « déprise », c’est-à-dire l’ouverture, la disponibilité, pour préparer la « prise », la cristallisation d’un nouveau type de création, tel est l’enjeu de la lecture, ou de l’écriture blanche comme on peut les entendre, après Barthes, souterrain, souverain, dans tout ce qui précède, puis Roubaud, puis Vitez et avec lui quelques grands maîtres, Stanislavski et Meyerhold.











