Trois ans après la parution du premier tome de L’interprétation sociologique des rêves, le second volume, La part rêvée, ferme un diptyque novateur dans l’histoire de la discipline sociologique. Laura, Solal, Louise, Tom, Charlotte, Clément, Lydie et Gérard forment les huit cas d’étude pour le modèle d’analyse des rêves que Bernard Lahire avait finement bâti dans le premier tome (qui paraît en poche aux éditions de La Découverte). Le sociologue donne ainsi la preuve par l’exemple que la sociologie gagnerait à introduire davantage de récits de rêves dans ses matériaux d’études — à condition de bien caractériser les formes d’expressions oniriques et de délimiter ce qu’elles recouvrent.
Bernard Lahire, La part rêvée. L’interprétation sociologique des rêves, volume 2. La Découverte, 1 216 p., 28 €
Bernard Lahire se défend dès les premières lignes de cette seconde partie d’avoir voulu séparer la théorie de la pratique : s’il est vrai que le second volume se consacre presque intégralement à une mise en pratique de la méthodologie d’interprétation confectionnée dans le premier, celui-ci part bien de travaux empiriques, sans se perdre dans la théorie. Ne trahissons donc pas l’esprit de l’auteur et autorisons-nous à puiser dans le premier tome une clé de lecture du second. Cette clé apparaît dans la conclusion de L’interprétation sociologique des rêves : « En comparant les images du rêve aux récits éveillés pris dans des formes langagières conventionnelles et soumis à la censure des institutions, des circonstances et des interlocuteurs, on prend tout d’abord conscience de tout ce qui pèse en permanence sur nous dans la vie sociale éveillée et qui est moins prégnant durant notre sommeil. »

Bernard Lahire © Nathan Lahire
Ce que propose Bernard Lahire, et qu’il met en œuvre de façon fort convaincante dans le second tome, n’est pas une analyse sociologique de l’objet rêve per se, mais plutôt une tentative pour donner à comprendre ce que la sociologie gagne à introduire le rêve dans ses corpus d’études. Le rêve témoigne de la continuité de notre activité cérébrale, il véhicule des informations sur l’état diurne dont la sociologie peut se saisir. Surtout, la forme d’expression – le terme est important – dont relève le rêve renseigne sur le vécu intime d’une réalité sociale, sur la constitution des préoccupations et des problèmes personnels dans un espace onirique où le sujet se censure peu, où il s’abstrait du contrôle social.
Comment le sociologue peut-il situer son matériau onirique ? Lahire l’assimile immédiatement à un langage au début du présent ouvrage : « À la question : “Pourquoi rêvons-nous ?”, nous devons donc répondre : “Nous rêvons parce que nous continuons à vivre durant le sommeil en tant qu’êtres de langage capables de représentation” ». Un langage absolument familier, un langage à soi, totalement vernaculaire, qui, n’étant pas bâti comme moyen de communication vers autrui, s’épargne certaines conventions et couches qui pèsent dans la langue publique. Dans le premier moment du diptyque, Lahire avait notamment pu comparer certains récits de rêves, dont les nœuds narratifs sont parfois tellement tacites qu’ils échappent mêmes aux rêveurs, aux récits qu’écrivent certains enfants en grande difficulté scolaire, qui, peinant à fondre dans le langage les articulations de l’action qu’ils racontent, écrivent des textes qui paraissent souvent décousus.
Par ailleurs, le langage onirique recourt en abondance aux images, et aux associations rapides qu’elles permettent. Ces connexions, ou analogon, longuement analysées dans le premier tome et qu’énumère chaque fin de chapitre du second tome, sont responsables du relatif hermétisme de certains rêves, et demandent le secours d’une méthodologie d’interprétation des rêves pour que s’échafaude un sens. Un des plus beaux exemples d’analogon est donné par Clément qui, rêvant de la destitution de Donald Trump, projette sur l’ancien président américain une relation conflictuelle avec son père.
On comprend l’intérêt de Bernard Lahire pour l’interprétation sociologique des rêves à condition de replacer ces deux ouvrages dans sa démarche sociologique. L’auteur trouve dans l’objet onirique un beau terrain d’étude pour éprouver l’analyse à la fois dispositionnaliste et contextualiste qu’il promeut. Nos actions résultent bien entendu de schèmes qui nous sont incorporés d’abord via nos proches, et les membres de la famille dans laquelle nous avons grandi, mais aussi lors des rites de socialisation, des moments de bifurcation existentiels et de toutes les mises à l’épreuve qu’une vie nous fait traverser. Ces dispositions à l’action s’activent d’une manière ou d’une autre selon les contextes dans lesquels l’action se situe. « La formule générale qui est au cœur de cet ouvrage permet de penser les pratiques, individuelles ou collectives, dans l’histoire, au croisement du passé incorporé des acteurs et du contexte présent de leur action. L’histoire des individus, de leur naissance à leur mort, est ainsi conçue comme l’histoire des rencontres […] entre ce que le monde social a fait d’eux et ce qu’il leur fait affronter en permanence. »
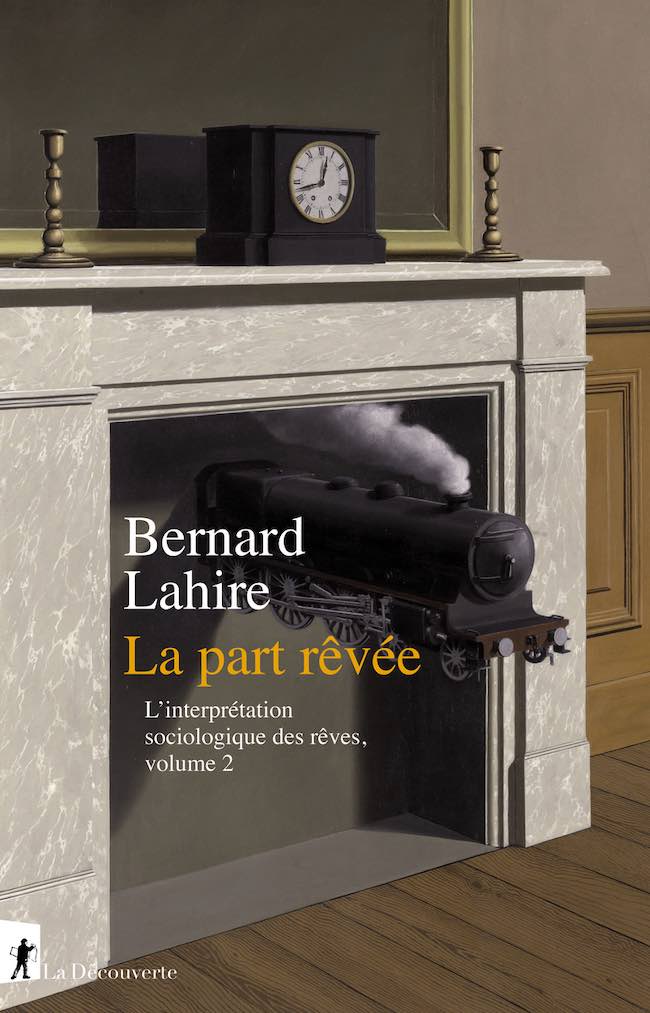
Dialoguant avec Freud, Lahire retrouve dans les rêves des rémanences de ces schèmes : dans l’exemple de Laura, le syndrome de l’imposteur des transfuges de classe ; dans celui de Louise, la violence physique du père et la masculinité oppressive ; dans celui de Gérard, un environnement familial qui empoisonne la vie. Lahire ne néglige pas non plus le volet contextualiste de sa méthode, il demande aux personnes participant à l’enquête de noter précisément leurs souvenirs et activités des jours précédant les rêves reportés dans le carnet idoine. L’interprétation sociologique des rêves repose donc sur une solide théorie de la continuité narrative du sujet, d’une ipséité tramée dans le sommeil comme dans l’éveil, depuis la petite enfance jusqu’au moment de l’entretien avec le sociologue.
Réintroduire ces objectifs de recherche conduit à nuancer certaines critiques relatives au dialogue que le sociologue entretient avec la psychanalyse. On pourrait regretter, par exemple, que la figure de Lacan ne soit pas davantage présente, là où le spectre de Freud plane d’un bout à l’autre du diptyque. Mais l’ambition n’est pas là, pourquoi faudrait-il être exhaustif ou couvrir un maximum du terrain des recherches en psychanalyse quand l’ambition sociologique du projet demeure parfaitement justifiée ? Du corpus psychanalytique, Lahire prend seulement ce qui est nécessaire pour justifier que le rêve puisse aussi servir de matériau pour une sociologie des soucis, une sociologie du vécu des inégalités, voire une sociologie des états mentaux : « Par exemple, on peut mener une recherche sur les effets des licenciements économiques et se rendre compte que les enquêtés parlent spontanément des cauchemars ou des rêves qu’ils font en lien avec cette situation traumatisante. […] on peut mener une enquête sur les nouvelles conditions de travail et le néomanagement dans les entreprises privées comme dans les services publics, et rencontrer sur son chemin des personnes en souffrance au travail qui témoignent de ce que leurs situations professionnelles les hantent jusqu’au cœur de leur nuit ».
À l’opposé de l’approche de Bernard Lahire, une autre sociologie s’intéresse aujourd’hui à de nouveaux objets : les imposants corpus de données que l’on tire du web. Il n’y a évidemment pas lieu de critiquer ici cette sociologie audacieuse et profondément stimulante. On ne pourrait, en revanche, que conseiller aux sociologues dits « computationnels » la lecture de l’interprétation sociologique des rêves par Lahire, tant ces deux sociologies novatrices ont l’une comme l’autre l’ambition de s’attaquer à des données d’une certaine opacité – les datas d’un côté, le rêve de l’autre –, ambition qui devrait impérativement s’accompagner de cette prudence réflexive que Bernard Lahire conserve toujours.











![Collectif[1], La condition intérimaire, La Dispute, 2024, 164 pages. Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, Raisons d’agir éditions, 2024, 154 pages. Éric Louis, Casser du sucre à la pioche, chronique de la mort au travail, Rennes, Éditions du Commun, 2024, 140 pages.](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/10/1600px-A_Warning_To_Be_Careful_While_Working_Eine_Mahnung_zur_Vorsicht_bei_der_Arbeit_MET_DP344663.jpg)
