Dans Le mont Fuji n’existe pas, Hélène Frappat met en avant sa présence observante d’écrivain (ou, pour reprendre l’intitulé du premier chapitre du livre, sa « présence espion »). Donnant à voir la manière dont elle peuple le monde par l’attention qu’elle porte à ce qui l’entoure, elle souligne le processus de création à l’œuvre, l’importance de ce contact avec le réel.
Hélène Frappat, Le mont Fuji n’existe pas. Actes Sud, 240 p., 20 €
« Heureusement que je ne suis pas un écrivain américain, ai-je dit à l’homme dont je venais d’observer le dos voûté, et la nuque large, pendant une soirée entière où j’avais été en proie à l’excitation. » Ainsi débute le dernier livre d’Hélène Frappat. Cette première phrase illustre bien la manière de représentation qui y est mise en œuvre : c’est l’autrice elle-même qui se met en scène, s’exprimant à travers un je qui, cependant, prend la forme d’un regard – avant tout celui que l’on pose sur l’autre avec une attention accrue. Elle racontera notamment « d’autres vies que la sienne », tout en soulignant la présence de l’oreille et des yeux qui les recueilleront en toute subjectivité.
Là, on pénètre avec elle dans une villa luxueuse de Marrakech, dont l’hôte, richissime et acariâtre, profite de quelques moments avec sa famille. Ailleurs, on rencontre Delphine, qui est lors de ses voyages « client mystère » ; l’un de ses amis qui prétend avoir dérobé un cadre vide dans l’atelier de Georges Braque ; une encadreuse dont est retracée l’histoire familiale et personnelle ; une discussion avec le voisin vraisemblable de Thomas Pynchon à New York… Hélène Frappat évoque encore son rapport avec son amant ; avec une belle-sœur défunte ; un voyage en apesanteur dans le cadre d’une résidence d’écrivains. Les portraits sont détaillés et permettent de dérouler un écheveau d’histoires, d’anecdotes ou de réflexions qui fourmillent, forment un réseau de sens. Ces récits restituent une méticulosité, celle de l’autrice et de son rapport subtil à l’altérité, la qualité première d’un écrivain étant peut-être son attention à ce qui l’entoure. La précision de l’écriture anime des fragments de vie qui s’assemblent en un tout mouvant, unitaire dans sa liberté dynamique ; c’est également et surtout la variété de composition qui lui donne cette portée. Ici, nulle linéarité convenue : les éléments s’entremêlent, judicieusement juxtaposés, pour déjouer toute prévisibilité.
À quel genre appartient cet ouvrage de quatorze récits plutôt indépendants ? Il est vrai qu’ils ne trouvent leur pleine signification et leur place que dans le tout organisé du livre (des échos apparaissant parfois de l’un à l’autre). Mais comment comprendre alors l’étiquette de « roman » ? Ce livre ne revêt pas tout à fait la forme d’une fiction : il révèle un rapport avec le réel, insiste particulièrement sur le travail en cours de l’écrivain. L’éditeur précise : « C’est l’invention d’un nouveau genre littéraire : le brain porn, porno mental qui installe le lecteur dans la tête de l’auteur. Depuis ce poste de guet, il devient le témoin privilégié de l’excitation qui fait vibrer l’écrivain-espion […] et échafaude avec la narratrice les scénarios intimes de son désir de fiction ».
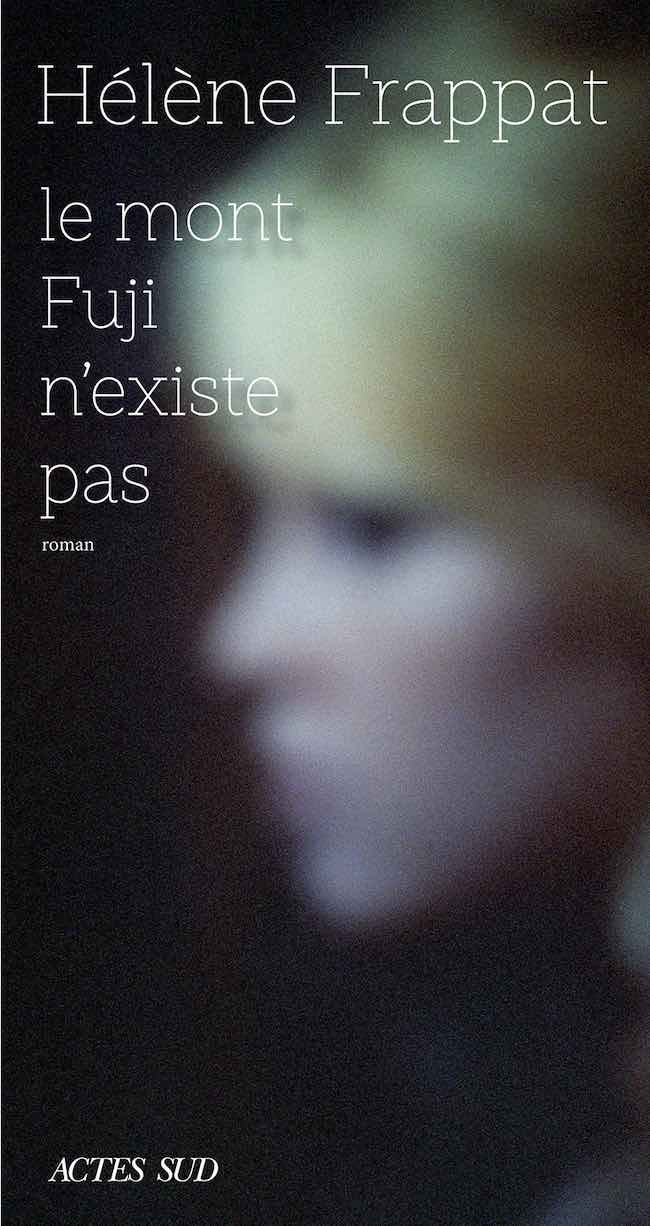
Cette dimension réflexive confine à la mise en abyme. Observant l’homme richissime dans sa villa de Marrakech, la narratrice voit « un ancien maître du monde déchu à la suite d’un scandale n’ayant épargné aucune partie du monde qu’autrefois il dominait, plo[yant] son cou de Minotaure pour assister à un spectacle d’enfants ». Elle ajoute : « Je n’apparaissais pas dans la scène, qui serait narrée à la troisième personne, à travers le regard de mon personnage, Agathe. » Le titre du roman à naître, dont Agathe serait justement le personnage central, surgit lors d’un échange avec une amie. Ce roman, intitulé Le mont Fuji n’existe pas, se distingue (bien qu’il ait le même titre) du livre que nous avons entre les mains et qui se niche dans le creux, dans l’espace vide laissé par le projet originel, faisant advenir pour nous une forme inédite.
Les traces qui demeurent de ce roman avorté, ce sont d’abord les rencontres réelles avec les personnes qui pouvaient l’inspirer. Hélène Frappat se montre en quasi-reporter, carnet à la main : « Dans le carnet consacré au Mont Fuji n’existe pas, j’ai oublié de dater mes notes. » Ces entretiens sont des supports concrets donnant lieu à des chapitres figurant dans le roman initialement envisagé, dont des pages entières nous sont quelquefois livrées. Est mise alors en avant une interrogation sur l’écart entre le souvenir transformé en fiction et le réel, sur l’incidence que l’un peut avoir sur l’autre.
« Originellement, Le mont Fuji n’existe pas comportait une galerie de personnages, dont certains, telle Irène, […] m’avaient été dictés par l’imagination. » Cette nageuse fictive va trouver une sorte de modèle après coup : « Maria Grazia agitait ses boucles sombres, s’exclamant en riant qu’elle arrêtait la teinture, “non ho niente da nascondere !”, je n’ai rien à cacher !, lorsque la femme que j’avais sous les yeux se confondit avec le personnage auquel j’avais renoncé avec peine, depuis que Le mont Fuji n’existe pas s’était mis à accueillir des personnes. / Je n’avais pas emporté sur l’île le carnet, entamé à l’automne 2013, dans lequel j’ébauchais à grands traits le personnage d’Irène, à l’époque dépourvue de prénom. Dans ma mémoire, elle n’avait pas d’enfants. Je fus étonnée, déçue presque, lorsque Maria Grazia mentionna les siens, comme si, depuis que les deux silhouettes de nageuses avaient fusionné […], la nageuse réelle n’avait plus le droit de se distinguer de la nageuse en imagination, au risque de perturber l’architecture fragile du roman. » Cette superposition d’images reflète bien la fusion du roman originel avec celui auquel il a abouti. Si la romancière voulait transformer des personnes en personnages, c’est à rebours le retour vers les personnes elles-mêmes que nous montre Hélène Frappat après qu’elle a renoncé à la fiction – ce qui semble s’être imposé à elle –, tout en gardant la trace du premier projet. Cela suit le mouvement du flux et du reflux : élan vers la fiction, puis retour sur le réel donnant naissance à une forme hybride, comportant une dimension à la fois métatextuelle et agréable. Ce travail de contact avec le réel et son double trouve sa marque concrète dans le livre : les chapitres intitulés « Souvenirs de plomb » et « Une semaine de vacances » reproduisent les pages abandonnées du roman initial, ils constituaient les chapitres éponymes de ceux que nous lisons.
Dès lors, le titre même du livre peut interroger : le roman envisagé sous le titre du Mont Fuji n’existe pas existe-t-il encore, ou n’existe-t-il plus dans le livre final ? Une métamorphose a eu lieu. Est-ce encore un roman ou est-ce autre chose ? Plus encore, quelle place et quelle valeur accorder au réel rapporté par le truchement de l’écrit ?
Comme l’indécidable lié à la réalité et à sa représentation, la montagne concrète se trouve-t-elle dissimulée sous une brume épaisse ? Et de conclure : « nous sommes aussi friables que les éboulis des falaises, car nous sommes de passage, de même que les personnes et les personnages, les humains aux prénoms variables, les animaux où les humains se reconnaissent, passent, sous l’œil énorme, sous l’œil impersonnel du roman. […] Ils suivent le défilé des nuages, qui dissimule le mont Fuji, et pour eux, se lèvera peut-être ».





![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)






