Disons-le tout de go : Le grand rire des hommes assis au bord du monde, le premier roman de l’Autrichien Philipp Weiss, qui nous arrive précédé d’un battage médiatique énorme et d’articles promotionnels sans modestie excessive rédigés par l’auteur lui-même, est un pétard mouillé.
Philipp Weiss, Le grand rire des hommes assis au bord du monde. Trad. de l’allemand (Autriche) par Olivier Mannoni. Cinq volumes en coffret. Seuil, 1 088 p., 39 €
Le roman de Philipp Weiss commence par 315 pages remplies du journal intime d’une donzelle française, Paulette Blanchard, témoin et dans une certaine mesure actrice de ce moment clé de l’histoire des révolutions utopistes avortées – très exactement, noyées dans le sang –, la Commune de Paris. Fille exaltée et un peu niaise d’un grand bourgeois, elle se lance à corps perdu dans l’aventure, portée par la vague née de l’écroulement brutal et imprévu de l’Empire de Napoléon le Petit. Ce qui l’anime, c’est à la fois le féminisme, que cette ignorante découvre en essayant d’échapper à un mariage arrangé, et, simultanément, le militantisme en déployant toutes sortes d’efforts assez brouillons afin de surmonter l’inculture abyssale qui était le lot imposé par la bonne société aux jeunes pucelles de son temps.
Là-dessus, rencontre avec un tribun communiste qui se soucie plus de politique que d’amour, assassinat de ce héros par les Versaillais, dépression, résilience, voyage de divertissement à Vienne où le monde nouveau de l’industrie s’ouvre devant les yeux extasiés de la gamine, engouement pour le pavillon japonais et finalement pour un beau natif francophone, départ pour Tôkyô, mariage, inévitable désastre car là-bas aussi le machisme est roi, fuite, disparition… Que de péripéties ! Comme dans un roman de Jules Verne, ce devrait être palpitant, mais tout se réduit en fait à une accumulation de fiches documentées, sans aucune vibration parce que l’essentiel manque : des personnages capables d’incarner un fouillis d’idées généralement justes. Hélas ! donc c’est ennuyeux comme la pluie.

Philipp Weiss à Paris (juin 2021) © Jean-Luc Bertini
Le second volume, « Jona Jonas » (164 pages), plus court, est nettement moins dormitif. Un bel androgyne, photographe de son état, y recherche au Japon, en 2011, une certaine Chantal Blanchard, descendante de la précédente. Chantal est son amante. Plus âgée que lui, chercheuse brillante notamment en informatique (les femmes ont pris du galon) et déglinguée psychique notoire (comme il se doit pour une scientifique mal dans sa peau), elle a disparu pour des raisons obscures.
Que croyez-vous qu’il arriva ? Naturellement, le tremblement de terre de Fukushima, suivi du tsunami et de la catastrophe nucléaire. Ce qui permet à l’auteur plein d’astuce de coupler une dérive dans le Japon des profondeurs avec des enquêtes de type journalistique sur un accident technologique majeur. Nouveau déploiement de fiches bien faites, mais toujours aussi peu de personnages vraiment crédibles et non stéréotypés, en dépit de différentes confrontations lors de reportages, notamment avec un ouvrier irradié de la centrale, et quelques considérations bienvenues sur le sous-prolétariat des burakumin, ces hors-caste dont le Japonais moyen n’admet même pas l’existence. Kurosawa fut ostracisé et quasiment chassé de sa patrie pour leur avoir consacré son Dodeskaden en 1970, ils accomplissent pour ne pas crever de faim les tâches le plus dégradantes et les plus dangereuses, comme écoper l’eau fortement radioactive du chantier éventré de la Tepco : un bon article de magazine sans pathos.
Le troisième long volume (300 pages), le plus riche en informations intéressantes, reprend le principe des notes encyclopédiques de la première Blanchard, mais c’est ici la seconde, Chantal, qui réapparaît aux yeux du lecteur, en partie pour se justifier d’avoir sacrifié son amour pour Jona à ses ambitions de chercheuse. Elle se livre alors, dans plusieurs « Cahiers », à un flot d’élucubrations philosophico-scientifiques sur son aïeule retrouvée momifiée sur la Mer de Glace (un clin d’œil à Ötzi, le cadavre du voyageur sarde vieux de 5 300 ans exhumé en 1991 par le réchauffement climatique), un crâne d’enfant fossile qui serait l’ancêtre des Japonais, enfin l’état actuel des sciences fondamentales.
On ne s’étonnera pas qu’un amateur de vulgarisation scientifique comme moi ait lu avec attention et apprécié l’essentiel du bon résumé des découvertes qui, de l’article consacré par Einstein en 1905 à la relativité à la prodigieuse et bien réelle celle-là révolution de la mécanique quantique, et des progrès foudroyants de la paléontologie et de la génétique des populations à la théorie de l’information, ont bouleversé de fond en comble l’image que nous avons du Cosmos.
On ne s’étonnera pas plus que le pamphlet de Chantal Blanchard, « Détruisez-vous ! », où elle conseille à l’espèce humaine, devant les ravages de son hybris, le suicide pur et simple, consonne en grande partie avec les sentiments raisonnables de l’honnête homme d’aujourd’hui sur la question, et recueille donc notre approbation intellectuelle. Passages fort arides toutefois pour la majorité supposée des lecteurs, et tentatives en tous sens de l’auteur pour égayer la chose à l’aide d’une gymnastique typographique censée faire « design contemporain » et qu’on me permettra de trouver aussi inepte que l’est le culturisme s’attaquant à la disgrâce des corps.
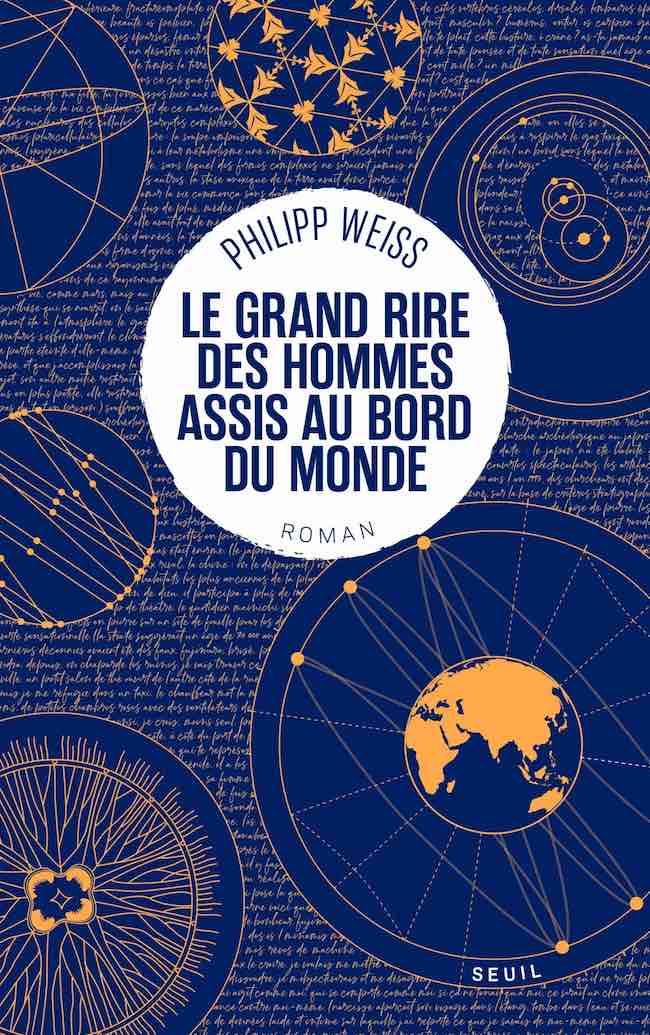
De même – et cette fois-ci je suis formel – je juge tout bonnement indécent l’heureusement bref opuscule 4 (94 pages) « Akio Ito », qui prétend transcrire les impressions d’un garçon de six ans devant la disparition de ses proches dans le tsunami de Fukushima. L’imitation du langage enfantin, que vient constamment polluer la compassion jouée du narrateur adulte, étranger à la culture japonaise, fait grincer des dents. Laissons aux auteurs locaux, qui s’y connaissent en matière de dévotion à l’innocence blessée, le soin de pleurer sur leurs propres morts.
Arrivé en ce point, un regard rétrospectif tente d’embrasser les ambitions démesurées et l’autosatisfaction sans faille d’un auteur qui manque singulièrement de sévérité à l’égard de lui-même. Le constat d’échec est simple à établir. Un roman, même et peut-être surtout un roman philosophique, se doit d’être l’aventure de personnages aussi complexes, mystérieux et attachants – ou repoussants – que des êtres vivants. Faire circuler le sang chez des tigres de papier est incompatible avec la platitude (correcte) d’une écriture sans génie.
Autrement dit, on cherche l’art. Il n’est nulle part dans cet assemblage d’idées sans corps. Ou plutôt non, on l’entrevoit dans le dernier volume, « Abra Aoki » (184 pages), où l’artiste viennoise Raffaela Schöblitz a réussi, par moments, à cloner avec habileté certain sadomasochisme typiquement nippon inhérent à l’art populaire des mangas. Notamment dans une belle séquence qui emprunte son inquiétante étrangeté au bunraku, le plus mélancolique et le plus beau jeu de marionnettes animées qui soit au monde.
Un dernier mot et non le moindre. Le substrat philosophique de cet essai boursouflé, c’est Nietzsche. Grâce au talent de Georges-Arthur Goldschmidt, nous savons que, sans être ce qu’on appelle un rigolo, l’auteur du Zarathoustra en effet savait pratiquer « le grand rire » devant l’absurdité de l’univers et la méchanceté des hommes. Comment donner quitus à un auteur qui, au fil de 1 057 lourdes pages, promet de faire rire son lecteur, comme un autre Rabelais, et n’y parvient pas une seule fois ?












