Avec D’oncle, Rebecca Gisler signe un premier roman singulier, qui laisse apercevoir un univers original, à la fois fantaisiste et monstrueux, et présage, espérons-le, une belle œuvre à venir, entre les langues puisque l’autrice, née à Zurich, écrit en allemand et en français. Et c’est peut-être cette situation qui, en partie, lui permet d’explorer une narration distanciée et plus plastique qu’il n’y parait d’abord.
Rebecca Gisler, D’oncle. Verdier, 128 p., 15 €
Tout part d’un oncle, personnage pour ainsi dire oblique, sans descendance directe. Tout ? C’est-à-dire un imaginaire, une syntaxe cumulative faussement naïve, une forme d’humour pince-sans-rire, nécessaires pour déplier le personnage d’un oncle, resté comme suspendu sur un bord de monde à lui, enfantin, inébranlable, à qui il faut, si l’on veut pouvoir cohabiter, s’adapter comme on s’adapte à des coins de pièces biscornus, même si on rêve d’espaces plus pratiques. Or, cohabiter, il le faut, puisque la narratrice du roman de Rebecca Gisler et son frère jumeau sont, le temps d’un confinement, hébergés chez leur oncle.

Rebecca Gisler © Sophie Bassouls
Il habite en Bretagne et de sa maison la vue sur la baie est, parait-il, « magnifique » ; mais aucune description panoramique ne vient déployer pour nous les ciels, les bleus de mer, les plages, ni dire alors les états d’âme et le monde intérieur de la narratrice. Tant mieux puisque ces paysages magnifiques, on les connait déjà et qu’on aura mille autres endroits où s’enthousiasmer à nouveau à leur évocation.
Et dans ce choix de tourner le dos au lyrisme de l’intime et à ce qui est immanquablement « beau » – les premières pages sont à ce titre édifiantes – la narratrice déjà, sans le dire, tout en faisant mine de l’observer, prend en fait le parti de l’oncle. Il sera non seulement son sujet, mais aussi, l’air de rien, sa boussole esthétique, une boussole qui laisse toute leur place à l’ordure, aux détritus dont on ne peut se séparer et qui disent peut-être la part la plus passionnelle, intime et opaque, du sentiment d’exister. La narration suit l’oncle dans ses habitudes, très concrètes, parfois très corporelles. Elle détaille les bistrots de village où, plus jeune, il accompagnait son père artiste-peintre-alcoolique, les tee-shirts au nom de grandes enseignes que lui donne un collègue et dont il s’entiche au point de ne plus les quitter sinon pour une rare toilette, les objets, apparemment géniaux – mais dépourvus de toute utilité particulière –, que vendent les supermarchés du coin, pour un peu moins de trois euros et dont il peuple sa maison comme pour se donner frères et sœurs à sa ressemblance.
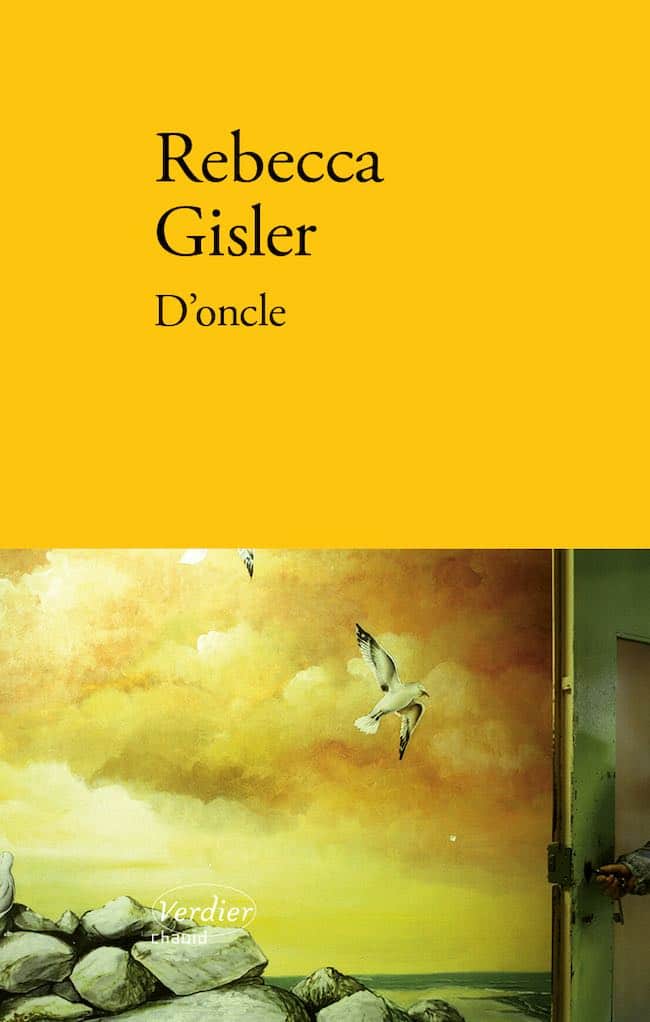
Or, si l’oncle – qui n’a pas d’autre nom – est bien un être incongru, entier, et qui se prête volontiers à l’art de la saynète – mais de moins en moins au fil des pages –, s’il est également un être monstrueux, incontinent, que d’aucuns voudraient laisser au rebut, on ne peut dire que les autres personnages soient tout à fait exempts de loufoquerie. Ainsi ses trois collègues jardiniers se nomment-ils tous trois Erwan, ce qui occasionne soudain une désopilante chorégraphie narrative, comme certaines pages de Beckett, tout en apesanteur ; ainsi la narratrice et son frère jumeau pratiquent-ils le même métier de traducteur de notices de nourriture et jouets pour animaux – et une scène dérivante laisse penser qu’eux-mêmes, à la faveur de leurs traductions, alléchés par les produits qu’ils font connaitre, se métamorphosent parfois en animaux reniflants, salivants, aboyeurs ou rongeurs. Ainsi encore ces jumeaux sont-ils perçus comme étrangers par leur propre mère, qui déplore leur accent suisse, elle qui est née et a été éduquée en France.
Petites ou grandes, les incongruités prolifèrent, et s’ajointent tant bien que mal, entrent en synergie, à la manière des pièces d’une mécanique improbable de Tinguely, brinquebalante, toujours au bord de l’effondrement mais capable de marcher. D’abord assez rodées, drolatiques, quoique dissonantes, elles articulent déjà un monde possiblement inquiétant dont les mouvements ne se laissent pas percevoir depuis un point de vue surplombant, neutre ou « normal » ; il y faut au moins un peu de fantaisie, c’est déjà un beau cadeau que nous fait l’autrice en déployant la sienne. Or peu à peu cette mécanique instable se dérègle, parce que le corps de l’oncle commence à lâcher ; et c’est alors, bien au-delà de l’incongruité, une rupture d’univers que décrit la narratrice dans la dernière partie du roman. Elle le fait sans pathos, en laissant son écriture se métamorphoser, en oscillant désormais entre saynète et mythe, et en se laissant elle-même entrainer dans un dérèglement d’enfance où nous la suivons à la trace, comme elle happés.





![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)






