Le sixième roman de Maria Pourchet, Feu, raconte une histoire d’amour adultère. Mais on ne peut résumer à cela l’un des textes les plus percutants de cette rentrée littéraire, dont le style minimaliste ne saurait être pris pour une facilité.
Maria Pourchet, Feu. Fayard, 360 p., 20 €
L’intrigue est assez simple. Laure, une universitaire, mariée, la quarantaine, mère de deux filles, Véra et Anna, rencontre par hasard Clément, un banquier, la cinquantaine désabusée, qui vit seul avec son chien. Entre eux va naître une passion dont le feu, on le comprend très vite, va tout dévorer. On dirait une romance, une bluette triviale, mais, comme souvent en littérature, l’important n’est pas tant l’histoire qu’on raconte, mais comment on la raconte.

Maria Pourchet © D.R.
Parlons tout d’abord de la forme, un choix affirmé. Maria Pourchet met un parti pris narratif ambitieux au service d’une histoire banale, avec une plume clinique, plutôt froide, mais surtout concise. Ses phrases, d’une structure généralement très simple, sont brutales, et cette économie d’écriture donne aux mots une densité qui les rend d’autant plus percutants. Le titre du livre, Feu, en est un exemple frappant. Ce mot de trois lettres renvoie à autant de facettes du roman qu’il a de significations : le feu, c’est le foyer tout autant que l’incendie, ce qui purifie et ce qui détruit, le feu de l’enfer du quotidien des personnages, mais aussi le feu sacré de Véra, ado militante et radicale, ou encore, comme au début du roman, feu la mère et feu la grand-mère de Laure, qui lui parlent depuis leur tombe. Et c’est, bien sûr, le feu de la passion.
La narration alterne les chapitres entre le point de vue de Laure, à la deuxième personne, et celui de Clément, à la première personne. Ce « tu » de Laure qui s’adresse à elle-même, un choix d’écriture en général plutôt casse-gueule, fonctionne ici avec une rare fluidité. Il donne à ses pensées une distance, quelque chose de l’ordre du constat impuissant devant les actes de ce « tu » qui n’est pas tout à fait elle-même. En contrepoint, le « je » de Clément ne présente pas seulement un regard différent, mais aussi une autre façon, plus autocentrée, de se situer par rapport au monde. Leur rencontre n’est pas simplement celle d’une femme et d’un homme, c’est également celle d’un « je » et d’un « tu ». À plusieurs reprises dans le récit, l’exposition de la même scène vue par l’un puis par l’autre exploite avec profit ces perceptions en miroir.
Autre jeu formel, les titres de chapitre : pour Laure, ils sont absents, l’espace reste vide ; ceux de Clément sont constitués du rapport médical que lui affiche chaque jour son application de santé – température corporelle, tension artérielle, etc. Mais il est normal que « je » prenne soin de lui-même, non ? Quant au ton général du roman, à l’image de l’époque, il est brutal et froid :
« – Tu es une femme de peu d’espoir, Laure, souffle-t-elle avant de raccrocher et sa phrase t’accompagne presque jusqu’au matin. Femme de peu d’espoir. Presque jusqu’au matin, insomniaque et désolée, tu la répètes, tu t’adresses au néant, à la lampe allumée, au plafond et le silence te la renvoie comme une balle dans la tronche. »
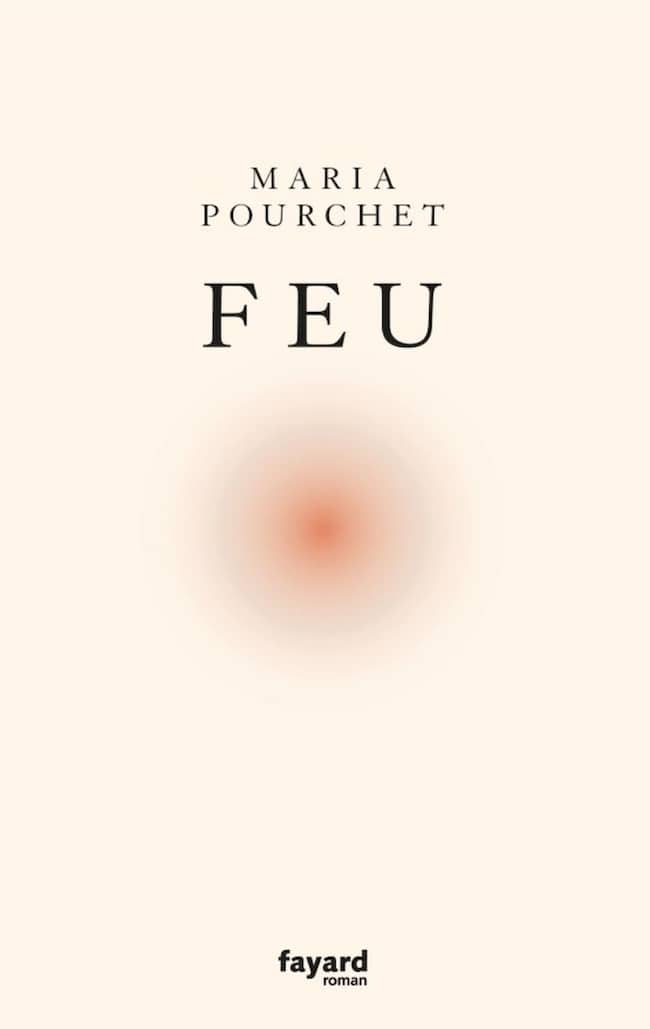
Le style a beau être concis – haché, diront ses détracteurs –, il ne fait que répondre aux usages des temps, il en reproduit les saccades, le cynisme et le minimalisme syntaxique. À première vue, on pourrait prendre cette « pauvreté » stylistique pour une facilité d’écriture, mais, bien au contraire, c’est elle qui donne à Feu sa puissance, son efficacité… et sa beauté formelle. La critique sociale portée par le texte est violente, très présente, mais, malgré la densité du propos, son expression ne se met jamais en travers de l’histoire, et Maria Pourchet intègre le monde contemporain dans le vécu de ses personnages sans forcer le trait, en filigrane.
Sur le fond, ce livre aborde plusieurs thèmes. La passion, bien sûr. Une passion adultère entre deux personnages qui n’ont pas grand-chose en commun si ce n’est que tous deux se débattent avec l’héritage culturel que leur ont légué leurs mères (d’ailleurs, tous les personnages du roman portent leur mère comme un fardeau). Laure, qui est petite-fille, fille, fille-mère, femme et mère, devient maîtresse, puis continuera de cocher tous les rôles qu’on assigne aux femmes en servant de pivot à un autre grand thème de ce livre, le féminisme. On suit l’évolution du rapport entre les femmes et la société sur quatre générations, de la grand-mère de Laure qui, debout, servait le repas à ses fils, jusqu’à Véra, sa fille aînée, une adolescente ultra-féministe, figure d’une génération convaincue que les précédentes les ont trahies en leur laissant sur les bras le réchauffement climatique, la dette et le patriarcat. Véra incarne surtout une vision plus radicale de la place des femmes dans la société, tandis que celle de la femme dans l’Histoire est évoquée à travers les interventions souvent caustiques de la mère et de la grand-mère de Laure. Enfin, en toile de fond, la société parisienne contemporaine, avec une université à la dérive et une finance insubmersible, déploie ses errements sur fond de pandémie. Son avenir, à l’instar de celui de la passion entre Laure et Clément, ne laisse pas de grandes raisons d’espérer.
Feu est de toute évidence un roman abouti, un texte puissant qui porte un regard sombre sur notre époque. Les personnages de Maria Pourchet, excessifs puisque romanesques, sont complexes, crédibles, attachants, énervants… ils incarnent quelque chose qui sonne juste dans les situations familières comme dans les sentiments extrêmes. Et un humour noir, voire corrosif, traverse l’ensemble du récit. L’écriture, maîtrisée, n’est jamais gratuite. Certes, son parti pris formel pourra décontenancer certains lecteurs, mais l’originalité a toujours un prix.












