Le livre de Mathias Delori, Ce que vaut une vie. Théorie de la violence libérale, s’intéresse à la violence qu’exercent les démocraties « euro-atlantiques » hors de leurs frontières dans leur guerre contre le « terrorisme ». Peu de réflexions ont été tentées sur cette « war on terror » lancée par Bush après le 11 septembre 2001, et, contrairement au « terrorisme » lui-même, elle n’a pas donné lieu a beaucoup d’études. Dans le contexte national et international qui prévaut vingt ans après, il est probable qu’elle n’en suscitera pas plus. Pourtant, Ce que vaut une vie montre qu’il serait primordial de s’intéresser à elle.
Mathias Delori, Ce que vaut une vie. Théorie de la violence libérale. Amsterdam, 300 p., 20 €
Cette violence est, d’abord, inefficace et meurtrière. « On a pris une mitrailleuse pour tuer un moustique », a dit en 2010 un ancien responsable du service de renseignement extérieur français pour la décrire. Avant d’ajouter qu’on avait raté le moustique et fait beaucoup de dégâts. Aux optimistes qui penseraient que la mitrailleuse a cependant réussi à atteindre quelques mois plus tard Ben Laden, on objectera que ce succès est avant tout spectaculaire et symbolique, et n’a rien changé au cours violent de la violence « terroriste ». Quant au bilan « quantitatif », Delori signale qu’il y a eu environ 4 000 victimes civiles du terrorisme en Occident depuis 2001 et que les trois premiers mois de guerre contre le « terrorisme » en Afghanistan à eux seuls en ont fait plus de 4 000. « La violence anti-“terroriste” est donc beaucoup plus meurtrière que le mal qu’elle prétend combattre », ajoute-t-il.
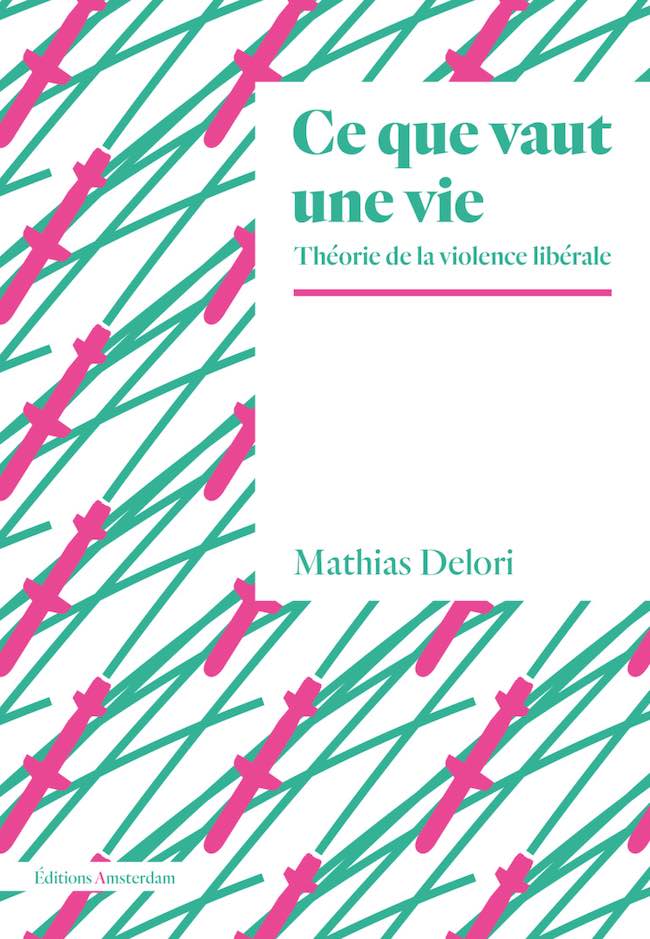
Delori ne livre cependant pas ces informations déjà connues pour dénoncer la cruauté ou l’absurdité des stratégies anti-« terroristes » des démocraties, mais pour se demander comment les sociétés s’en accommodent et quels cadres de pensée leur permettent de les justifier. En effet, les populations des pays occidentaux en guerre contre le « terrorisme » restent assez indifférentes à l’inutilité des actions menées et à leur immense coût en vies humaines innocentes. Comment est-ce possible ? Quels modes de réflexion servent cette apathie ?
L’auteur fait d’abord un pas de côté et avance des précisions à la fois sur l’objet de son étude (les discours et la politique de torture et de bombardements de Bush et ses alliés), ses méthodes et les notions qu’il va devoir utiliser. Ainsi signale-t-il, puisqu’il le faut encore, que la notion parfaitement floue de « terrorisme » possède surtout pour les États l’avantage de réussir à s’appliquer à X ou Y suivant leurs intérêts particuliers et leurs buts stratégiques. Aujourd’hui, elle permet de renouer avec la vieille opposition entre ennemis et amis de la démocratie et de la liberté, dont la chute de l’URSS les avait privés, et de recréer l’illusion d’un front « euro-atlantiste » commun.
Ensuite, Delori, dans différents chapitres (« Déshumanisations postcoloniales », « Réifications modernes », « Mythes du moindre mal »…), mêle outils philosophiques, historiques et sociologiques pour scruter les manières dont l’autre lointain ou l’ennemi est considéré et dont les violences commises sont construites comme légitimes ou illégitimes, intentionnelles ou fruits du hasard (les fameux « dégâts collatéraux »). Il se tourne aussi vers le droit de la guerre et ses interprétations, pour montrer l’élasticité des perspectives sur la violence suivant l’identité de ses auteurs, la manière de l’infliger, et les buts ultimes poursuivis.

Couverture du Times du 1er octobre 2001, au moment de l’invasion de l’Afghanistan © D.R.
Les conclusions de cette réflexion, pour être sans surprise, sont finement énoncées jusque dans les contradictions qu’elles mettent au jour. Ainsi peut-on penser qu’aujourd’hui la justification de la guerre contre le « terrorisme » et de ses violences se fonde sur l’idée « d’une société imaginaire transnationale, aux frontières mouvantes mais dont le socle est l’idée que [les démocraties libérales] se font de la vie bonne ». L’autre lointain doit pouvoir être conçu comme acquis à cette idée pour être perçu comme tout à fait humain. Delori analyse ainsi le discours de sa « déshumanisation partielle » et le distingue d’autres qui l’ont précédé, que ce soit celui, idéologique, de naturalisation de l’ordre colonial du XIXe siècle, ou du racisme au XXe. Cet autre lointain risque donc fort de voir son existence considérée comme « non grievable » (non digne d’être pleurée), suivant les mots de la philosophe Judith Butler, car si, de manière abstraite, les démocraties accordent la même valeur à toute vie, dans les faits non. Qui adhère aux critères libéraux de la « vie bonne » est beaucoup plus humain.
Les deux « référentiels » de la guerre contre le terrorisme, quant à eux, se mélangent sans cesse dans cette pensée libérale : il s’agit, d’un point de vue nationaliste, de protéger les populations « euro-atlantistes » des djihadistes ou autres criminels fanatiques, et, d’un point de vue universaliste, d’aller au secours de peuples étrangers, au nom d’idéaux incontestables. À ces justifications de l’utilisation de la violence s’ajoutent, lorsque pointe le doute, les imparables théories de la non-intentionnalité des « dégâts collatéraux » et du « moindre mal ».

Couverture du Times du 20 mai 2011, au moment de l’exécution d’Oussama Ben Laden © D.R.
Pourtant, on aurait des difficultés à y adhérer lorsqu’on considère un autre aspect de la guerre anti-« terroriste », celui de ses violences de masse, celles, par exemple, causées par les embargos, tout aussi « non intentionnelles » que les dégâts guerriers collatéraux et bien plus meurtrières. Nous nous souvenons de Madeleine Albright à qui une journaliste demandait en mai 1996 si la politique de sanctions menée par les Américains contre l’Irak qui avait causé la mort d’un demi-million d’enfants – « plus que le nombre d’enfants tués à Hiroshima », disait-elle – lui paraissait « en valoir le prix », et Albright de répondre, après quelques secondes de réflexion : « Je pense que c’est un choix très difficile mais c’est, je pense, le prix à payer. » (« It is worth the price. »)
Le livre de Mathias Delori permet de sortir des rhétoriques du « prix à payer » ainsi que d’autres, tout aussi discutables, et de réfléchir. Bien plus, suggérant que « la violence n’est pas le seul moyen d’arrêter la violence », il envisage même des solutions alternatives dans la « guerre contre le terrorisme ». Ma foi !
Ce que vaut une vie explicite, en tout cas, les mécanismes intellectuels et moraux qui aident nos sociétés à hyperboliser le mal qu’on leur fait et à euphémiser celui qu’elles font. Il ouvre des pistes de réflexion, et rend l’espoir d’une possible régénération du débat civique et éthique.





![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)






