Dans La nuit folle, Jacques Henric s’interroge une fois de plus sur le Mal : comment et pourquoi les hommes (et les femmes) y succombent-ils ? « Comment, où et quand tombent-ils, les hommes ? » Contrairement à celles de son livre Carrousels (Seuil, 1980), qui étudiait le lien entre la chute d’un seul, Adam, et la dégringolade de tous, les chutes, d’une catastrophe l’autre, deviennent ici exclusivement individuelles. Chacun, c’est-à-dire « chaque un », étant sujet à tomber. Et la nuit en constitue le lieu propice : guerre, sexe, drogue…
Jacques Henric, La nuit folle. Seuil, coll. « Fiction & Cie », 240 p., 19 €
On savait déjà que Jacques Henric était travaillé par cette phrase d’Herman Melville : « J’aime tous les hommes qui plongent », qu’il l’avait mise en exergue de son roman Walkman (Grasset, 1988). On savait que les chutes, collectives et individuelles, étaient l’un de ses thèmes de prédilection, en particulier, donc, dans Carrousels. Enfin, on connaissait l’intérêt profond de l’écrivain pour les liens indissociables entre la création et le Mal – voir, de manière exemplaire, La peinture et le mal (Grasset, 1983).

La chambre de Joë Bousquet © CC/Angeline Estrade
La première, et principale, figure de ce nouveau livre est le poète désormais légendaire (et qualifié de Grand par notre romancier) Joë Bousquet. Si sa présence ici doit beaucoup à la rencontre inopinée avec l’un des amours du poète, Germaine, dite Poisson d’Or, à l’occasion d’un colloque sur Artaud à Rodez, elle trouve tout son sens dans sa chute lorsqu’il est fauché par une balle allemande (peut-être tirée par le peintre Max Ernst, apprend-on…), près du Chemin des Dames, le 27 mai 1918. Voici comment Henric voit (imagine) la chose : « Quand un projectile frappe une cible avec une grande énergie […], il lui communique sa vitesse cinétique et lui donne la direction de son mouvement, en l’occurrence de sa chute. Touché de face par tout projectile […], l’homme tombe à la renverse, sur le dos, comme le soldat républicain espagnol photographié par Robert Capa ». Henric a toujours aimé la précision dans les descriptions : pas de flou plus ou moins artistique, pas de pathos, pas de romantisme ronflant et idéalisant, mais, « les yeux bien droit dans la fente » (Archées, Seuil, 1969), savoir voir (c’est-à-dire, « ça »-voir), un cadavre, une plaie, un sexe, un anus… et savoir décrire ce que l’on voit. Le difficile, c’est de voir ce que l’on voit, dit-on.
« Pour être sauvé, Kafka prétendait qu’il fallait être à terre, couché » : Henric prend acte de cette déclaration, et brosse, dans un chapitre entier, des portraits de tout un tas de célébrités côtoyées (Arthur Adamov, Philippe Sollers, Pierre Guyotat, Michel Houellebecq, Jean-Pierre Léaud…) qui, un jour, tombèrent plus ou moins lourdement devant lui. Ce faisant, tous ces « monstres » en ressortent, si ce n’est sauvés, plus humains trop humains : « Ils avaient à se coltiner le mal qui était en eux… »
Joë Bousquet tombe ; il décide alors de se calfeutrer dans une petite chambre devenue très « célèbre » de la rue de Verdun à Carcassonne, de tirer tous les rideaux, et de se couper définitivement du jour et de son trop de réalité : fondu au noir ! « Ayons en tête que pendant vingt ans, à cause des fenêtres obstruées, l’officiant du lieu n’a plus jamais été témoin du passage des jours et des nuits […] Sa pendule marquait imperturbablement la même heure : 3 heures. » Très habilement, Henric nous conduit dans cette folle nuit perpétuelle du poète à travers sa propre expérience d’une autre forme de nuit, celle d’une demi-cécité (comme pour Joyce) qui le prend lors d’une déambulation, à moto (autre écho de la fin de Carrousels), autour des lieux fréquentés par Bousquet vers La Franqui dans l’Aude.
« D’un coup, la moitié supérieure du pare-brise est envahie par un millier de taches sombres, quelque chose entre une toile d’araignée dense et un bas résille » ; puis « à nouveau le rideau tombe, masquant une moitié du ciel » : l’écrivain a compris – « Hémorragie œil complet avec HIV sans décollement de rétine mais opercule. / Cataracte cortico-nucléaire dense œil droit/œil gauche. » Henric avait déjà recopié tel quel un semblable compte rendu médical, dans toute sa sécheresse, dans un précédent ouvrage, La balance des blancs (Seuil, 2011), après les premières atteintes d’un cancer de la prostate. On peut donc dire que le romancier, d’un livre l’autre, sera passé du blanc au noir, ce noir que Bousquet situe « d’avant la lumière » : « Que la ténèbre et l’éclair te baignent ! » Et puisque « avoir des visions exige d’avoir plongé dans la nuit totale » (on se souvient d’Homère, mais aussi de Tirésias : « perdre les yeux vous vaut un don de prophétie »), nous serons, lecteurs, rassasiés : « Des lettres [d’amour], des mots ont manqué. / Les images ont suivi », prélude à la Grande Image : « Ces jeunes filles ont le sens du jeu, un trou de l’une s’offre à la pénétration, puis se refuse, puis s’exhibe à nouveau et s’y soumet. » Telles sont les rêveries rapportées par le poète dans son Cahier noir, écrit clandestin, et souvenir d’une « nuit folle », comme l’appela l’une de ses passagères des nuits de 1931, Ginette, nuit qui donne son titre au livre.
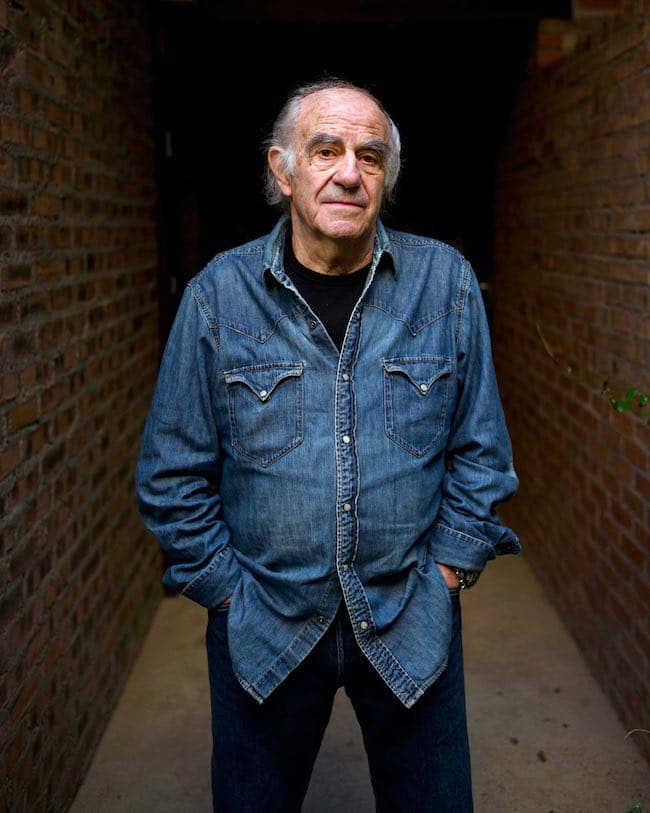
Jacques Henric © Jean-Luc Bertini
Pour les connaisseurs de son œuvre, on peut dire que La nuit folle ramasse et rassemble tous les thèmes chers à Jacques Henric, depuis au moins Carrousels : le Mal (la peinture et le Mal ; la littérature et le Mal ; le sexe et le Mal ; la folie des foules, des masses) ; le sexe (avec un retour sur le célèbre livre de sa compagne, La vie sexuelle de Catherine M., qui apparaissait déjà, en fait et en filigrane, dans Carrousels (« Femme partagée comme on rompt le pain on déchire ses vêtements ») ; l’instant formidable, ou kairos, qui permet « l’être-là » au monde, hic et nunc ; la rédemption du Mal (le plus souvent catholique), l’amour (« Sans la médiation de l’amour, l’homme et la femme ne peuvent se regarder face à face » : vous avez mieux ?) ; etc.
Ce qui est nouveau ici, c’est une réflexion profonde sur les paradis artificiels, c’est-à-dire la drogue, « ce trou noir de quelque soleil ». Il faut dire que le sujet, Joë Bousquet confiné dans sa chambre pendant plus de trente ans, s’y prêtait bien : il « se disait qu’il fallait bien être un peu celui qui doit se donner à l’anéantissement et incarner le mal pour savoir quelle douleur il est dans autrui ». Comment l’homme blessé si jeune, l’homme tombé au combat, foudroyé dans la plus grande boucherie de l’Histoire, diminué, n’aurait-il pas eu besoin de tels remontants ?
Mais il y a plus : « Avoir des visions exige d’avoir plongé dans une nuit totale » (on l’a déjà noté, mais on le répète) : nuit sexuelle, nuit d’opiomane ou de cocaïnomane, nuit de confiné volontaire dans le noir, etc. « Un homme a perdu ses jambes et, sans perdre sa sexualité, a perdu queue et couilles. Il a vingt ans. Il n’a pas perdu ses yeux. » Ses écrits, ses nuits avec ses passagères très spéciales, « jeunes démones » note Henric, consisteront à « faire oublier son impuissance […] pour réveiller sa sexualité restée intacte dans ses os, plus vive encore que celle de sa jeunesse ».
Jacques Henric, lui aussi, et comme Melville, aime tous les hommes qui tombent ; mais, on l’aura compris, il veut « pour [sa] part savoir comment ils sont tombés ». Dont acte. Et ce livre est l’histoire de la façon dont tous se sont relevés : « Appel téléphonique de P. S. le lendemain matin. En pleine forme, voix enjouée. Ne se plaint que du saignement… »



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)








