Avec son recueil Daddy et sa longue nouvelle Harvey, Emma Cline développe sa vision californienne, révélée il y a cinq ans dans son premier roman, The Girls. Mieux que personne, elle traverse les couloirs spéculaires du spectacle américain, des centres commerciaux aux plateaux de tournage, des chambres d’hôtel aux pavillons de banlieue, en captant le langage trivial, ramassé et soi-disant ironique d’un peuple évoluant sur le fil du rasoir de l’éternel présent, hanté par des souvenirs enfouis, incarnant dans sa détresse les paroles des Eagles dans Hotel California : « You can check out any time you like, but you can never leave ! ». Du pur génie, sur le mode décontracté.
Emma Cline, Daddy. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch. La Table Ronde, 272 p., 22 €
Emma Cline, Harvey. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch. La Table Ronde, 112 p., 14 €
« Le cauchemar climatisé », titre d’un livre de Henry Miller, conviendrait ici. Après The Girls, roman inspiré de la secte de Charles Manson, Emma Cline revient sur ses thèmes de prédilection : les rapports entre les adolescentes et le pouvoir masculin ; les addictions à l’alcool et à d’autres drogues ; le divorce et la déchéance ; la sensualité sadique et cruelle des êtres dégoûtés par leur propre corps ; l’obsession pathologique de l’argent ; et, pour mettre du panache, l’auto-mise en scène. Bref, l’Amérique.

Emma Cline © Ricky Saiz
Si, au début du XXe siècle, l’industrie cinématographique était concentrée à Hollywood, aujourd’hui elle s’est diffusée partout : de l’État du Maine à celui de l’Oregon, en passant par la Floride et le Texas, chaque citoyen devient la star d’un long métrage ; s’exprimant avec ironie, il regarde d’en haut ses pauvres interlocuteurs, exclus de la projection privée de sa vie, obligés de se fier aux apparences. D’où l’importance chez les anglophones du mot « like » (qui pourrait se traduire par « genre », « je veux dire » ou « tu vois ? »), utilisé à outrance pour signaler l’incommunicabilité du sujet.
N’en déplaise à la plupart des romanciers contemporains, l’Ancien Régime n’existe plus : la conscience humaine a eu sa révolution. Peu nombreuses sont les Lumières qui l’ont compris, parmi lesquelles Emma Cline. Pourtant, son style post-révolutionnaire ne cède jamais à la nostalgie, ni à la mélancolie : comme le Bouddha, elle reste dans l’acceptation du présent, ne cherchant qu’à l’écrire avec poésie et tendresse.
Harvey Weinstein – le héros de Harvey – mérite-t-il, lui aussi, miséricorde ? Les méfaits des gros pervers sexuels ont-ils influé sur la transformation de la conscience humaine ? L’état d’esprit californien découle-t-il de #MeToo ? Emma Cline semble le croire ; sa prose désinvolte, déracinée et floue ne cesse d’exposer la quête, frustrée, d’un Daddy honni. Dont l’ex-producteur de cinéma, dépeint de manière absurde. Dans la nouvelle – initialement publiée dans The New Yorker et intitulée « White Noise » (« Bruit de fond »), ce qui est aussi le titre d’un roman de Don DeLillo (1985) –, Harvey est planqué dans une maison du Connecticut où il attend le verdict de son procès, prévu pour le lendemain, alors que dans l’immeuble d’à côté habite une autre célébrité : DeLillo, un personnage fictif ici.
Loin de méditer sur son humiliation imminente, Harvey songe à un nouveau projet : adapter White Noise. Il guette donc la moindre apparition du romancier dans la maison voisine, afin de l’enrôler. Il faut savoir que le roman de DeLillo met en scène un professeur ayant inventé le champ d’études hitlériennes, un intellectuel spécialisé dans l’analyse d’un monstre. N’est-ce pas précisément la démarche d’Emma Cline ? Le point Godwin s’est-il déplacé de Berlin vers les deux côtes de l’Amérique ? Auschwitz, point focal du monde d’avant, a-t-il été remplacé par les zizis circoncis de Weinstein, de Woody Allen et de Jeffrey Epstein ?
Celui de Harvey ne sera révélé qu’en creux, énigme centrale d’un corps pour le reste examiné en détail. Harvey paraît ne pas se rappeler les péchés commis par l’organe fautif : « Il se souvenait à peine de toutes les choses qui s’étaient produites, et par conséquent il avait écouté avec un certain intérêt les témoignages, au début, curieux d’entendre ce qu’il était censé avoir fait. Mais c’était vite devenu ennuyeux […] On avait l’impression que tout se déroulait du mauvais côté d’un télescope, c’était loin et déformé : des bobards qui se passaient dans des chambres d’hôtel, des couloirs de restaurants fermés depuis presque dix ans. Le Bar 89 n’existait plus ».

Le télescope qui s’étend et se rétracte, c’est Harvey, peu disposé à considérer son passé, préférant – une fois n’est pas coutume – foncer dans une poursuite effrénée des stars. En présentant son projet à ses avocats, il cite de mémoire ce qu’il croit être la première phrase de White Noise ; hélas, il s’agit de l’incipit d’un roman de Thomas Pynchon, L’arc-en-ciel de la gravité (1973). Peu importe, l’œuvre compte moins que l’idée : l’Amérique est un pays platonicien, ses yeux sont braqués sur le mur de la caverne, où l’on voit l’image du spectacle. « Incroyable, tout ce qu’ils faisaient de nos jours. Une telle quantité de fric, c’était presque obscène ! […] Leur rôle à eux était de façonner la culture, il l’avait toujours dit : tout découlait de lui, de personnes comme lui, des choix faits dans une certaine pièce dans un certain immeuble de Manhattan, des choix qui façonneraient le discours. Et Don DeLillo respecterait ça. […] White Noise. Ils pourraient réaliser un véritable coup d’art et d’essai, en insistant sur le fait que c’était un film à l’ancienne, un classique. »
Une idée, chose purement abstraite, crée de l’argent : quel langage convient à ce processus dématérialisé, à part les SMS ? Harvey ne cesse de pianoter sur son téléphone : « C’est le MOMENT IDÉAL pour faire CE FILM, écrivit-il. On a faim de sens et c’est le grand roman américain. » Plus tard, il dicte à son assistante : « Nancy stp envoie Chiffres ASAP que je les présente à don delillo 2main soir, trouve un bon resto dans le coin, réserve, peut venir avec sa femme s’il en a une ou petite amie. » Il n’y a plus de hiérarchie, que ce soit entre personnes réelles et fictives, entre célébrités et inconnus, entre texto et poésie, entre culture et marchandise ou entre minuscules et majuscules.
Dans cet univers virtuel, une activité charnelle – dîner au restaurant – est-elle possible ? Habite-t-on encore un corps ? « Qu’était donc Harvey en réalité, à part une silhouette en carton, une idée de lui-même ? » Pauvre Harvey, pourquoi diable a-t-il besoin d’un point d’ancrage, d’une figure paternelle, d’une étoile polaire ? Au milieu de sa nuit troublée, il la trouve illuminée à l’intérieur d’une voiture : « Là, la clôture. Et de l’autre côté, il y avait Don DeLillo. Il était toujours assis dans la voiture, il parlait au téléphone […] un rectangle de lumière éclairait son visage d’un bleu écœurant […] Don DeLillo saurait quoi faire. Comment réparer tout ce qui était allé de travers […] Don DeLillo ne voyait-il pas à quel point ils se ressemblaient, ne le sentait-il pas ? »
Daddy, recueil de nouvelles publié l’année dernière aux États-Unis, reprend cette quête d’un père, DeLillo cédant la place à d’autres hommes puissants, plutôt sur le modèle du producteur libidineux, le tout écrit dans un langage moins emprunté au romancier new-yorkais, où Cline lâche les accents macho de Harvey en faveur d’un ton insolent et frais, créant des échos de Kids in America de Kim Wilde, un timbre clean qui rappelle les Eagles, les Beach Boys et Bret Easton Ellis. Mais la pureté n’est qu’apparente, elle dissimule un arrière-fond menaçant et pervers : une violence paternelle incestueuse à laquelle les filles ne sont pas indifférentes. Dans « What Can You Do with a General », les rapports tendus entre John et sa famille remontent à ses anciennes crises de colère, aujourd’hui enfouies dans sa mémoire ; dans « Los Angeles », Alice, apprentie actrice, arrondit ses fins de mois en vendant ses culottes – glissées dans un sac alimentaire zippé – à des inconnus ; dans « La nounou », Kayla est planquée dans la maison d’une amie de sa mère, fuyant les paparazzi après la découverte de sa relation avec un acteur célèbre, dont elle gardait l’enfant ; dans « Marion », la narratrice, âgée de onze ans, se déshabille pour être prise en photo par son amie Marion, chacune étant jalouse de l’adolescente violée par Roman Polanski, et attirée par Jack, le copain de Bobby, père de Marion. Peut-on y déceler un clin d’œil au président assassiné et à son frère, réputés avoir couché avec la même actrice ? Marion = Marilyn ?
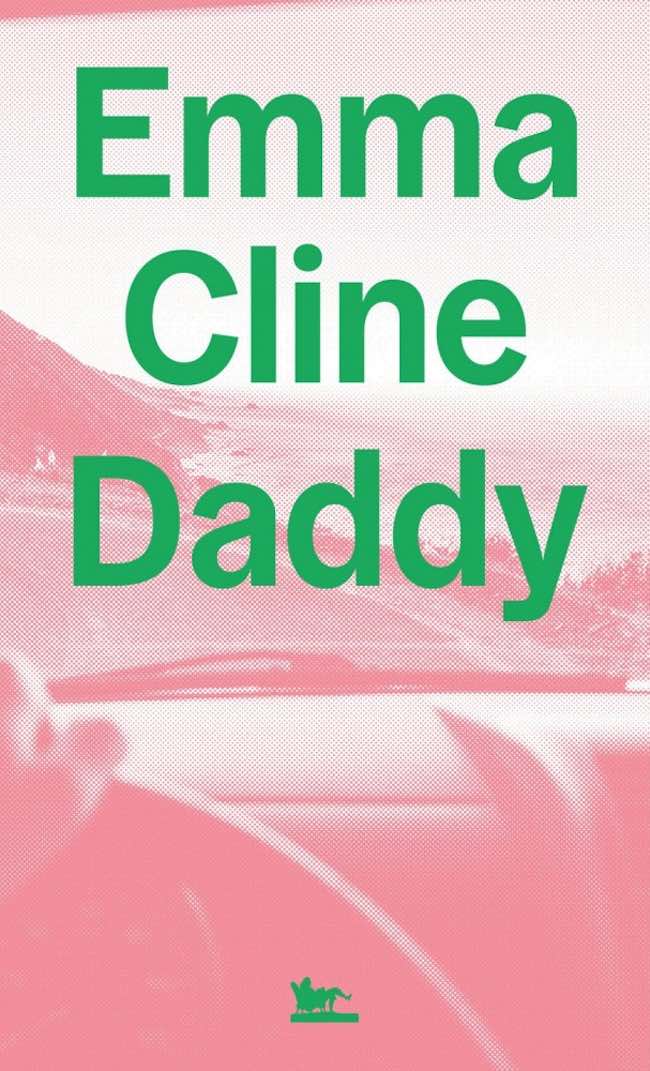
« A/S/L », la dernière nouvelle du recueil, se déroule dans un centre de réhabilitation. Ally, vingt ans, fille d’un sénateur, doit remplir un cahier de thérapie comportementale dialectique, où elle doit citer trois actions susceptibles d’améliorer sa vie. Elle pense à un autre patient, G., délinquant sexuel notoire :
1 Acheter des baskets blanches matelassées
2 Me faire un double piercing dans les oreilles
3 Baiser avec G.
Thora, sa camarade de chambre, partage ses fantasmes : « Quand Ally dormait, Thora se frottait parfois contre la paume de sa main, en imaginant le corps massif de G. derrière elle, ce ventre impressionnant après des années de gastronomie en public, cognant contre son dos. Ça fonctionnait seulement si elle imaginait que G. était convaincu qu’il lui prenait quelque chose. »
Les deux copines avaient-elles vraiment envie de cet homme rebutant ? Chez Emma Cline, la mise en scène l’emporte sur les faits : les personnages se filment, se photographient et se confient dans leurs cahiers. À part ça, ils imaginent le récit de leurs aventures avant de les vivre. L’Amérique est-elle devenue un vaste plateau de télé-réalité ? Une mise en abyme nourrie par une scène primitive incestueuse ?












