Avec Bel abîme, le jeune auteur tunisien Yamen Manai a écrit un roman qui nous donne à voir de manière brutale le mal-être traversant la société tunisienne, dix ans après sa révolution. Ce court texte, publié par les éditions tunisiennes Elyzad, s’ouvre sur une citation du groupe de rap NTM, I make music for my people, qui peut intriguer. La référence préfigure la rage qui imprègne les pages qui suivent et plus précisément le soliloque proposé au lecteur.
Yamen Manai, Bel abîme. Elyzad, 112 p., 14,50 €
Le roman de Yamen Manai ne s’apparente pas à une chronique politique, mais plutôt à la reconstitution d’un fait divers. Nous sommes plongés dès les premières pages dans une suite de vitupérations, de plaintes et d’insultes du narrateur. Aucune scène d’exposition ne nous aide à comprendre ce qui ressemble à un dialogue de sourds : un narrateur interpelle son avocat, lui explique sa situation, la justifie, mais jamais les réponses du juriste ne nous parviennent, si ce n’est par les réactions du personnage principal. L’action, la tragédie que l’on pressent, a déjà eu lieu et nous sommes réduits à la revivre uniquement par le récit récapitulatif du narrateur. Mais qui est donc ce protagoniste dont nous entendons le long cri de rage ? On comprend vite qu’il est question d’une sombre affaire judiciaire. Puis, trois pages plus loin, les choses se précisent, et se dévoile alors un cas de parricide ; non, pire, une série de meurtres.

Yamen Manai © Gabriel Carrère
Petit à petit, le narrateur reprend le fil de son histoire, explique à son interlocuteur invisible comment il en est arrivé là, comment il a pu commettre l’impensable. Il s’agit de mettre des mots sur une barbarie qui semble innommable. Un portrait se dessine : ce narrateur est un jeune garçon de quinze ans issu de la banlieue sud de Tunis, une banlieue « populaire » comme semble le suggérer l’avocat. Ce à quoi le narrateur rétorque aussitôt : « c’est pas vraiment le mot, pourrie conviendrait mieux ».
Le ton est vulgaire et les insultes fusent comme pour nous permettre de mieux éprouver la colère qui ronge cet adolescent. La syntaxe est nerveuse, les phrases courtes, pour saisir au plus près ses difficultés à ordonner ses idées, à trouver un sens à ses actes. Or, si la conclusion de son sinistre parcours nous est révélée dès le début, le lecteur ne peut manquer de s’interroger sur ses motivations : d’où vient son malaise ? qu’est-ce qui a bien pu le pousser à tuer son propre père ? Le lecteur endosse le rôle d’un procureur invisible, lisant le procès-verbal du crime afin de déterminer la peine appropriée.
Dans le récit récapitulatif des événements qui l’ont conduit à son échappée meurtrière, voici que le narrateur nous confie ses souvenirs de Bella, un chien dont il s’est pris d’affection trois ans auparavant. Soudain la prose s’adoucit, la rage laisse place à l’empathie et à la mélancolie : « Bella était mon amie, Bella était mon amour. Bella était tout ce qui a compté et qui ne comptera plus ».
Dans ce monde hostile que découvre le jeune garçon sorti de l’enfance, cet animal a joué le rôle de protecteur, une sorte de dernier rempart de l’innocence face au tumulte extérieur. Or, un jour, Bella disparaît, et le narrateur découvre que son père s’en est débarrassé. Pire, la police locale l’a abattu « pour que la rage ne se propage pas dans le peuple ».
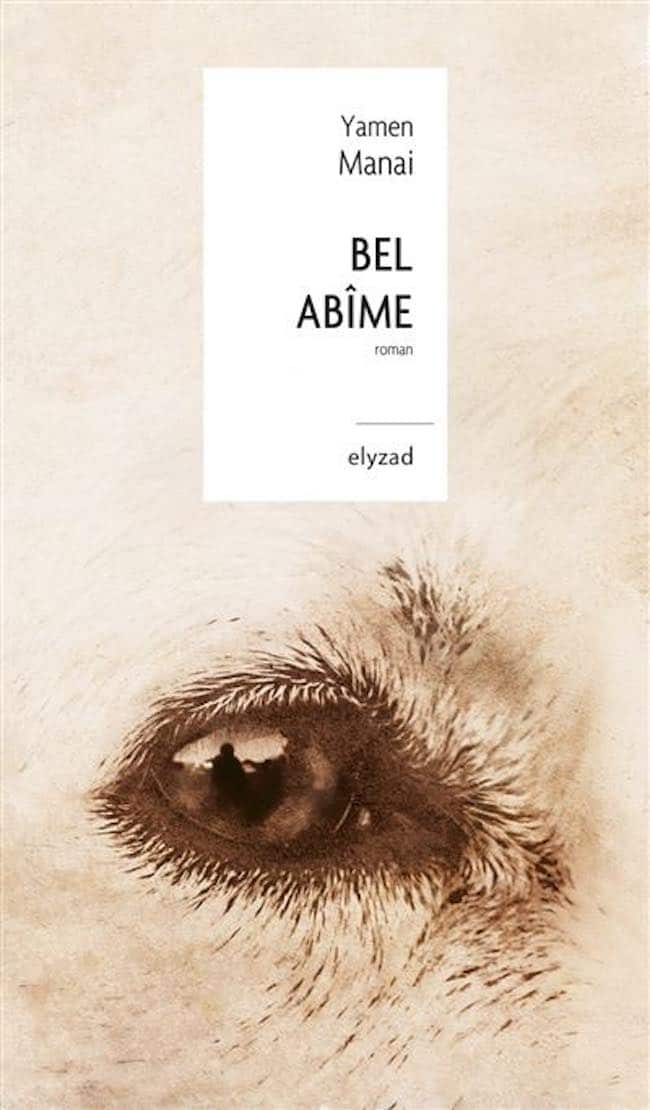
Cette rage s’est pourtant déjà propagée et c’est elle qui déclenche la folie meurtrière du personnage, qui ne peut supporter la cruauté avec laquelle sa famille et la société tout entière ont pu tranquillement accepter d’exécuter Bella. Devant ce fait divers, les magistrats (et, à travers eux, le lecteur) s’interrogent : passe-t-on à côté des signes de la radicalisation et de l’appartenance à une idéologie qui aveuglent le jeune homme ? Le narrateur ricane aussitôt l’hypothèse formulée. Il n’est pas question ici d’islamisme ou de défiance envers le système politique tunisien. La mort de Bella enclenche une spirale de violence dont l’origine peut sembler absurde mais qui renvoie à une symbolique, celle de l’innocence perdue.
En d’autres termes, le roman de Yamen Manai est celui de l’anomie, ce processus à travers lequel un individu en vient à sortir de sa communauté, à en transgresser les normes. Le récit peut se lire comme un roman d’apprentissage, ou plus précisément de l’échec d’un apprentissage. Voici un narrateur pour qui son animal de compagnie incarnait la figure du bien sacrifiée par une société fondamentalement cruelle. Dès lors que les membres de la communauté jugent acceptable l’abandon de ce chien, le narrateur en conclut qu’ils n’ont eux-mêmes plus le droit de vivre et il se met à les fusiller sans réfléchir. Ce « bel abîme » s’apparente à une spirale de violence, il n’a rien de beau et le titre est ironique.
En allant plus loin, on peut aussi voir dans cette trajectoire une allégorie amère sur la Tunisie post-Ben Ali. Ce narrateur enragé, incompris et égaré incarne la génération tunisienne qui a grandi au lendemain de la chute du régime, biberonnée aux discours d’alors sur la démocratisation du pays, sur les espoirs de tout un peuple attendant des jours heureux. Or la Tunisie de 2021 n’est pas exactement celle dont rêvaient les Tunisiens en 2011. La violence, tant physique que symbolique, avec laquelle ils ont dû faire le deuil de leurs espérances imprègne le texte de Yamen Manai. Dans une des tirades les plus saisissantes du livre, le jeune homme ironise sur le sort de son pays : « On a quand même gagné la démocratie ? La belle affaire ! Avant, on avait la peste, maintenant, on a le choix entre la peste et le choléra. Avant, on avait les quarante voleurs, maintenant on en a quarante mille. » Ce n’est pas un hasard si l’on apprend au détour d’une page que le père du narrateur était professeur de civilisation arabe ; ce n’est pas seulement la figure paternelle que le personnage a décidé d’assassiner mais sa propre identité, son « arabité ».












