Le lecteur francophone qui s’intéresse aux travaux de langue anglaise interrogeant l’ordre épistémologique occidental a appris la patience : plus de vingt ans (entre 1989 et 2012) pour lire une version française de The Empire Writes Back du trio australien composé de Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin ; treize ans (1994-2007) pour découvrir celle de The Location of Culture de Homi K. Bhabha ; plus de vingt ans encore (1985-2006) pour Can the Subaltern Speak? de Gayatri Chakravorty Spivak… et trente-trois ans (depuis 1988) avant d’avoir entre les mains la traduction française, par Laurent Vannini, de l’essai-phare de Valentin-Yves Mudimbe, aujourd’hui publié aux éditions Présence africaine dans une collection dirigée par l’historien Mamadou Diouf, auteur d’une éclairante préface.
Valentin-Yves Mudimbe, L’invention de l’Afrique. Gnose, philosophie et ordre de la connaissance. Trad. de l’anglais par Laurent Vannini. Préface de Mamadou Diouf. Présence africaine, coll. « Histoire, politique, société », 516 p., 20 €
Originaire du Congo (RDC), le philosophe, essayiste, diariste, romancier et poète, formé à l’université de Louvain, est pourtant lui-même francophone, se targuant d’incarner une « théorie de la diversité » à travers sa naissance en Afrique centrale, sa culture française et son passeport américain. C’est aussi dans ses Carnets de Berlin (édités à Québec par les éditions Humanitas en 2006) qu’il rappelle que The Invention of Africa est son « premier livre américain ». Celui-ci forme le deuxième volet d’une trilogie commencée avec un essai en français, L’odeur du père (Présence africaine, 1982) et poursuivie en anglais avec The Idea of Africa (Indiana University Press, 1994). À l’orée de ce troisième ouvrage, encore inédit en français, il achève de façonner le concept lui valant tant de citations jusqu’à aujourd’hui : la « bibliothèque coloniale » ou « Colonial Library ».
Si le terme apparaît sporadiquement dans The Invention of Africa, l’exploration de ce fonds de textes et de discours y est quant à elle menée méthodiquement : un ensemble de productions textuelles européennes sur l’Afrique ayant tout à la fois élaboré un corpus de connaissances et concouru au projet politique de domination, tant il est vrai, rappelle Anthony Mangeon (La pensée noire. De la bibliothèque coloniale à Barack Obama, Sulliver, 2010), qu’atteindre au secret de l’Autre, c’est pouvoir « en définitive le domestiquer ». La bibliothèque coloniale représente ainsi la forme aboutie d’un savoir-pouvoir totalisant sur l’Afrique.

Chacun des cinq chapitres du livre constitue un essai relativement autonome. À l’image du Foucault de L’archéologie du savoir et de L’ordre du discours, recherchant ce qui rendrait possible un « décentrement qui ne laisse de privilège à aucun centre », Mudimbe y « débroussaille systématiquement », écrit Mamadou Diouf, l’espace discursif sur l’Afrique. Les sources ethnographiques des discours, les imaginaires qui les enrobent et leur contexte épistémologique sont repérés puis analysés et déconstruits afin de mettre en évidence les effets persistants d’une mainmise de l’ordre colonial des discours sur les savoirs de l’Afrique. Initialement, l’ouvrage devait constituer un « panorama de philosophie africaine » à l’usage des néophytes. Mais il se mue, dans un premier temps de la recherche, en une « histoire des connaissances en Afrique et de l’Afrique difforme et incohérente », biaisée depuis l’Antiquité grecque et romaine par l’incomplétude des perspectives. S’impose alors une archéologie critique débutant par les savoirs africanistes pour interroger ensuite les soubassements d’une africanisation authentique de la connaissance.
Le premier chapitre s’ouvre sur l’invention de l’altérité, en « miroir inversé » de l’Europe selon l’opération brossée par François Hartog dans Le miroir d’Hérodote (1980). En rapportant systématiquement le différent au déjà connu, le discours du pouvoir s’évite la tâche d’avoir à reconnaître et comprendre d’autres mondes. Suivant un processus analogue à celui qu’a décrit Edward W. Said dans L’orientalisme (1978), trois genres complémentaires de discours, au demeurant trois variations d’un discours profondément univoque, ont contribué à l’invention d’une Afrique primitive : la quête anthropologique, dans l’héritage de Lévy-Bruhl, de cette primitivité, les textes exotiques sur les sauvages et les interprétations philosophiques justifiant une hiérarchie des civilisations. Le troisième chapitre, revenant sur « le pouvoir de la parole », établit un parallèle entre deux triptyques : l’un, de constitution des savoirs, comprend les récits de voyageurs, les commentaires anthropologiques et les descriptions de missionnaires ; l’autre, assurant la prise de contrôle, la colonisation et la transformation du « continent noir », s’incarne en trois figures, celles de l’explorateur, du soldat et derechef du missionnaire.
Bien que romancier lui-même – il est notamment l’auteur d’Entre les eaux (1973) et de L’écart (1979) –, l’essayiste ne s’accorde guère la licence de s’appuyer sur des œuvres de fiction. Avec, qui plus est, plus de trente ans supplémentaires de distance, le corpus de textes missionnaires sur l’indigénisation de l’Église en Afrique centrale et les tableaux d’analyse afférents, par exemple, s’avèrent parfois un peu arides pour le lecteur européen des années 2020. Pourtant, dès son Devoir de violence (prix Renaudot 1968), Yambo Ouologuem, romancier malien dont la figure vient d’être puissamment et obliquement évoquée dans La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, avait, à travers une fiction épique souvent lue comme une provocation, déconstruit tant l’africanisme incarné par « Shrobénius » (Léo Frobenius) qu’une négritude qualifiée d’« essentiellement française » par Mudimbe.
Ce dernier consacre cependant quelques pages à une rapide classification des œuvres de certains de ses aînés romanciers de langue anglaise ou française, selon qu’ils mettent en évidence la domestication du pouvoir politique (Es’kia Mphalele, Mongo Beti, Sembène Ousmane), critiquent la vie coloniale (Chinua Achebe, Driss Chraïbi, Ferdinand Oyono), célèbrent les sources de vie africaine comme Ake Loba ou témoignent d’un ironique désenchantement à l’instar d’Ahmadou Kourouma, Tierno Monénembo ou encore Ngugi wa Thiong’o. Hormis ces œuvres écrites dans des langues européennes, les productions artistiques et langagières africaines (regroupées par l’africanisme sous l’expression de « littérature orale ») auraient pu, ainsi que l’observe Mudimbe, former une véritable introduction à l’altérité. Dans son récent Provincialiser la langue (éd. Amsterdam), où elle exhorte à penser l’activité langagière en dehors du prisme européen de la compartimentation en langues et nations, la linguiste Cécile Canut se réfère d’ailleurs à L’invention de l’Afrique.
L’ouvrage de Mudimbe interroge au fond la possibilité d’une connaissance de l’Afrique dégagée de l’ethnocentrisme européen, ouvrant sur celle d’une « gnose africaine », à savoir une africanisation de la connaissance en un système organisé. « Comment échapper au magistère de la raison coloniale ? », demandait Anthony Mangeon dans La pensée noire. Écrivant dans le prolongement des bouleversements épistémologiques des années 1960-1970, lisant, après Evans-Pritchard, le Lévi-Strauss de La pensée sauvage, Maurice Godelier ou Jack Goody (La raison graphique, traduit en 1979 par Alban Bensa et Jean Bazin, Minuit), reconnaissant la « vigilance épistémologique » d’une nouvelle génération africaine qui n’a eu de cesse de briser le cadre de l’anthropologie classique, le philosophe n’en établit pas moins qu’« en dépit de leur violence contre le règne du Même […], Foucault et Lévi-Strauss, de même que des penseurs africains, font partie des signes du même pouvoir ».
Le cinquième chapitre porte le beau titre de « La patience de la philosophie ». Mudimbe y brosse le panorama de philosophie africaine initialement commandé, esquisse d’une histoire générationnelle des mutations du champ intellectuel africain, mais c’est un panorama hautement critique. Il revient sur le premier effort de Placide Tempels afin de concevoir une « philosophie bantu », sur l’influence exercée sur Marcel Griaule, puis sur Alexis Kagame et l’école ethnophilosophique en montrant que le « fantôme de Tempels » demeure « toujours présent » quand il s’agit de caractériser une philosophie africaine : ontologique, profonde et implicite, soit en attente de dévoilement, inconcevable dans le cadre de la philosophie occidentale − quand Kagame accorde une dimension universaliste à la philosophie collective qu’il entend dévoiler.
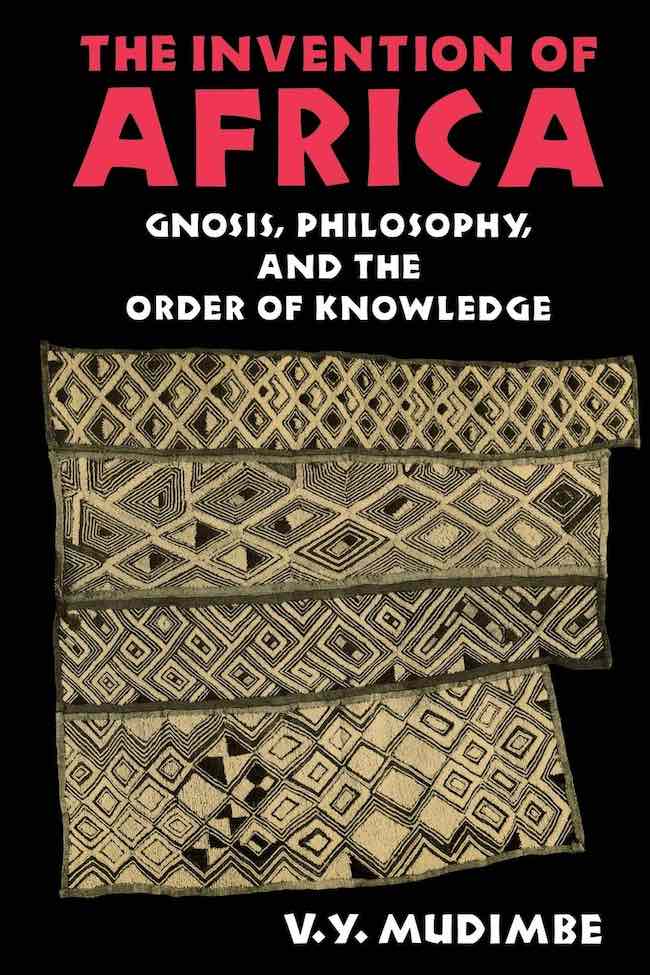
Couverture de l’édition anglaise de « L’invention de l’Afrique » (1988)
Mudimbe incorpore brièvement ce qui est dénommé « récits islamiques » avec les proses sapientielles d’Amadou Hampâté Bâ notamment. Paulin Hountondji procédera à une critique radicale de l’ethnophilosophie, qui prétendrait traduire un texte culturel originel en réalité inexistant. Du côté de l’africanisme européen, et en rupture avec les générations précédentes, va se développer à partir du milieu du XXe siècle un africanisme de « grands frères » assumant l’entreprise éminemment paradoxale d’enseigner aux Africains comment interpréter leur différence en les aidant à élaborer, avec leur place dans le monde, l’expression de leur être propre (relisons à ce propos le Préambule à la réédition en 1981 de L’Afrique fantôme par Michel Leiris, mais Mudimbe cite des noms de scientifiques français de la génération suivante), avant que n’émerge une génération des années 1970 plus affranchie encore des coursives de la bibliothèque coloniale.
Près de trente-cinq ans après la publication initiale du livre, est-il encore temps de parcourir les allées de cette bibliothèque ? Celui qui écrit dans ses Carnets de Berlin : « J’appartiens à une culture qui est mienne et ne l’est pas » pose dans cet ouvrage la question, encore pendante aujourd’hui et ravivée par la contestation d’un universalisme transparent à lui-même, de la possibilité de penser hors de la configuration intellectuelle occidentale : « Voilà où je veux en venir : la tradition scientifique occidentale, tout comme le traumatisme du commerce des esclaves et de la colonisation, sont des composantes de l’héritage africain actuel. »
Cet héritage, débarrassé de sa négativité dès lors qu’il a été dûment analysé, est porteur d’enjeux plus vifs que jamais : émergence depuis la seconde moitié du XXe siècle d’un « Nous-sujet africain » (Fabien Eboussi Boulaga), appelant à des formes alternatives de subjectivation et d’agency ; congé définitif donné à une science des sociétés immobiles au profit d’une historicisation (un enjeu que rappelle Catherine Coquery-Vidrovitch dans son livre récent, Le choix de l’Afrique, La Découverte) ; centralité des textes africains au sein d’une bibliothèque coloniale « toujours ouverte » selon Mamadou Diouf ; enfin, démultiplication de pôles de production des discours et des savoirs véritablement décentrés.












