La réédition de la somme érudite consacrée par le journaliste musical Jacques Vassal à la folk music et parue pour la première fois en 1971 est l’occasion d’interroger les catégories actuelles qui permettent de penser la musique. Pendant ce temps, le livre que le chercheur Guillaume Heuguet consacre au rôle que l’entreprise YouTube a joué dans les métamorphoses récentes des pratiques musicales offre des éléments de réponse sur ce que devient la musique à l’âge de sa numérisation de plus en plus débridée.
Jacques Vassal, Folksong. Racines & branches de la musique folk anglo-américaine. Les Fondeurs de Briques, 688 p., 35 €
Guillaume Heuguet, YouTube et les métamorphoses de la musique. INA, coll. « Études et controverses », 144 p., 12 €
En 1971 paraissait la première édition de ce Folksong. Jacques Vassal n’était pas encore cet infatigable traducteur de mots et de musique qu’il est devenu pour les éditions des Fondeurs de Briques. Bob Dylan avait trente ans, tout comme Joan Baez, Phil Ochs était encore de ce monde, et Graeme Allwright continuait de traduire en français les chansons d’outre-Atlantique. Aujourd’hui augmenté et actualisé (sur près de sept cents pages, tout de même), Folksong permet de se replonger dans cette litanie de noms et de musiques qu’on ne peut ni ne veut résumer. Le travail de Jacques Vassal se distingue d’abord par son érudition minutieuse, source de ravissement pour un lectorat passionné et de lassitude pour les autres, lesquels pourront toutefois se concentrer sur les angles d’analyse les plus stimulants du livre.
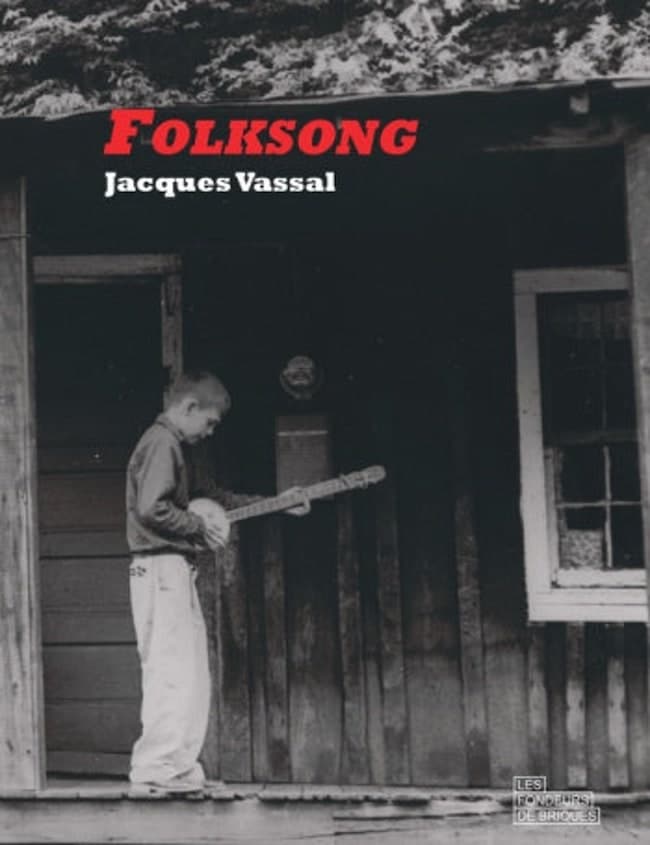
En premier lieu, le désir de contextualisation de l’apparition de la folk en tant que genre musical invite l’auteur à proposer une histoire des cultures populaires américaines qui dépasse largement le cadre musical : esclavages, migrations, industrialisation, protest, conquête de l’Ouest et « destinée manifeste » sont, comme souvent, mises au-devant d’une histoire convaincante de cet art états-unien de la chanson. La spécificité historique et culturelle de la folk music est ainsi déployée avec nuance, loin de tout schématisme, malgré l’absence parfois amusante de distance de l’auteur à l’égard de sa passion d’étude.
Cette passion verse parfois dans un lyrisme hagiographique lorsqu’il s’agit d’évoquer les grands noms du genre, qui sont aussi ceux du panthéon de l’auteur. Dylan a droit à un fort long chapitre où chacun de ses albums est décrypté, discuté, pesé, contextualisé. Si bien que le livre, essentiel pour qui voudra comprendre ces musiques, peut très bien se lire comme une discographie commentée de ces folksongs venues des États-Unis. C’est du moins sous cet angle qu’il pose, sans doute malgré lui, bien des questions.
Car, à l’heure où tout le monde s’accorde sur la disparition du disque, comment expliquer que paraisse un fort gros livre tout entier consacré à cet objet ? Folksong appartient à un genre littéraire venu du journalisme musical et des fanzines des années 1960-1970, des radios souvent libres, perpétué au-delà sur internet, mais qui en bonne logique devrait disparaître en même temps que son sujet, les disques. Ce livre est un paradoxe, tout comme les nombreux volumes consacrés aux « discographies idéales » ou aux mille et un albums que l’on doit écouter dans sa vie ; témoins d’une présence au monde d’un objet que ce même monde ne cesse de dire disparu. Du vinyle, qui ne cesse de revenir, au CD, qu’on ne cesse d’enterrer, le disque est zombie : on le dit mort, mais son corps bouge encore.
Le récit canonique de cette disparition est aussi admis qu’il a été peu interrogé. 2002 : l’industrie musicale mondiale atteint son maximum historique de profits (1,4 milliard d’euros en France). Depuis, un déclin inexorable dû à la numérisation de la musique, d’abord pirate puis par le biais du flux (streaming) qui, grâce aux plateformes par abonnement (Deezer, Spotify, Apple Music, etc.) ou à la publicité (YouTube), permet à l’industrie de connaître une croissance limitée, mais réelle. Séduisant, hégémonique, ce récit est entièrement faux, pour plusieurs raisons qu’on se contentera d’évoquer : rien d’inexorable à la numérisation, comme l’a montré la mobilisation réussie du livre face aux liseuses, maintien des supports physiques dans l’économie musicale (d’un tiers à la moitié des bénéfices en fonction des pays), maintien du format esthétique de l’album dans la création musicale enregistrée, etc. Par ailleurs, ce récit suspect est celui défendu par les majors de l’industrie musicale eux-mêmes, ainsi que par l’État dans le contexte français – il faut dire qu’ainsi racontée, l’histoire fait oublier leurs propres responsabilités.
Des recherches récentes viennent toutefois contester le récit dominant de la « révolution » des pratiques d’écoute que nous aurions connue ces deux dernières décennies. À travers l’exemple de YouTube, Guillaume Heuguet propose l’une des plus éclairantes de ces recherches, dans la continuité d’autres travaux autour de ce qu’il nomme la « réforme » de nos pratiques d’écoute. YouTube et les métamorphoses de la musique mène une entreprise salutaire de démystification du pouvoir d’action des géants numériques (les fameux GAFAM) à partir d’un exemple unique mais hégémonique dans l’offre de flux vidéo. Tout d’abord, en rappelant de façon clinique les hasards et hésitations qui ont permis à YouTube de gagner cette position privilégiée dans le paysage musical, malgré l’amateurisme récurrent de la firme. Loin d’un fatal et implacable progrès du numérique par rapport au physique, Heuguet commence par démontrer à quel point YouTube a bénéficié du caractère incident que la musique prenait par rapport aux vidéos, permettant d’embarquer celle-là vers de nouveaux formats. Cette « musique incidente » inscrit la musique sur YouTube « dans le prolongement d’une longue tradition qui a vu la musique s’associer à une diversité de sensations, d’images et d’expérimentations, qui court d’un art « multimédia », comme l’opéra, aux techniques audiovisuelles vite périssables des vidéoclips. […] [L]a musique est moins radicalement transformée qu’elle n’est d’abord ramenée au caractère fragile des normes qui lui confèrent son autonomie ».

L’établissement de continuités historiques dans les pratiques d’écoute, malgré un discours dominant fasciné par l’innovation, la rupture, la disruption, est l’une des forces de la démonstration de Guillaume Heuguet : continuité du spectacle musical en streaming avec les théâtres de variété du XIXe siècle, avec la mise en série de la musique déjà établie par la télévision au XXe siècle, avec le contrôle des œuvres musicales déjà initié par la réforme des droits d’auteur depuis au moins les années 1980. Enfin, continuité historique avec l’histoire de l’industrie musicale, qui, depuis ses commencements plus que centenaires, a toujours utilisé la musique comme produit d’appel pour vendre tout autre chose : « Des inventeurs d’appareils comme Edison, et des premières firmes de réseaux électriques et radio comme RCA avaient en effet choisi d’investir la culture et les médias, de créer des labels discographiques et des émissions musicales, de développer un vaste marché de reprises de chansons afin de transformer leurs inventions en débouchés commerciaux, et d’espérer les vendre auprès d’un large public. »
Ce passage par l’histoire est la première étape vers une déconstruction salutaire de tout déterminisme technique face aux nouvelles technologies d’écoute. Non, les innovations technologiques numériques n’ont pas révolutionné nos pratiques d’écoute. Sur YouTube, les fameux albums de folk commentés par Jacques Vassal sont presque systématiquement référencés en tant qu’albums, survivants numériques d’un âge analogique. Ils n’y sont plus soumis à la même économie, ni au même rapport esthétique et sonore.
Car YouTube réforme malgré tout nos pratiques d’écoute par de nombreux biais, le premier étant dicté par l’aubaine technique des nouveaux moyens d’écoute, qui permettent de mesurer et de quantifier la performance réelle de chaque morceau : les plateformes de flux comme YouTube peuvent en effet savoir avec précision combien de temps est accordé à l’écoute du morceau, à quel moment l’auditeur interrompt ou poursuit l’écoute, etc. Les développements qu’Heuguet consacre à l’invention et à l’évolution de la « vue » comme indice de mesure de la performance de la musique enregistrée sont particulièrement éclairants, donnant à voir l’affairement de YouTube à déterminer ce qu’est précisément une vue. Un clic sur une vidéo ? quelques secondes consacrées à la regarder ou l’écouter ? mais combien de ces secondes ? un visionnage entier ? La performance de la musique est ainsi quantifiée par la « vue », invention terrifiante et géniale de la firme possédée par Google.
D’où un problème économique majeur pour la musique enregistrée, qui dépasse le seul constat d’une rétribution minable par le biais des vues sur YouTube comme des écoutes sur les plateformes de flux type Deezer ou Spotify. Comment est financée la musique enregistrée par les canaux numériques ? L’exemple de Spotify, non traité par Heuguet, est à ce titre éclairant : les Suédois ayant créé l’entreprise n’ont choisi de faire de la musique leur produit d’appel qu’en dernier ressort, dans la mesure où ils voulaient depuis le commencement vendre des données. On ne schématiserait guère trop en affirmant que l’industrie musicale s’est transformée en industrie de la donnée.
Dans le cas de YouTube, le constat effectué par Heuguet est peut-être plus éloquent encore, en ce qu’il condense de nombreux phénomènes politiques et sociaux dans une économie complexe à saisir. YouTube abuse en effet dans sa communication du vocabulaire néolibéral le plus éculé, multipliant les références à l’innovation, la créativité, la démocratie et l’horizontalité, dans une stratégie de subversion constante qui lui permet de présenter un partenariat avec les majors de l’industrie musicale comme la défense du musicien « rebelle » à qui YouTube permettrait d’entrer dans un âge de consensus où disparaîtrait le « rapport de force potentiel entre artistes et maison de disques, [concluant] plutôt à un compromis idéal » entre tous les acteurs. Derrière ce constat idyllique dessinant « un idéal du droit comme système qui tend vers une régulation sociale parfaite », YouTube est en réalité une formidable machine à manier du droit d’auteur par le moyen double d’une hégémonie économique et d’une opérativité technique. La firme états-unienne a ainsi fait fond très rapidement sur les politiques d’extension du droit d’auteur – en France, c’est la loi Lang de 1985 sur les droits voisins qui incarne ce mouvement – pour mettre sous contrôle l’ensemble des œuvres musicales en même temps qu’elle normait l’accès matériel et esthétique qu’on pouvait en avoir. Mise sous contrôle qui indexe la définition même des œuvres aux stratégies de YouTube, qui par certains moyens « crée de fait une seconde catégorie regroupant des « sous-œuvres », celles dont les parties attribuables à d’autres auteurs n’auraient pas fait l’objet d’une procédure contractuelle de cession de droits, qui sont alors particulièrement menacées de disparaître ou de ne jamais apparaître ».

New York (2008) © Jean-Luc Bertini
Pour déterminer quelles sont ces œuvres qui disparaissent, il faut quitter momentanément le livre de Guillaume Heuguet et aller voir d’autres auteurs traitant de ces questions, tels Romuald Jamet ou Marianne Lumeau. La numérisation de l’industrie musicale profite notamment aux œuvres anciennes, surtout celles des années 1950 à 1970, qui sont de plus en plus écoutées, aux dépens des œuvres contemporaines moyennement commerciales. Pour le dire simplement, on n’a jamais autant écouté de vieilles musiques enregistrées que depuis dix ans, et le processus ne semble pas près de s’arrêter. Le phénomène paraît des plus logiques : si l’industrie musicale se reconvertit en industrie de la donnée, l’exploitation d’un stock massif de musiques déjà enregistrées, donc déjà rentabilisées, est plus économique que la création de nouvelles musiques. Dans cette économie, l’intérêt financier de la « création » musicale est nul ou presque, même si tout le monde n’a que ce mot à la bouche.
Au-delà d’une explication convaincante de la nostalgie de l’époque dans ses pratiques d’écoute, cette conclusion permet surtout de revenir à Folksong, qui au fond semble bien de son temps dès lors qu’on garde en tête ce contexte. La valorisation du patrimoine discographique est aujourd’hui le moyen premier de rentabilité musicale, ce qui redonne au genre littéraire incarné par Jacques Vassal une fonctionnalité évidente, superposée aux intérêts intrinsèques de ce type de prose. On exhume ces textes d’un passé proche, qui n’est révolu que dans un délire de rupture et de disruption cherchant à masquer à quel point nos pratiques d’écoute sont guidées par la mise sous contrôle de la créativité musicale au profit de l’exploitation patrimoniale, nécessairement conservatrice.
Ce rude constat est parallèle à l’analyse par Arnaud Esquerre et Luc Boltanski du concept d’enrichissement (Enrichissement. Une critique de la marchandise, Gallimard, 2017), qui cherche à penser les phénomènes contemporains de valorisation capitaliste du patrimoine existant dans un contexte où la création de valeur réellement neuve est souvent illusoire. L’éloge emphatique de Bob Dylan dans Folksong invite à relier cet enrichissement de la musique enregistrée avec l’obtention du prix Nobel de littérature par le chanteur en 2016, moins pour en dénier la pertinence, que pour émettre l’hypothèse qu’il n’en va pas seulement dans cette attribution d’une légitimation esthétique nouvelle d’un art autrefois minoré. Le versement de Dylan dans une légitimité littéraire dominante – par le Nobel comme par des ouvrages comme celui de Vassal – caractérise aussi une extension de la valeur de son œuvre, qui est avant tout discographique. Cette légitimation est productrice de valeur à un degré non négligeable, dépassant dans ce cas les ventes de livres occasionnées chaque année par l’attribution du prix suédois. Le littéraire peut aussi se concevoir, face au disque, comme le moyen extrêmement efficace d’une légitimation patrimoniale source de profits. La coïncidence de la mise en livre avec la vraie-fausse disparition du disque ne serait dès lors pas fortuite, mais caractéristique de ces processus complexes.
La musique enregistrée est l’objet de discours traversés d’idées reçues, mais peut constituer un point d’observation privilégié pour des phénomènes brutaux de numérisation de nos vies quotidiennes, plus encore au sortir d’une crise pandémique qui fait apparaître, de la part de l’État français, les premiers soutiens aux « concerts en streaming » par le biais des subventions publiques. L’urgence est réelle d’une reprise en main collective de ce qu’est la musique, son écoute et sa pratique.












