Leo Lionni avec La botanica parallela en 1978, André Dhôtel avec Rhétorique fabuleuse en 1960 ou Francis Ponge avec Le parti pris des choses en 1942, sont de ces rêveurs hallucinés mais précis dont l’œil est capable de disséquer l’invisible qui seul échappe au regard fonctionnel. Nul besoin de stupéfiant pour stupéfier – et libérer des visions qu’une infinie tendresse comme une profonde empathie suffisent à rendre réjouissantes ou inquiétantes. À leur suite, Anne Peslier, avec son recueil d’Aphamères, recourt au poème en prose pour réapprendre à voir et faire se lever de l’encore ineffable.
Anne Peslier, Aphamères. PhB éditions, 160 p., 12 €
Avec ce titre, Anne Peslier déploie une œuvre commencée en 2002 sous forme de livrets d’artiste et de plaquettes au Pré Carré ou chez Wigwam. Complice de la revue La Passe, où sont apparues les premières aphamères, puis, entre autres revues (Les Cahiers de Tinbad, L’Intranquille, Verso, Décharge…), de celle de Philippe Barrot lui-même, Les Chroniques du çà et là dont on relira avec le plus grand intérêt le n° 16 « Poèmes au féminin », chambre d’échos de voix féminines pas toujours entendues, Anne Peslier a toujours frayé avec des expériences de contre-chants poétiques singuliers, voire insolites. Ce qui se rêve existe de toute évidence, c’est une loi de la physique quantique – quand même nous rêverions ce que nous venons d’écrire… L’art et la science ont-ils jamais fait autre chose que découvrir ou concevoir ce qu’ils avaient rêvé ?
Aphamères est bien un recueil au sens littéral – qui fait, à travers huit thèmes, sa récolte d’espèces à réinventer pour retrouver un sens au monde. Cette encyclopédie découpe, recense et redéfinit le réel dans un effort d’universalisation. Ici, l’auteure, en trouveresse ou trobairitz, collecte moins l’existant qu’elle n’imagine et donc trouve – par la profération d’une langue réappropriée – de curieuses espèces, organiques autant qu’idiolectales, jadis abandonnées dans une jachère par une mère hémiplégique, dont il a fallu combler la soudaine aphasie ou redresser des bouts de langue bancale. Nous qui avons parfois, en amitié d’un parler étrange, exploré les coulisses de l’élaboration de cet ouvrage, il nous est arrivé de surprendre des items qui s’exprimaient à l’envers de leur intention, dans une offuscation étonnamment schizophrène – inversion cruciale avant rétablissement, qui pourrait trahir une des vertus natives du langage propre à exprimer une chose et son contraire. Nous entendons par « expérience » cette réversibilité de la langue, non seulement comme un retournement de la terre-monde, mais comme un retour à la source maternelle, pour faire de l’oubli une mémoire et de la blessure une cicatrice. « L’“auze” est la mémoire vivante de la langue émue », écrit Anne Peslier, qui ose s’aventurer dans de secrètes brandes.
Une œuvre poétique, ce peut donc être une langue-mère – une mère de vie nègre – un idiome de substitution au goût aigre qui remplacerait la langue maternelle, reçue en état de paralysie ; une langue en pleine battue à travers bois, des ronces plein la figure – sa proie aux abois, ponctuée à l’emporte-pièce de gutturales exigences, de rocailleuses bribes, de fœtus de mots mort-nés sur lesquels veillerait le rêve de fleurs assoiffées. Le poème en prose se fait aphamère, voire éphémère (la fée n’est guère loin, fugace), alors même qu’il s’altère, s’emplit de sa soif, de sa voix étrangement suave, étrangement sensuelle, étrangement tétée aux bouts de réel surgis comme des boutures d’enfance et des blasons de mère.
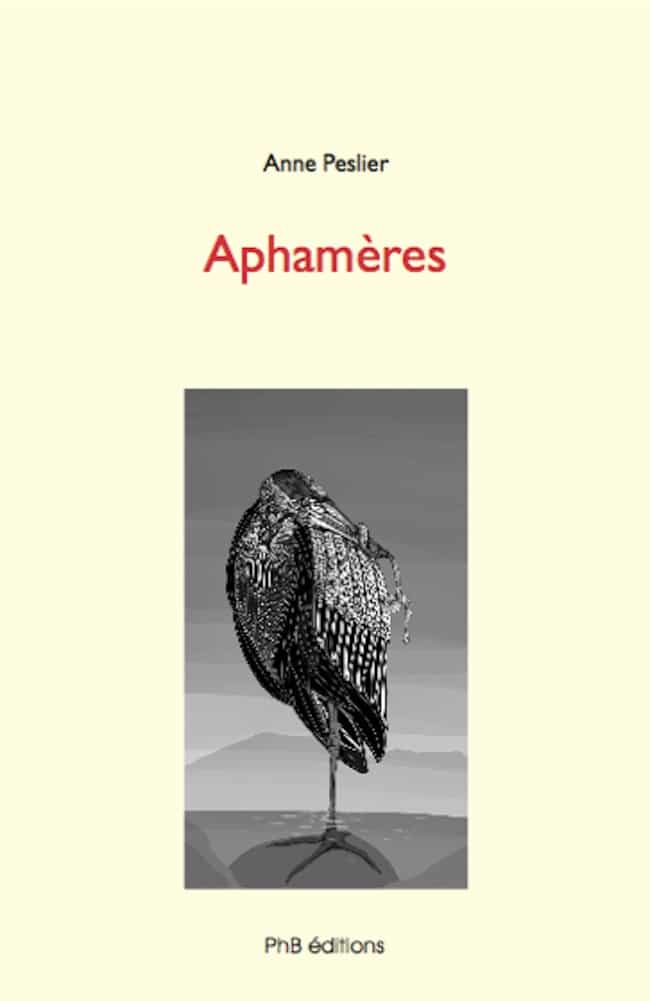
Si vient à manquer la langue, la poétesse n’a de cesse de l’invoquer par tous les règnes du vivant, du baiser à l’arbre-très-haut en passant par le zigomar, les inappropriés ou les tremblants. Elle se donne pour mission de déterrer cette langue mi-morte : « À ma mère qui m’a offert sa langue une seconde fois », écrit-elle en dédicace – comme si l’exercice périlleux du poème passait par l’exhumation, non pas de restes mais d’embryons de mère jamais éclos. Une langue amputée de sa matrice pourrait n’être qu’un babil incertain ; ici, elle s’active à régénérer, vive comme une queue de lézard, les cellules souches d’un corps qui n’a plus émis que de lointains signaux sous l’abîme d’une voûte mal étoilée.
Placer en outre son ouvrage sous les auspices d’Ovide et choisir la vision terrifiante de la Faim comme métamorphose programmatique, n’est-ce pas centrer sa quête sur la privation, la confiscation du monde, le manque viscéral ? Anne Peslier rassasie sa langue aphamée par des mets toujours délicats dans le phrasé, qu’ils soient riches de sensualité ou frappés d’une infinie tristesse quand ce n’est pas d’effroi : « Le hérisson est l’ivresse désincarnée […], il est obligé de traduire l’existence sans en passer par le contact » ; ou encore : « Les automates sont des penseurs. Ils ressassent. Comme il leur est impossible de vivre intuitivement, ils se rongent de l’intérieur en dérouillant leur cerveau avec des émotions. »
Chaque article, comme un enfant de langue, est objet de tendresse pour l’auteure, qui le voit, lui parle familièrement et le touche pour en être touchée. En cela, on peut parler d’animisme de cette science du rêve, en communication avec des espèces reliées à la conscience d’un monde en décomposition. « Les arbres réels décident d’abdiquer et de s’enterrer en attendant une autre version du vivant. » La mort, qui guette chaque naissance du vivant, œuvre en ce recueil en partenaire tout aussi fragile, que guette en retour chaque espèce d’aphamère pour la coloniser, l’injecter de sève.
Quant aux notes de bas de page, dimension souterraine et matricielle du recueil, elles potentialisent nombre d’inventions en les ancrant, paradoxalement, dans une vérité familière éclairante. Ainsi lit-on, pour étayer cette assertion des « Échappées », « elles imitent ainsi la pose naturelle du héron », cette note : « le héron est naturellement perpendiculaire au silence ». Le ton affirmatif du paratexte force à adhérer à une telle évidence hallucinée tout en offrant – autre paradoxe délicieux – une échappée théâtrale consciente de son auto-représentation. Et la note de se faire parfois proliférante comme un lierre, absorbant son propre sujet d’origine. Vertu du vivant. Ce héron, même, n’a pu s’empêcher de figurer sur la couverture du livre, belle gravure de l’artiste Gabrielle Breton-Peslier. Dans la famille Héron, je demande la fille !
À une ère de disparition accélérée du réel, voire de son extermination par une humanité invasive, martelons-le, la poésie, ici, intruse têtue, tente non seulement de renommer un réel oublié mais de fertiliser par de nouvelles espèces un espace intime dévasté, conjuguant de la sorte histoire personnelle et constat universel.
Ce dont la poète rêve existe tôt ou tard. Ce livre, comme un réensemencement, pourrait bien être une urgence contre la déperdition de notre terre et de la poésie qui intéresse si peu [1], finalement, alors qu’elle donne à chaque être la force de multiplier les couvains d’essences rares, d’envisager le vivant. Un livre à lire, donc, sans mesure, dans l’ordre ou le désordre du monde.
-
Si la poésie intéresse si peu le pouvoir et ses institutions, le peuple ou les poètes patentés, c’est qu’elle produit des visions confondantes qui ébranlent cet être le plus profond que la machine mercantile n’a de cesse d’écarteler, de désosser, d’inhumer vivant. La poésie est naturellement perpendiculaire au silence.











