Alors que l’essentiel de son œuvre est publié en français, voilà que les éditions Vrin et la grande traductrice de Jan Patočka, Erika Abrams, qu’il faut de nouveau saluer, après nous avoir offert en 2016 une nouvelle traduction du Monde naturel comme problème philosophique (1936), nous permettent aujourd’hui d’entrer dans l’atelier du penseur. Les Carnets philosophiques – car il s’agit de treize petits carnets d’écolier – ont été découverts dans les années 1970 et seront intégrés dans l’édition tchèque des œuvres complètes.
Jan Patočka, Carnets philosophiques, 1945-1950. Trad. du tchèque et annoté par Erika Abrams. Vrin, 861 p., 38 €
Roman Jakobson le classait parmi les trois philosophes tchèques de renommée mondiale. Jan Patočka, né en 1907 et mort à Prague l’année même de la Charte 77 et à cause d’elle (il en était le porte-parole et mourra des suites d’un interrogatoire musclé mené par la police du régime communiste), est un philosophe martyr, un « témoin », comme l’écrivait le grand historien de la philosophie Raymond Klibansky (in Henri Declève (dir.), Profils de Patočka, Presses de l’université Saint-Louis, 1992).

Jan Patočka (1971) © CC/Archív Jana Patočky/GFDL
Privé d’enseignement par les nazis lors de la fermeture des universités tchèques en 1939, de nouveau exclu par les communistes en 1949, Patočka n’a rien d’un personnage académique. Comme son compère phénoménologue de Vienne Günther Anders, dont il juge d’ailleurs sévèrement les études sur Heidegger, c’est un « ébranlé », selon l’expression employée bien plus tard dans un texte intitulé « Les guerres du XXe siècle et le XXe siècle comme guerre » (Essais hérétiques, Verdier, 1981), quelqu’un qui n’a plus la foi dans la « Force », dans la « production », dans la réquisition permanente des existences humaines, qui dit non au « jour », à cette lumière aveugle de l’évidence productive fondée sur la logique de guerre.
Avec ces carnets, nous sommes devant un monument qui s’apparente davantage au Journal de pensée de Hannah Arendt (Seuil, 2005), ou aux désormais célébrissimes Cahiers noirs de Heidegger, qu’au Journal de Kierkegaard ou qu’à celui de Maine de Biran. L’auteur en parle, à l’occasion de réflexions sur le Journal métaphysique de Gabriel Marcel, comme d’un carnet de notes, dans lequel les pensées viennent ; il faut en « « suivre la croissance naturelle ». Patočka ajoute que « le mode d’exposition ordinaire de la philosophie laisse à peine deviner le travail du métaphysicien, sa vie personnelle de philosophe, ses combats, ses défaillances et ses reprises en main, dissimulant de surcroît ce dont il y va véritablement dans le choix de vie philosophique, non pas le happy end d’une solution discursive, mais plutôt le happy beginning d’une fondation radicale ».
Une note datée du 14 décembre 1946 nous donne la mesure de ce combat : Patočka y déclare son insatisfaction devant son travail d’écriture, « une longue quête et rien au fond », écrit-il. Il manque, selon lui, « une exigence de pression » qui doit prendre en charge le passage de l’idée (la « trouvaille ») à sa thématisation, mais l’important n’est pas tant de s’assurer une sorte de maîtrise sur la pensée ou de la provoquer pour la diriger de « l’avant », que de laisser s’approfondir, presque passivement (une pression « passive » en quelque sorte), le déjà-là de l’idée, c’est-à-dire sa concrétion vécue.
Durant la période de rédaction de ces carnets (1945-1950), Patočka a repris l’enseignement dans un contexte personnel (une mauvaise santé), pédagogique (une surcharge de travail) et politique (le coup de Prague de février 1948) difficile. Il s’en plaint dans sa correspondance, reportée par la traductrice dans un avertissement très utile. Pourtant, son atelier de pensée ne bruit pas de l’actualité ou très peu (en quoi il ressemble à celui de Kierkegaard), mais se fait plutôt l’écho de ses lectures ; et, de ce point de vue, dans une des rares annotations à caractère personnel, datée de 1946, il déplore que lire de la philosophie française (et il en lit beaucoup : Merleau-Ponty, Wahl, Polin…) « l’énerve fortement » et même le « rend malheureux », alors que ce n’est pas le cas avec l’allemande. Même s’il déclare lire plus facilement Heidegger que Sartre, cela ne l’empêche pas de débattre – deuxième dimension de ces textes – avec le second et de juger durement sa philosophie : elle est « au bout du compte un rationalisme fortement objectiviste auquel on a ajouté un morceau du mythe de la liberté ». Le troisième type de texte que l’on peut rencontrer touche aux travaux en cours ; notamment les deux premiers carnets, qui constituent l’esquisse d’un ouvrage qui aurait pu porter comme titre L’intériorité et le monde.
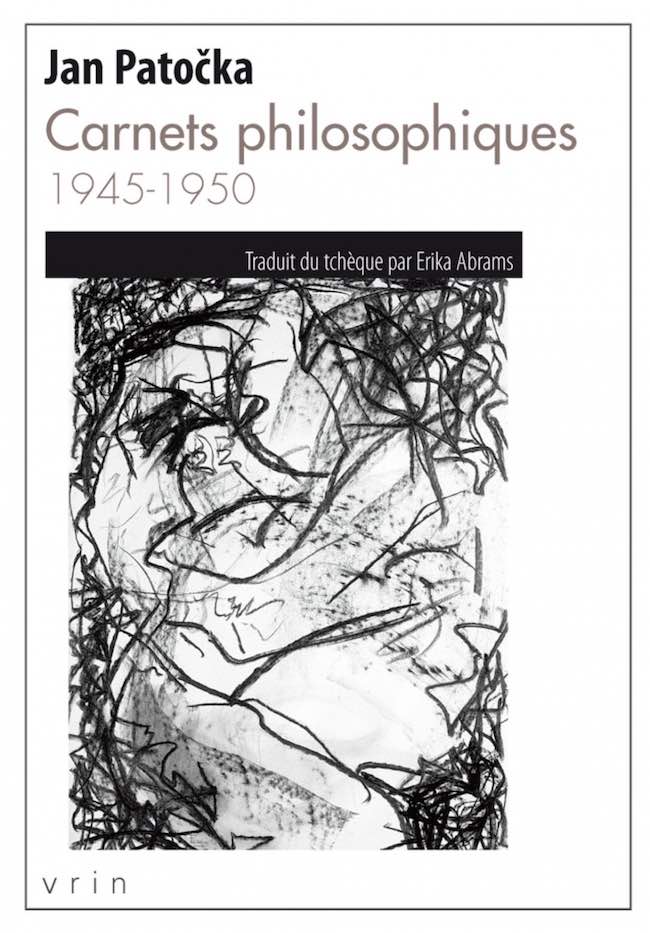
Mais nous pourrions être tentés de lire ces textes distraitement, un peu étourdis par une certaine dispersion. Nous en sommes empêchés par ce qu’ils laissent apparaître du percement d’une pensée singulière. Si Patočka, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, appartient au mouvement phénoménologique (il est en séjour à Paris quand Husserl prononce en 1929 ses fameuses Pariser Vorträge qui donneront les Méditations cartésiennes, il le rencontrera ensuite en Allemagne, se liera d’amitié avec Eugen Fink, assiste aux cours de Heidegger), ses carnets et cette période 1945-1950 sont le lieu d’un éloignement (tout en restant proche), d’une deuxième naissance.
Est-ce sa retraversée de la philosophie antique et notamment de Platon, qu’il travaille pour ses étudiants, est-ce sa lecture méditée des paragraphes de Sein und Zeit sur la tonalité comme mode d’être du Dasein, est-ce l’immense douleur de la guerre, de l’anéantissement et de la mise au pas totalitaire ? Sans doute tout cela à la fois, mais, dans ces années, Patočka est sur la voie de sa phénoménologie a-subjective, c’est-à-dire qui, « sans abandonner la subjectivité », met au jour « un mode d’être plus profond par quoi elle s’enracine dans le monde et entre en continuité avec les autres étants », comme l’écrit Renaud Barbaras dans sa préface. Si tous les carnets sont marqués par cette recherche, influencée sans doute par Bergson, que ce soit à travers le débat avec l’idéalisme ou le matérialisme, les discussions serrées du subjectivisme comme de l’objectivisme, les deux premiers, toutefois, développent une thèse sur la réalité comme « expression », et l’on pense en lisant ces pages remarquables à ce que le poète Gerard Manley Hopkins appelle l’inscape des choses, qui est pour Patočka leur « intériorité ». Pas l’intériorité de la conscience, mais un mouvement, une dynamique qui individualise les choses et constitue la vie.
Parallèlement à cette contribution à la phénoménologie post-husserlienne, apparaît dans les carnets de plus en plus nettement à partir de 1947 une thématique « politique ». Sans critiquer ouvertement le régime qui se met en place en Tchécoslovaquie à partir de 1948, Patočka médite sur la puissance, la consommation, la liberté. Détournant la boutade de Staline sur les écrivains « ingénieurs des âmes » – mais il fustige aussi bien Lippmann, le théoricien du néolibéralisme –, il renvoie dos à dos, comme il le fait pour le subjectivisme et l’objectivisme, capitalisme et communisme soviétique. Au fil des pages se déploie une pensée originale de la liberté (que Bataille aurait nommée « souveraineté », « l’autorité de la liberté » chez Patočka) d’un ego décentré (destitué ?) ayant besoin de donner un sens au tout, qui, celui-ci étant inaccessible et inobjectivable, laisse l’homme satisfait par… rien. Tout ce matériau sera repris et vraiment élaboré dans des textes des années 1950 à la recherche d’une vraie transcendance, « le platonisme négatif » et « la surcivilisation et son conflit interne », appartenant désormais au patrimoine philosophique du XXe siècle et publiés en français dans le recueil Liberté et sacrifice (traduit par Erika Abrams, Jérôme Millon, 1990).
La lecture de ces fragments montre un homme épuisé qui s’interroge sur la possibilité même de la philosophie dans le monde de l’après-guerre, qui désespère « d’avoir jamais la possibilité de s’exprimer en philosophe », qui se sent « un homme presque devenu étranger à la philosophie, qui ne cesse de recommencer en dilettante », restant « tapi comme un lièvre ». Son épuisement n’est pas seulement le sien, c’est celui de « l’autosuppression de l’Europe », celui du « grand glissement mondial » entraîné par la « civilisation rationnelle » (ce qui deviendra plus tard le concept de « surcivilisation ») auquel il faut opposer « une tension de toutes nos forces pour qu’il se déroule sans un effondrement, un bouleversement complet de toutes les possibilités humaines, sans livrer le monde au pillage du mécanisme universel de la centralisation générale ». Jan Patočka ne proteste pas, ne joue pas au romantique, ne fuit pas non plus devant la nuit, mais il entre dans une « nuit transfigurée ».












