Autour de la disparition d’un enfant dans le blizzard, Marie Vingtras entrelace les brefs monologues intérieurs d’une poignée de personnages désorientés. Un premier roman sombre sur la paternité et la culpabilité, bien construit et au suspense efficace, mais dont le style, manquant de relief, n’évite pas toujours les facilités d’une américanité quelque peu factice.
Marie Vingtras, Blizzard. L’Olivier, 183 p., 17 €
Marie Vingtras ne s’en cache pas : romans et films américains sont pour elle une source d’inspiration. Filiation peut-être un peu trop apparente dans la mesure où les personnages masculins du roman relèvent presque du stéréotype : Freeman, le vétéran du Vietnam (il en faut bien un) ; Benedict, le taiseux aux manières d’ours, mais au cœur tendre et à la psychologie un peu fruste : « Je n’ai pas connu beaucoup de femmes, juste assez pour trouver qu’elles sont quand même plus compliquées que nous » ; Cole, la brute machiste et perverse… L’impression d’avoir déjà rencontré ces figures-là maintes fois, ainsi que la reconnaissance de motifs et de thèmes fréquents dans le roman nord-américain, donnent parfois le sentiment d’un roman nourri d’une américanité un brin superficielle.
Pour autant, la narration se révèle tout à fait convaincante et fait de ce premier roman une lecture agréable en dépit des facilités évoquées. La construction du roman ménage en effet durablement le suspense par le méticuleux tissage des monologues. Les secrets en clair-obscur des personnages affleurent progressivement au fil des chapitres. Le titre du roman doit alors s’entendre dans un sens qui n’est plus seulement thématique mais aussi métafictionnel : les lecteurs, comme les personnages, avancent à l’aveugle dans une intrigue où le motif n’apparaît qu’au fil des indices disséminés au détour des phrases.
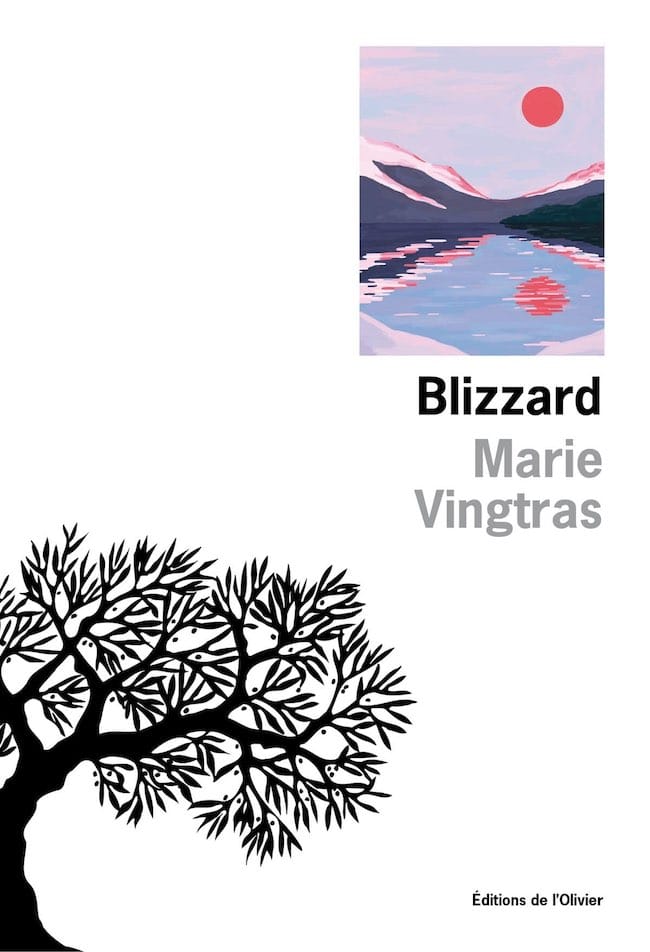
À bien des égards, Blizzard fonctionne donc comme un puzzle, ou mieux : comme une mosaïque. C’est d’ailleurs l’image que le personnage de Benedict utilise pour évoquer le puzzle familial des Mayer : « Nous formions une mosaïque compacte que chaque individu venait parfaire sans que personne puisse contempler le résultat dans sa globalité. » Image que l’on pourrait sans difficulté reprendre pour caractériser l’impeccable structure du roman. Chaque chapitre, bref monologue d’un personnage, fonctionne comme une pièce, un détail qui ne permet de saisir l’ensemble de la fresque que rapporté aux autres fragments.
Or, ce motif dans le tapis, quel est-il ? Sans aucun doute celui de la paternité, jamais acquise ni évidente. Blizzard est un roman des pères, les vivants et les morts, défaillants ou maladroits, ceux qui fuient, ceux qui disparaissent… Mais cette question de la paternité ne serait pas aussi intéressante si elle ne questionnait le mythe de la virilité qui lui est associé. C’est là que la géographie du roman trouve son importance, dans cette nature hostile où seuls seraient capables de survivre les mâles. De tous les personnages, Bess, seule voix féminine, est aussi la seule à bousculer le mythe viril de l’Amérique, de la conquête de l’Ouest, et de la confrontation à la nature : « J’ai provoqué des types dans les bars où je travaillais comme serveuse, des types qui auraient pu m’allonger d’un coup de poing. […] Souvent, ça les arrêtait, ils ne s’attendaient pas à ce que je recherche cette violence. Ce n’est pas si fréquent chez une femme et c’est perturbant pour un mâle dominant ».
Si l’atmosphère de Blizzard n’est pas sans évoquer le film Fargo des frères Coen, c’est sans la causticité et l’ironie de ces derniers. Mais on ne saurait faire grief à l’autrice de prendre ses personnages au sérieux. C’est même là une des qualités essentielles du livre.












