Michael Taussig est un anthropologue australien. Son travail se déroule en Colombie. Palma Africana, paru en 2018 – il a publié un autre livre depuis –, est placé sous le patronage de William Burroughs. Quatre-vingt-huit parties. Une postface à Istanbul.
Michael Taussig, Palma Africana. Trad. de l’anglais par Marc Saint-Upéry. Éditions B42, 180 p., 23 €
Palma Africana : le livre ne fait pas l’anthropologie de la vie aux alentours d’une plantation d’huile de palme sur l’île des papayers, près du fleuve Magdalena, dans le nord-est de la Colombie. Il semble que l’auteur, Michael Taussig, mène un combat profond contre son métier d’origine, n’étant pas certain que l’anthropologie aide à devenir un bon écrivain. Il a un collègue et ami, l’avocat Juan Felipe García Arboleda, qui fait vraiment l’anthropologie de la vie sur l’île des papayers au temps de l’huile de palme. Il ne prend pas sa place. En ce qui concerne l’île des papayers, dit Taussig, lisez García Arboleda. Les références de son livre sont données en note : Juan Felipe García Arboleda, El exterminio de la isla de Papayal : etnografías sobre el Estado y la construcción de paz en Colombia, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2019.

Île des papayers © Michael Taussig
Michael Taussig a passé dans l’île sept semaines. Une en 2011, deux fois trois en 2015. Ce qui le retient de faire simplement un ouvrage sur l’île des papayers et sur une plantation d’huile de palme, ce n’est pas le peu de temps qu’il y a passé, mais le contraire : en 2018, il a derrière lui quarante-neuf ans d’expérience de terrain. Taussig entre dans la carrière ethnographique en 1969 dans l’ouest de la Colombie (il observe alors des descendants d’esclaves et une exploitation aurifère le long du fleuve Timbiquí). Il y revient tous les ans, écrit sur la violence des plantations de caoutchouc à l’orée du XXe siècle. Il est témoin de la montée en puissance concurrente de guérillas gauchistes et de groupes paramilitaires dans un pays dominé par des élites qui manipulent leur tuteur états-unien pour mieux mettre en coupe réglée un territoire qu’il s’agit de coloniser avec profit. En 1990, l’auteur change de terrain pour rejoindre les rives du fleuve Magdalena, dans le nord-est du pays (il étudie la mise en place d’un projet d’exploitation pétrolière, l’appropriation des terres par les cartels de la drogue). En 2011, il aperçoit brièvement les efforts d’une association de paysans, l’Asocab, pour préserver un mode de vie fondé sur l’agriculture vivrière. La région a été un havre pour la guérilla des FARC, garante d’un ordre dont l’auteur croit savoir qu’il a été plutôt bénéfique, avant qu’elle ne soit chassée par des paramilitaires et des narco-trafiquants devenus éleveurs. Une grande entreprise, justement secondée par des paramilitaires reconvertis, accapare les terres de ces paysans et entend bien tirer tout le profit de la plantation de palmiers à huile qu’elle met à leur place, avec l’appui de l’État colombien. Le massacre paraît imminent.
Ce territoire de l’île des papayers pose des problèmes à l’auteur. Il s’est déjà bien des fois, avant 2011, confronté à la violence, objet fuyant. Sur l’île des papayers, elle paraît surtout une menace et une histoire d’avant. La dire, l’anticiper, en relater les détails horribles, n’est-ce pas déjà hâter son retour ? Il faut pourtant bien dénoncer les faux-semblants d’un gouvernement qui prétend faire régner la paix et donne dans le même geste le pouvoir aux assassins et aux multinationales de l’agrobusiness. Les récits de démembrements de corps humains trouvent donc malgré tout à se nicher dans le cours du livre, au milieu d’un flot infernal de citations, d’allusions, de commentaires et de commentaires de commentaires, dont l’auteur prétend qu’il mime le fleuve Magdalena. Cette dévoration du réel par l’auteur au nom de la mimèsis, il assure qu’elle est inévitable, indispensable, et finalement bénéfique. En tout cas, le sujet qu’il se donne n’est ni l’île, ni la plantation, ni l’État colombien, ni les paramilitaires.

Île des papayers © Michael Taussig
Mais alors, Palma Africana ? Il est, bien sûr, beaucoup question d’huile dans le livre, car ce qui occupe l’auteur, ce sont les métamorphoses. Près du fleuve Magdalena, une forêt devient une plantation ; un arbre donne des fruits ; des assassins deviennent des policiers ; une femme devient huile ; l’huile un livre. Sans doute tous les livres sur les métamorphoses entretiennent-ils une relation d’amitié avec les labyrinthes. Perdez-vous, perdez-vous, trouvez-vous : qui ne veut pas de ce voyage-là s’abstiendra d’approcher du livre. Également, qui ne croit pas. Il faut croire, puisque ce qui arrive dans l’île défie la raison. Toute description progressive, non circulaire, de ce que provoque l’installation de cette plantation dans l’île des papayers manquera d’ailleurs sa réalité. Eh oui : c’est justement une irréalité formidable et circulaire qui caractérise la situation et la pénètre entièrement. La plantation remplace une « forêt vivrière » et rend la vie impossible ; elle est menacée de disparition par la voracité des parasites qui l’assiègent ; gardée par d’anciens sicaires qui prétendent agir au nom de la paix mais laissent entendre de dessous leurs bottes le bruit macabre de leurs histoires de sévices – et L’État colombien, pour sa part, continue de jouer à l’agent du progrès dans ce qui a toutes les allures d’une farce et traite les paysans dont il ne reconnaît pas les droits de propriété comme des barbares qu’il faut contenir. Ni paix, ni guerre, ni paix.
L’écrivain, prenant acte, ne sera donc pas la dupe de la raison. Contre les forces du cauchemar, il ne feindra pas de tenir la réalité avec des mots mais laissera agir à travers lui leur pouvoir de provoquer des métamorphoses. Nous voilà en pleine Palma Africana. Le moyen de comprendre les métamorphoses, pour l’auteur, est de se laisser devenir écrivain. Donc : de glisser. Mais enfin, qu’est-ce que cela veut dire ? Allez-vous, oui ou non, nous transmettre de quoi il est question dans cette île et ce livre ? Bien entendu. Mais comprenez que c’est d’abord un livre qui veut très sincèrement être sur rien et qui le dit. Il n’a pas de sujet et il n’a pas de thèse, et demande, sans vraiment le demander, qu’on lui en fasse grâce : qu’on l’accompagne seulement. Soit, il y a la mort, le cœur de l’affaire, ses agents, ses rituels – le capitalisme, le fétichisme de la marchandise, le développementalisme –, les écosystèmes broyés – des auteurs cités par tombereaux et comme en se jouant, on ne peut pas tous les citer ; c’est un livre sur la Colombie dans le rapport qu’elle entretient avec la bibliothèque de l’auteur. Il faut lire le livre pour s’en rendre compte, puis les autres livres de cette bibliothèque. Livre sur rien, ou livre sur tout : donc aussi sur l’inversion permanente de la thèse défendue, et l’être-insaisissable de l’écrivain qui s’avère tout le contraire de l’anthropologue, agent éminemment saisissable, lui, et même tout à fait habitué à finir au poteau puisque, on le sait, il est toujours celui du colonialisme.
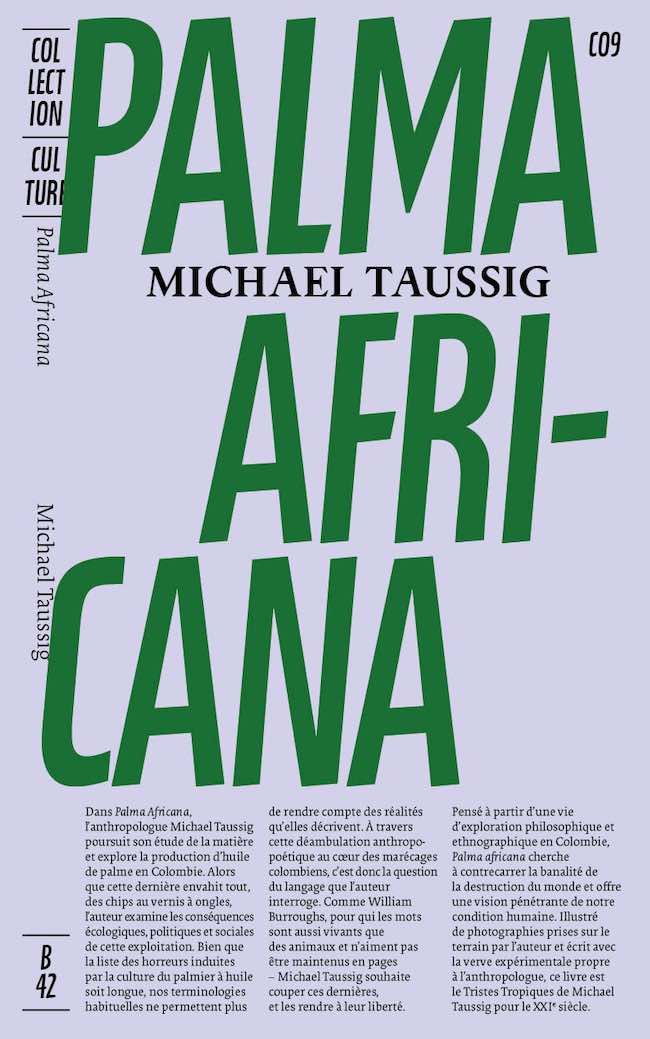
Malheureux recenseur, mon semblable, mon frère : tu mens. Une proposition s’affirme bien dès les premières pages du livre. Elle est paradoxale et scandaleuse, répétée sous des formes diverses. Page 25 : « Car selon moi, la question qui se pose est de savoir si la terreur peut octroyer une âme non seulement aux arbres, mais aussi à la nature en général, ou du moins exalter ses dispositions spirituelles ». Page 73 : « Serait-il possible que la choséité des choses soit tout à la fois exacerbée et animée, voire spiritualisée par une atmosphère de terreur chronique ? » Page 75 : « C’est cet agrogénocide qui met en évidence l’être même de ces choses arrachées à la terre. » Page 113 : « L’important pour moi ici, c’est que l’empathie avec le milieu naturel et sa personnification ne sont pas dues aux symétries et à la perfection du plan de la nature mais, au contraire, à la destruction et à la domination de la nature par l’homme. »
Réenchantée par ses blessures, la nature peut cesser d’être un objet et nous parler : voilà une découverte sur l’île aux papayers. Et… la thèse du livre, qu’on pourrait discuter ? Non, hélas, car je viens de me livrer à un acte d’une brutalité sans nom : j’ai extrait des citations du cut-up Palma Africana. Est-ce que je ne pouvais pas plutôt, au lieu de cette barbarie, prendre acte de la richesse du texte, constater, non la confusion, mais la manière inédite dont, s’emparant de l’essai, de la description ethnographique, du poème, de la photo, il culbute tous les genres et en repousse les limites ? Ne pouvais-je pas voir que l’auteur lui-même, malgré sa culture et son art de l’écriture, maîtrisés de longtemps, n’ignore pas qu’il va susciter l’incompréhension, la perplexité ? Qu’au lecteur qui l’accuserait de trouver de se réjouir du « plaisir du texte » là où règne la stérilité de l’économie de plantation de palme (qui n’a même pas pour elle la richesse culturelle associée aux plantations de sucre), il a l’honnêteté de répondre : « soit, je n’y peux rien » ?
En vérité, le recenseur dit que non. Pris d’un soudain besoin de clarté, il demande, bravache : que gagne-t-on à suivre l’auteur dans ses méandres ? Sera-ce le frisson de prendre à rebours le sens commun ? Ou la joie de lancer des ponts de singe reliant Roland Barthes au fleuve Magdalena (c’est aux pages 19-20 et plusieurs fois ensuite) ? Ou bien la satisfaction de se savoir indispensable, puisqu’un tel livre ne peut exister, on voudrait dire « encore moins que les autres », que par la bienveillance expresse de qui le lit ? Si cette personne-là (lecteur.trice) ne veut pas signer un pacte avec l’auteur démoniaque de Palma Africana – le pacte de fiction, la suspension consentie de l’incrédulité –, qu’elle se tienne à distance. Une recension mue par ce même souci d’honnêteté ne devait pas manquer de le signaler.
C’est fait, mais on sent qu’on manque encore de justice envers le livre, on ne l’a pas assez discuté. Il faut prendre le problème par un autre bout. Il ne faut pas du tout penser que c’est un livre de Michael Taussig, figure importante de l’anthropologie. Mais tenter de se souvenir de ce qui reste, une fois le livre refermé. Alors ? Des hérons, des couchers de soleil, des rencontres bizarres et inquiétantes, une photo de perroquet, le dessin d’un arbre mutilé, et le sentiment un peu honteux, vaguement réactionnaire, qu’on aurait préféré lire un livre d’anthropologie sur l’île des papayers.




![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)





![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)

