Le dernier roman de James Meek, ancien journaliste du Guardian, lauréat de plusieurs prix littéraires, a été accueilli avec force louanges lors de sa parution, et recommandé par Hilary Mantel, l’autrice à succès de Wolf Hall, aux « fans of intelligent historical fiction ». Vers Calais, en Temps ordinaire se déroule en 1348. En exergue, une citation de The Vision of Piers Plowman, satire composée quelques décennies plus tard, donne le ton : « Dieu est sourd, de nos jours ». Au sein d’une société corrompue, Piers le laboureur faisait le rêve d’une vraie vie chrétienne. On peut lire dans un ouvrage précédent de Meek, Dreams of Leaving and Remaining, que les partisans du Brexit ont gagné, non parce que leurs arguments étaient meilleurs, mais parce qu’ils partageaient la vision passéiste d’un grand nombre de votants.
James Meek, Vers Calais, en Temps ordinaire. Trad. de l’anglais (Écosse) par David Fauquemberg. Métailié, 460 p., 23 €
Cette fois, James Meek s’abstient de souligner des parallèles possibles avec le présent. Vers Calais commence la veille de la fête de saint Thomas, le martyr de Canterbury. Malgré l’épidémie de peste noire qui approche des côtes de l’Angleterre, un groupe de voyageurs se rend dans le Dorset afin d’embarquer pour le continent. Ce sont en majorité des archers conduits par un redoutable colosse, Hayne Attenoke. Un procureur écossais en route pour Avignon est chargé de leur servir de confesseur laïque. Will le laboureur, le meilleur archer des Cotswolds, tente de se libérer du servage en s’engageant dans leur troupe. La demoiselle Bernadine se joint à eux pour échapper à l’affreux barbon qu’on veut lui faire épouser, armée pour tout viatique d’un exemplaire du Roman de la Rose dont elle a fait son guide.

Siège de Calais (1346), auteur inconnu © D.R.
Comme les Juifs abondent dans les pays contaminés, on pense que ce sont eux les responsables de l’infection. L’Angleterre est sûrement protégée du fléau car il n’y en a plus un seul dans le royaume, tous ont été expulsés il y a un demi-siècle par un édit d’Édouard Ier, l’aïeul du souverain régnant. D’ailleurs, il paraît que cette prétendue peste est une ruse des prêtres pour s’enrichir en distribuant médailles protectrices et absolutions. Pourtant, certains villages du parcours brûlent des tas d’ossements pour faire reculer l’épidémie, d’autres dressent des murailles de prières ininterrompues contre le Malin.
À mi-chemin du livre, les voyageurs sont engagés par une noble dame pour jouer dans un spectacle inspiré du Roman de la Rose. Après la représentation, Will est livré aux appétits de la reine mère Isabelle et, oubliant son serment de fidélité à sa promise, s’accouple avec cette Française débauchée dans une scène d’étreinte torride. Ce n’est là qu’une parmi d’innombrables entorses aux principes chrétiens. Rites superstitieux, fausses reliques, ripailles, violence, scatologie, viols, meurtres, il ne manque aucun ingrédient à ces tableaux de vie médiévale, épicés par une paire de faux jumeaux, des travestis, des jongleurs, un barde gallois, un porc, un bouc, et nombre de références littéraires ou picturales. Un effet de miroir oppose l’amour romanesque et l’amour véritable, un couple d’aristocrates rejouant l’Amant et la Rose face à un couple de vilains qui leur en remontrent par leur noblesse de cœur. Les récits se croisent et s’éclairent mutuellement. Long-Gaillard, l’adjoint de Hayne, dévoile le passé de leur troupe. Thomas propose d’instruire les archers en commentant les images peintes sur les murs d’une église, Adam, Noé, Abraham. Pour réconforter Will à l’issue de divers rites d’initiation sanglants, dont une bagarre de hooligans avec les archers du Wiltshire, ses compagnons d’armes lui racontent l’épisode glorieux de Crécy, conscients comme s’ils avaient vu jouer Henry V du rôle de la muse de feu qui inscrira le récit dans les mémoires, « tout cela que le barde, après coup, allait mettre en chanson. Même un roi qui gagne ses batailles a besoin qu’on les chante… de sorte que les gens, à tout jamais, s’en ressouviennent ».
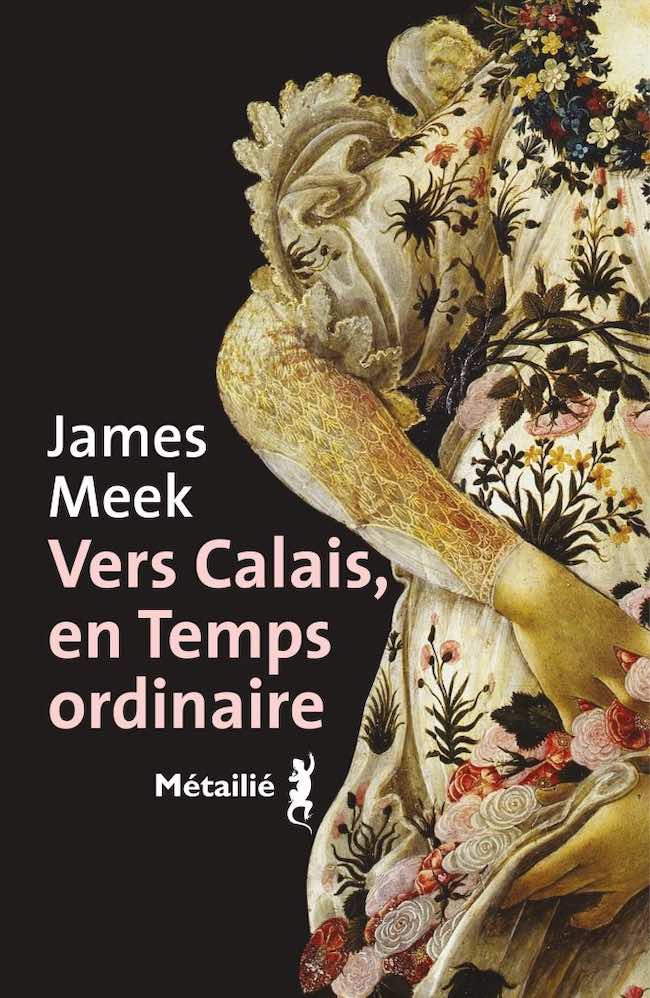
Depuis quelques décennies, les librairies anglaises ont des rayons entiers dédiés au whodunit, l’enquête criminelle, à travers les âges, médiéval, Tudor, victorien… Ce qui fait l’originalité de celui-ci, c’est qu’on connaît d’entrée les coupables, la troupe d’archers qui ont violé et emmené captive une jeune Française après avoir assassiné son père. Double transgression, épreuve de vérité qui donne la mesure exacte de leur conduite. Au cours du voyage, ils confient leur part, complicité active ou passive, dans ce crime, et interrogent leur conscience. Ils ont cru les religieux qui leur ont dit que la guerre était juste, qu’elle autorisait donc toutes les violences contre l’ennemi. Hayne le géant « leur avait servi un conte de Français sanguinaires et sans cœur, qui massacraient les innocents, arrachaient leur pucelage aux vierges et réduisaient en cendres bleues des rues entières ». Ils avaient le cœur pur, alors, mais bientôt ce sont eux qui ont pillé, brûlé, violé : « Tous les hommes du roi Édouard le faisaient, comme le roi les y invitait, et les capitaines du roi. C’était la guerre. Il n’y avait là point de péché. » Leur pérégrination est d’abord un voyage intérieur, qui ébranle les certitudes et les distances hiérarchiques, révélant à chacun sa vraie nature. Leurs confidences incitent Thomas à méditer sur une victoire à ses yeux déloyale : les flèches de l’amour, les flèches des archers sont les mêmes armes, féminines car elles blessent à distance. Will, lui, comprend d’instinct ce que le procureur découvre au moyen de sa culture livresque. Hommage oblique à Piers, comme lui laboureur de son état, il fait preuve d’une rare délicatesse de sentiments dans un monde de brutes, capable de reconnaître et de respecter la part de féminin en lui comme chez les autres. Seul Douceur, le plus féroce d’entre eux, qui a fait de l’infortunée Cess son esclave et continue de la brutaliser, s’enorgueillit de ses actes virils, certain que Dieu l’aime et le protègera. Les autres sont persuadés que la peste est le châtiment divin de leurs péchés. Mais ce n’est pas la bonne réponse. L’épidémie frappe indifféremment coupables et innocents.
Autre trait distinctif, la langue créée par James Meek, ou plus précisément la diversité des langages, reflet de la situation en Angleterre au XIVe siècle. Trois parlers se croisent dans la version originale : l’anglo-normand des propriétaires terriens, le dialecte pittoresque des paysans, assez éloigné du moyen-anglais de Chaucer, l’anglais latinisant des clercs. Autant d’obstacles aux échanges. « C’est le Cotswold », explique Bernadine. « On dirait que jamais le français n’effleura leurs lèvres. Je ne sais point moi-même parfois ce qu’ils racontent. » Elle lit Guillaume de Lorris dans le texte mais ne comprend pas le français de Cess, sans doute, pense-t-elle, parce que la jeune fille est de basse extraction. Thomas s’interroge : « Sommes-nous plus enclins à nous considérer les uns les autres en vertu de notre humanité, plutôt que de nos statuts civils respectifs ? », mais il juge « facile de nous illusionner en croyant qu’une fraternité universelle est l’inévitable conséquence d’une plus grande égalisation des statuts sociaux ». Cette harmonie nouvelle entre clercs, roturiers et aristocrates pourrait bien constituer « une occasion idéale pour la persécution des Juifs », dont seraient alors victimes ses serviteurs, Judith et le copiste Marc chargé de corriger son latin. Il se sent épuisé quand il doit expliquer la littérature courtoise à Will, « tout cela en anglais sans un seul mot de français ou de latin ». Selon le Maestro Pavone, « entre vous, vulgaires soldats, et vous autres, fils de la noblesse, se déploie un gouffre par-dessus quoi nul pont ne peut être lancé », mais ils peuvent s’échapper un temps de leurs conditions respectives en franchissant le rideau doré du Jeu. « Thomas a voulu m’apprendre ce qu’était une romance, mais je n’ai point saisi », répond Will quand on le désigne pour interpréter Vénus : « Tout ça, c’est trop français pour moi. »

Archers du Moyen Age © D.R.
C’est dire les embûches qu’a dû surmonter la traduction. Dans l’anglais parlé actuel, le souvenir de Chaucer et de Shakespeare reste vivace, et le prétérit toujours d’usage courant, à la différence de notre passé simple. L’original, un peu lassant parfois, est plus digeste que la traduction qui tente laborieusement de le restituer. Elle peine surtout à maintenir la cohérence des divers idiomes, ainsi le serf qui bouscule la grammaire anglaise – « there wasn’t no garden work to be done nor no other work neither » – s’exprime parfois en français dans une langue aussi châtiée, et improbable, que la demoiselle qui ordonne de lui cueillir la plus belle rose du jardin. Les personnages de l’original se tiennent à un registre, un niveau de langue, mais en traduction Will le laboureur passe de « Je pars point me battre » à « N’es-tu plus mon aimée ? » Divers procédés s’appliquent à donner aux dialogues une patine, verbes archaïsants (halter, pérégriner, semeler, giguer, galantiser), termes restés familiers grâce aux lectures scolaires (destrier, chausses, donzelle, fors, antan, tétins, s’esbaudir), et une once de patois, nenni-da, ou la « croué » qui passe de main en main.
Tous trouvent en route leur chemin de Damas. À la fin, Hayne s’incline devant Cess, redevenue Cécile, plus forte que lui, plus forte que la haine, « car je voudrais pas être comme vous », lui dit-elle en refusant la croix de chef qu’il lui tend : « C’est votre fardeau. » Les survivants prennent la mer, et le roman s’achève sur le rêve macabre d’un Will habité désormais par le doute : « La mort avait guère besoin de moi, a dit Will, et maintenant je sais point qui je suis. »







![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)




