Celui qui veille, roman de Louise Erdrich lauréat du Pulitzer, et le recueil de poèmes de Layli Long Soldier Attendu que ont ceci de commun que leurs autrices retracent les combats des peuples amérindiens dans un pays, les États-Unis, qui peine encore à leur donner une place. Elles posent aussi la question du rapport à la langue anglaise.
Layli Long Soldier, Attendu que. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Béatrice Machet. Isabelle Sauvage, coll. « chaos », 122 p., 24 €
Louise Erdrich, Celui qui veille. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Sarah Gurcel. Postface de Louise Erdrich. Albin Michel, 560 p., 24 €
L’un et l’autre livres mettent en lumière des moments de l’histoire des Premières Nations. Artiste sioux oglala vivant au Nouveau-Mexique, Layli Long Soldier évoque les 38 Dakotas pendus sur ordre du président Lincoln en 1862, dans la région d’où est originaire Louise Erdrich, dont le grand-père s’est opposé à un projet de loi visant certaines tribus, dont la sienne, celle des Chippewas des Turtle Mountains, en 1953. La présence des Amérindiens demeure, au fil des siècles, un sujet épineux pour certains hommes politiques, comme le rappelle Louise Erdrich dans sa postface : en 2020, « l’administration Trump et la secrétaire adjointe à l’Intérieur, Tara Sweeney, ont relancé la termination en cherchant à assimiler les Wampanoags, la tribu qui accueillit les Pères pèlerins du Mayflower sur les rives américaines ». Les excuses du président Obama en 2009 n’ont pas convaincu Layli Long Soldier, qui fait remarquer que le texte a été prononcé sans la présence de représentants des tribus et qu’il n’a pas été suivi d’actes s’apparentant à une réparation ; le budget alloué aux structures de santé dans les réserves, par exemple, ne fait que diminuer.

Layli Long Soldier © D.R.
Le recueil Attendu que (Whereas en anglais) fait jouer pleinement les qualités du genre poétique : touches allusives de poème en poème, sonorités évocatrices, jeux typographiques, interrogations sur la langue, la « langagitude ». L’anglais est bousculé, retourné, ne se superposant jamais exactement au vécu, ni au lakota. Les textes officiels eux-mêmes sont examinés : quels mots sont essentiels ? que veulent-ils dire ? comment sont-ils choisis ? « Attendu que j’aurais pu mais n’ai pas abordé le sujet « génocide » l’absence de ce terme dans les excuses et son remplacement par « conflit » par exemple », écrit Layli Long Soldier. « Attendu que » est la locution qui revient en anaphore dans la formulation des excuses du gouvernement américain ; elle la reprend à son compte. Dire qu’un mot n’a pas d’équivalent, c’est une question de traduction, mais pas seulement de langue à langue ; qu’est-ce qu’un mot qui n’est pas traduit en acte ? « Comme vous le savez peut-être déjà, dans beaucoup de langues amérindiennes, il n’y a pas de mot pour dire « excuse ». Pareil pour « désolé ». Cela ne veut pas dire que dans les communautés des premiers habitants d’Amérique où le mot « excuse » n’est pas prononcé, il n’existe pas d’actions explicites pour admettre et réparer un méfait. Donc, je me demande comment, sans le mot, ce texte [se traduirait en] geste. »
Layli Long Soldier a une formation en arts plastiques (elle a d’ailleurs exposé une installation interactive, Whereas We Respond, dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud) et un grand sens de l’espace sur la page. Ainsi, dans l’un des poèmes de la partie « Résolutions », la phrase qui « honore et félicite les premières nations » forme une étroite colonne sur la partie gauche tandis que le reste de la page est occupé par les mots « cette terre » dispersés, répétés une vingtaine de fois, comme une illustration de la mainmise des États-Unis sur le territoire, reléguant les tribus amérindiennes à la marge. Layli Long Soldier le mentionne plus explicitement dans le poème 38 (détaillant les circonstances de la pendaison collective de 1863) : « En 1851, le territoire dakota se résumait à une bande de dix-neuf kilomètres de large sur deux cent quarante et un kilomètres le long de la rivière Minnesota. Mais sept ans plus tard, en 1858, la partie nord fut cédée (confisquée) et la partie sud fut (commodément) distribuée, ce qui réduisit les terres dakotas à une étendue désolée de seize kilomètres. »

Louise Erdrich © Jean-Luc Bertini
Non loin de là, dans le Dakota du Nord, se trouve Turtle Mountain, une réserve chippewa ; c’est là que se déroule en grande partie l’action du roman de Louise Erdrich, Celui qui veille. Le personnage central, Thomas Wazhashk, inspiré par le grand-père maternel de Louise Erdrich, n’est pas seulement veilleur de nuit dans une usine de pierres d’horlogerie mais aussi président du conseil tribal ; sa vigilance au sujet d’une résolution du Congrès finit par mobiliser plusieurs membres qui se rendent ensemble à Washington. Lui aussi traque le sens sous les mots : « Dans la presse, l’auteur de la proposition de loi avait construit autour de son texte un nuage de grands mots – émancipation, liberté, égalité, succès – qui maquillaient sa vérité : la termination. Ne manquait que le préfixe. Le « ex ». » Ce n’est pas parce qu’il n’a pas fait d’études qu’il ne sait pas lire entre les lignes et reconnaître les mots trompeurs. Dans une scène mémorable, c’est lui qui explique le problème, les tenants et les aboutissants, à Lloyd Barnes (dit « Meule de Foin » à cause de sa touffe de cheveux blonds), qui enseigne les mathématiques et la boxe, le seul Blanc de la réserve.
Cet ample roman qui se déroule dans les années 1950 ne se résume pas à la vie de cet homme ni à des questions juridiques ou politiques ; Thomas Wazhashk est le représentant d’une communauté plus large, unie dans la joie comme dans l’adversité. Le personnage féminin le plus important est Patrice Paranteau, nièce de Thomas, qui travaille dans la même usine comme ouvrière. Son travail est le gagne-pain de la famille ; son père est alcoolique, et sa sœur, Vera, ne donne plus de nouvelles depuis qu’elle est partie en ville. Patrice, dite Pixie, se met en tête de la retrouver et prend le train pour Minneapolis. Il y a aussi Wood Mountain, un jeune boxeur dont l’arrière-grand-père avait suivi Sitting Bull vers le nord après la bataille de Little Big Horn, Louis Pipestone, dont le fils est mort sous les drapeaux en Corée, sa fille Millie, partie étudier à l’université et dont les travaux sur les conditions économiques de la réserve aident à plaider la cause des Chippewas de Turtle Mountain. Il y a des mormons. Il y a Valentine, Doris et Betty, des jeunes femmes qui travaillent dans la même usine que Patrice, tour à tour amies, rivales, confidentes. Il n’y a plus de bisons, mais il y a des chevaux et des ours. Autrement dit, il y en a pour tous les goûts : de l’aventure, de l’amour, de la bagarre et même des fantômes.
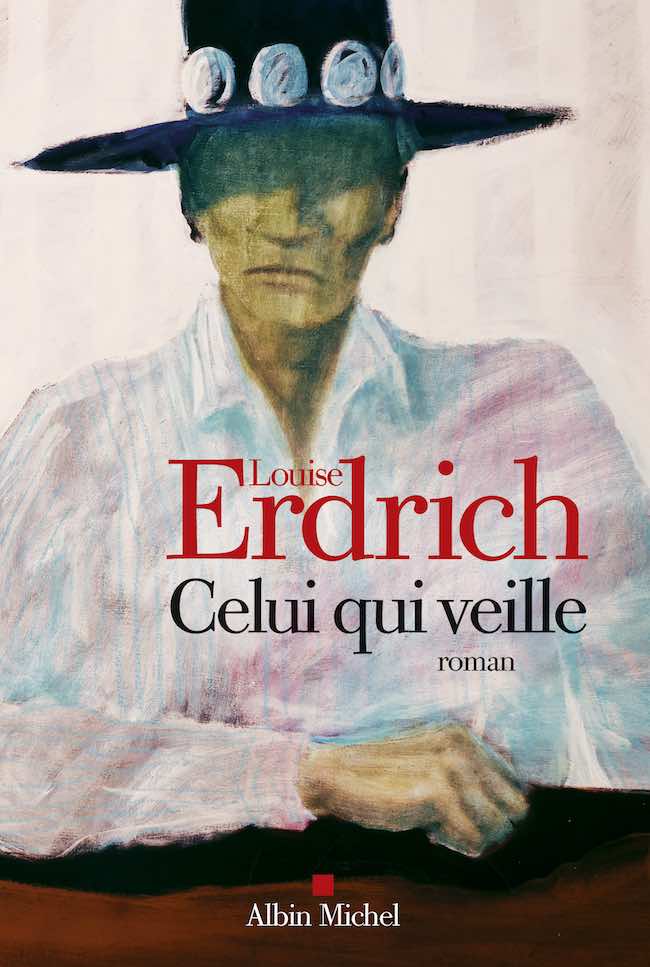
Le tout est organisé en courts chapitres, les fils de l’intrigue se croisent et captent l’attention du lecteur. Les dialogues sont bien écrits, les descriptions aussi, les personnages ont de l’épaisseur, bref le roman fonctionne bien. Presque trop bien, on en vient à se demander si on est dans une production hollywoodienne, mais l’autrice nous réserve quelques surprises. Si le roman aborde des sujets douloureux, notamment la disparition et l’exploitation sexuelle des Amérindiennes, il laisse une grande part à la force solidaire de la communauté et ne manque pas de passages humoristiques. Le tout bel et bien inspiré de faits historiques : un match de boxe a réellement été organisé pour lever des fonds à destination de la délégation envoyée à Washington.
La narration fait parfois penser à la biographie de Crazy Horse par Mari Sandoz, récemment parue en français (Crazy Horse. L’homme étrange des Oglalas, trad. par Daniel Bismuth, éditions du Rocher, 720 p., 26 €). Dans cet ouvrage, écrit en 1942 par une femme qui a côtoyé des membres de la famille de ce célèbre chef sioux, le lecteur en apprend autant sur les rivalités entre tribus et les conflits avec les Blancs que sur le mode de vie des Amérindiens de ces régions. Certains mots sont en langue amérindienne, les repères temporels étroitement liés à la saisonnalité des choses sont indiqués tels quels, reproduisant un mode de vie ancestral incarné dans le roman de Louise Erdrich par Zhaanat, la mère de Patrice : « De l’avis de Zhaanat, les problèmes avaient commencé quand on s’était mis à nommer les lieux d’après des gens – personnalités politiques, prêtres ou explorateurs – plutôt que d’après ce qui s’y passait – l’endroit où on rêvait, mangeait, mourait, là où venaient les animaux. La confusion qu’opéraient les chimookomaanag entre la terre éternelle et la brève existence des mortels était typique de leur arrogance. Il lui semblait que ce comportement avait ouvert une faille dans la vie de ces lieux. Les animaux ne fréquentaient plus les sites souillés par les noms d’humains. Quant aux plantes, elles ne poussaient plus que par intermittence. […] L’expérience lui avait appris que lorsque ces gens commençaient à parler de prendre des terres, c’était comme si c’était fait ».
Cette filiation est partout. Bien avant que la délégation des Chippewa de Turtle Mountain soit reçue à Washington, une délégation lakota y avait été reçue, en 1870. Si le contexte était différent, l’enjeu reste le même : permettre aux Amérindiens de conserver leur territoire et s’assurer de leur survie. Déjà sous la présidence d’Andrew Jackson, dans les années 1820, il avait été promis à certaines tribus du sud-est du pays comme les Cherokees que leur territoire resterait à eux « tant que l’herbe poussera et que l’eau coulera », une phrase qui a marqué les mémoires (il y est fait référence dans Celui qui veille comme dans la biographie de Crazy Horse) et qui est devenue, ainsi que le remarque Howard Zinn dans son Histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours (trad. Frédéric Cotton, Agone, 2002), emblématique de la duplicité des dirigeants états-uniens vis-à-vis des Amérindiens.

De traité en traité, de délégation en délégation, la vigilance reste de mise ; les territoires amérindiens ont été convoités pour l’or qu’on a pu y trouver, mais aussi plus récemment pour créer un site d’essais nucléaires (réserve de Pine Ridge) ou faire passer un pipeline (réserve de Standing Rock) ; Layli Long Soldier donne la parole à des résidents de ces réserves dans l’un de ses poèmes, avec des phrases tirées de témoignages en ligne et d’entretiens. Les mots ont un poids, un sens, elle le rappelle en relevant dans le passé des propos dignes du fameux « qu’ils mangent de la brioche » prêté à Marie-Antoinette pendant la Révolution française :
« Quand les Dakotas mouraient de faim, comme vous vous en souvenez, les commerçants du gouvernement n’accordaient aucun crédit aux « Indiens ».
Un des commerçants, nommé Andrew Myrick, est célèbre pour son refus de faire crédit aux Dakotas, il avait dit : « S’ils ont faim, qu’ils mangent de l’herbe ».
Il y a des variantes aux paroles de Myrick, mais elles visent toutes le même but.
Quand, pendant la révolte des Sioux, les colons et les commerçants furent tués, l’un des premiers à être exécutés par les Dakotas fut Andrew Myrick.
Quand le corps de Myrick fut trouvé,
sa bouche était farcie d’herbe.
Je suis encline à nommer poème cet acte des guerriers dakotas. »
Les premières lignes du recueil de Layli Long Soldier, « Maintenant / faire de la place dans la bouche pour / lesherbeslesherbeslesherbes », prennent alors tout leur sens. L’heure n’est plus aux guerres indiennes, mais la résistance s’organise autrement, différemment, et la mémoire, y compris celle des résistances passées, se perpétue grâce à ceux et celles qui écrivent. Qui font de la place dans la langue anglaise pour des mots amérindiens (des noms de plantes médicinales, par exemple), de la place dans la littérature américaine, en vers et en prose, pour des expériences et des récits amérindiens. C’est une parole de plus en plus reconnue, comme en témoignent le récent prix Pulitzer attribué à Louise Erdrich et la nomination de Joy Harjo comme Poète lauréat en 2019. Il est à souhaiter que cette parole ne s’affadisse pas pour autant et qu’elle garde la force d’un acte, la voix parfois levée comme un poing.







![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)




