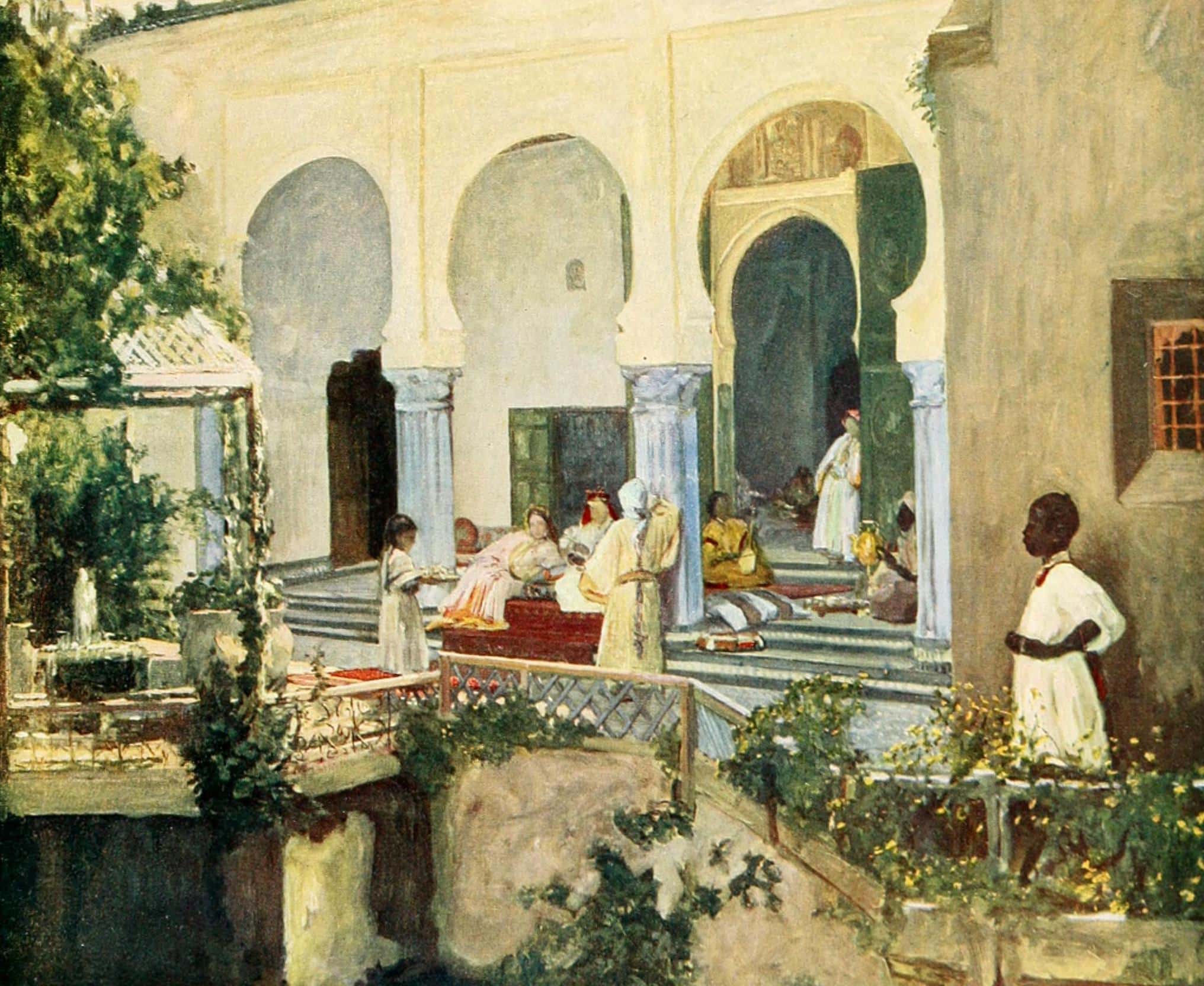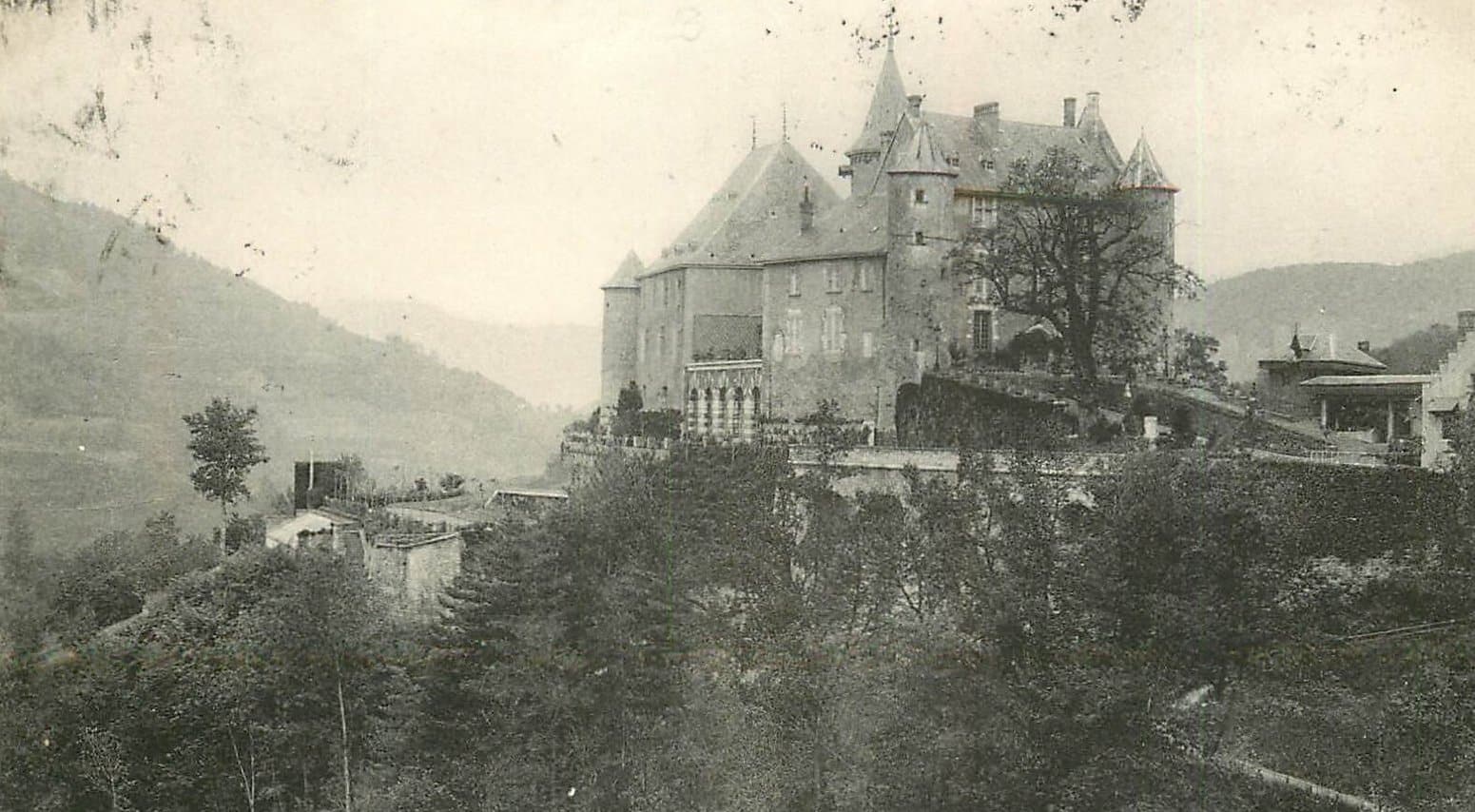Quelques conquistadors errent pendant dix ans entre le nord du Mexique et le sud des actuels États-Unis, se débarrassent de leurs armes, et connaissent un profond changement de mentalité au contact des Indiens – qui les rend inaptes à vivre ensuite en harmonie avec les colons espagnols qu’ils furent autrefois ; c’est l’histoire du Voyage extraordinaire de Cabeza de Vaca dans l’Amérique indienne, auquel Andrés Reséndez consacre un essai : Un si étrange pays.
Andrés Reséndez, Un si étrange pays. Le voyage extraordinaire de Cabeza de Vaca dans l’Amérique indienne. Trad de l’anglais (États-Unis) par Paulin Dardel. Anacharsis, 350 p., 24 €
Une troupe de quelque 600 colons espagnols quitte Séville en 1527 afin de poursuivre vers le nord la conquête du Mexique et d’offrir à l’insatiable Pánfilo de Nárvaez les terres nord-américaines qui lui étaient destinées par l’empereur Charles Quint. Au terme d’une aventure incroyable et tragique, quatre hommes, trois conquistadors et un esclave noir, parviendront à rejoindre leurs coreligionnaires chrétiens installés au Mexique, en parcourant à pied et sur des radeaux précaires des milliers de kilomètres le long des côtes de Floride, d’Alabama, du Mississippi, de Louisiane, du Texas et jusqu’à la côte mexicaine pacifique après avoir traversé la Sierra Madre. Le tiers des colons a fait défection et le reste, environ 300 hommes dont Nárvaez lui-même, a péri dans une succession de naufrages dus à des erreurs fatales de navigation, des combats contre les Indiens, la faim et les maladies ; certains ont été acculés au cannibalisme.

Portrait de Pánfilo de Narváez
L’un de ces survivants, Álvarez Núñez Cabeza de Vaca, noble trésorier de sa majesté, donne en 1540 le récit de cette épopée sous le titre discret de Relation de voyage [1]. L’ouvrage que publient aujourd’hui les éditions Anacharsis n’est pas ce récit, ni celui qu’écrivirent les trois autres rescapés, mais la traduction d’un essai d’Andrés Reséndez consacré à cette aventure : Un si étrange pays. Le voyage extraordinaire de Cabeza de Vaca dans l’Amérique indienne.
En dehors de la Relation de voyage publiée par Cabeza de Vaca, il y eut à l’époque de nombreux récits sur cette catastrophe colonialiste. Mais comme tout est incroyable dans cette histoire, et que l’amplification épique s’est emparée des historiographes de l’époque, le travail extrêmement précis sur les sources, les itinéraires et les interprétations effectué par Andrés Reséndez est essentiel pour démêler le vrai – ou du moins ce qu’on peut raisonnablement tenir pour tel –, le mythe et son martyrologe. L’auteur, historien à l’université de Californie à Davis, analyse et compare les récits, dresse la toile de fond que constitue l’entreprise coloniale espagnole et les figures concurrentes de Nárvaez, Cortéz ou Guzman. Dans une série de chapitres qui suivent l’aventure depuis sa préparation jusqu’à sa fin lamentable, il guide le lecteur dans les arcanes de ce voyage unique en son genre.
Il a souvent été écrit que Cabeza de Vaca n’était pas un conquistador comme les autres, mais plutôt un noble serviteur de l’État et qu’il avait professé à l’égard des habitants des territoires conquis par l’Espagne une attitude non violente et coopérative. Le climat d’horreur qui accompagne la conquête du Nouveau Monde rend difficile de croire à ce qui semble une légende. C’est là qu’intervient Andrés Reséndez, qui nous fait comprendre que la survie improbable de ce petit groupe de rescapés ne peut s’expliquer que par une transformation profonde de la mentalité de ces mêmes colons. Il montre que les circonstances tragiques, mises à profit par l’esprit éclairé de Cabeza de Vaca, leur ont permis de reconnaître aux Indiens – que les Espagnols traitaient spontanément de sauvages et massacraient sans retenue – les compétences qu’ils allaient partager et qui allaient les sauver.

Affiche du film « Cabeza de Vaca » réalisé en 1991 par Nicolás Echevarría
Tout commence par le sacrifice de ce qui garantit aux Espagnols leur supériorité guerrière : ils mangent leurs chevaux, fondent le métal de leurs armes pour en faire des outils. Des gestes qui, consciemment ou non, leur font abandonner leur statut de conquérants. Dès lors, ils se retrouvent sur un plan d’égalité technique avec les chasseurs-cueilleurs qu’ils rencontrent. Lorsque, à bout de forces et décimés par l’enchaînement sans fin des catastrophes, ils ne sont plus que quatre sur les 300 jetés sur les côtes de la Floride, le petit groupe développe une attitude nouvelle face au monde et aux « sauvages » qui l’occupent. Parmi eux, se trouve un esclave noir d’origine marocaine. Sans doute aguerri par toutes les souffrances qu’il a précédemment endurées, il se retrouve désormais compagnon d’infortune de son maître, Andrés Dorantes, d’Alonso del Castillo et de Cabeza de Vaca, deux capitaines appartenant à l’aristocratie espagnole. Estebanico, c’est son nom, reste marqué par son statut subalterne mais, comme l’ensemble du groupe est fait prisonnier et mis en esclavage par les Indiens, leurs rapports changent devant l’évidence que désormais, blancs ou noirs, tous sont soumis à la même règle.
Andrés Reséndez insiste d’autant plus sur la transformation que subit la mentalité des colons qu’il lui faut rendre compte en particulier d’un évènement très singulier. Alors qu’après des années d’un cheminement épuisant ils approchent du Rio de las Palmas, destination que Nárvaez s’était fixée au départ de Séville, subitement ces piétons erratiques bifurquent vers le nord-ouest, tournant le dos au golfe du Mexique, et s’engagent sur une voie qui mène vers le Pacifique à travers la Sierra Madre occidentale. Comment expliquer une décision apparemment si folle, sinon par une sorte de nouvelle confiance en soi, acquise au long des années de fréquentation quasi symbiotique des populations autochtones ?
En prenant ce chemin inattendu, Cabeza de Vaca et ses hommes semblent partis pour une nouvelle expérience de découverte du monde, refondée par les épreuves surmontées. L’Espagnol raconte ainsi comment, avec un certain étonnement, il a constaté que les Indiens leur prêtent des pouvoirs magiques ; comment ils ont multiplié les cérémonies au cours desquelles sont psalmodiés force « Ave Maria » et « Pater noster », et distribuent des signes de croix améliorant visiblement l’état des malades. De fait, pour des raisons qui tiennent à la nature même du sacré, les Indiens ont vu assez tôt en ces hommes venus d’ailleurs, et si différents d’eux, de ces chamans auxquels un pouvoir guérisseur était attribué. L’explication d’Andrés Reséndez est la suivante : « Plus l’expédition de Nárvaez se délitait et plus ses survivants se cramponnaient désespérément à leur foi bien-aimée. En effet, les trois derniers Espagnols (nous ignorons si ce fut le cas pour Estebanico) en vinrent à considérer leur supplice comme une mise à l’épreuve divine pour expier leurs péchés, en clair comme une sorte de martyre. » Leur survie leur apparait comme un dessein de Dieu, eux-mêmes bénéficieraient d’une attention divine. De sorte que, au rôle de guérisseur que les Indiens leur attribuent, correspond, chez ces moines errants, une disposition mentale parallèle et réciproque, une sorte de proximité partagée avec l’ordre du sacré.

Carte du Mexique au XVIe siècle réalisée par Hubert Howe Bancroft, et publiée dans le deuxième volume de son « Histoire du Mexique » (1883)
C’est grâce à cette convergence que les conditions qui garantissent le fonctionnement efficace de la magie furent remplies. On se tromperait donc en croyant qu’il y eut de la part des Espagnols un simple opportunisme cynique. On sait que, dans les rituels, le chaman doit jouer du mieux qu’il peut son rôle de chaman ; or, se sachant incapables de telles prouesses, les Espagnols considéraient que Dieu en était responsable, ce qui rendait leurs « performances » crédibles et donc efficaces. Parmi eux, Miguel del Castillo, fils de médecin, trouve les paroles et les gestes les plus adéquats ; il remporte un succès constant dans ses activités d’homme-médecine. Il semble même que Cabeza de Vaca ait réalisé ce qu’on peut appeler une « résurrection », mais il est important de noter qu’il parle de ce miracle comme d’un mystère finalement très angoissant pour lui, même si les Indiens en sont enthousiasmés.
Ainsi, de communauté en communauté, les guérisseurs improvisés acquièrent la réputation d’être des « Fils du Soleil » de sorte qu’ils avancent sur leur route accueillis et nourris par des populations nombreuses, avides de leurs sortilèges. Leur longue traversée du « pays du maïs », au nord du Mexique, suscite un tel enthousiasme que les quatre chamans sont alors suivis par une cohorte de plusieurs centaines de femmes et d’hommes quémandant leur intercession sacrée. Au lever du soleil, les Indiens tendent leurs mains vers le ciel et les passent ensuite sur le corps des étrangers ; ceux-ci en sont d’ailleurs assez effrayés. Pour affermir leur autorité, ils s’imposent une sorte de silence et ne communiquent que par l’intermédiaire du seul Estebanico, jouant habilement de la différence de celui-ci. Au contact des populations nomades aussi bien que des sédentaires, ils découvrent des mœurs que Cabeza de Vaca rapporte avec étonnement, comme l’infanticide des filles chez les Mariames ou cette forme de potlatch inversé rencontrée dans la région de Tamaulipas. Ils se familiarisent avec plusieurs langues autochtones et développent leur connaissance des ressources alimentaires disponibles dans chaque région. Au lieu de piller comme tout bon conquistador, ils ont appris à collaborer avec ces humains qui leur semblaient si étranges.
Ainsi, lorsque nos quatre vagabonds, accompagnés d’une foule d’Indiens, rencontreront finalement des Espagnols, au terme de presque dix années d’errance, l’évènement tournera au drame. Les rescapés vivent désormais « comme » les autochtones, pieds nus et dépourvus de toute possession. Les soldats du capitaine Alcaraz qu’ils ont devant eux ne songent qu’à s’enrichir et à capturer des esclaves. Le conflit est inévitable. Or Cabeza de Vaca a promis aux Indiens de mettre fin aux exactions des Espagnols. Il a en vue l’établissement d’une colonie réconciliée et prospère où les cultivateurs de maïs et les chrétiens vivraient en bonne intelligence. Rien de tel n’arrivera ; et si Dorantes et Castillo parviendront à se faire une vie au Mexique en épousant des veuves solitaires, le destin de Cabeza de Vaca et de Estebanico illustre de manière emblématique l’inadaptabilité profonde qu’a engendrée chez eux cette expérience humaine exceptionnelle au contact des populations autochtones. Le destin tragique ne les lâchera pas.
Fondé sur une ample bibliographie, l’essai d’Andrés Reséndez nous aide à comprendre comment l’apprentissage forcé auquel ont été soumis ces quatre rescapés les a transformés au point de les rendre quasiment inaptes à reprendre une vie normale parmi des contemporains qui leur étaient devenus étrangers, et dont ils ne comprenaient ni n’acceptaient les comportements violents et destructeurs. Il fait ainsi de la Relation de voyage de Cabeza de Vaca un ouvrage pleinement contemporain des Essais de Montaigne.
-
Álvarez Núñez Cabeza de Vaca, Relation de voyage, traduction de Bernard Lesfargues et Jean-Marie Auzias, Actes Sud, 2008.