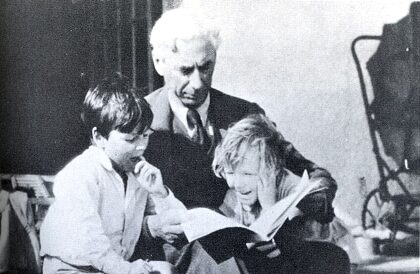Le titre de cet essai, La fin des choses, pourrait mettre la puce à l’oreille, après tous les démentis apportés à la fameuse fin de l’Histoire. Le sous-titre, Bouleversements du monde de la vie, y adjoint une emphase, une petite note de suffisance qui ne sera pas démentie. Il s’agit d’une suite de fragments sur le monde actuel, rédigés dans un style télégraphique par un auteur, Byung-Chul Han qui dit « pratiquer la philosophie comme un art », a écrit une vingtaine de livres en allemand, et connaît un certain succès chez les Anglo-Saxons.
Byung-Chul Han, La fin des choses. Bouleversements du monde de la vie. Trad. de l’allemand par Olivier Mannoni. Actes Sud, coll. « Questions de société », 144 p., 16 €
Son petit livre s’ouvre sur la référence à un roman japonais où, inexplicablement, les choses, chapeaux, clochettes, oiseaux, disparaissent. Il s’achève sur un éloge du juke-box, où l’auteur découvre avec ravissement l’existence d’un objet qui crépite et vrombit comme seule une vraie chose peut le faire. C’est que, pour Han, le monde qui nous définit et qui nous traverse est celui des non-choses (smartphone, selfies, cloud numérique…) que fabrique l’information. C’en est fait de l’ordre terrien, nous sommes assaillis par un tsunami communicationnel qui nous dérobe toute présence, solidité et stabilité, et anéantit la poésie et la pensée. Celle-ci, en l’occurrence, se résume à deux sentences : « l’être est information » ; « il n’y a plus d’altérité ».
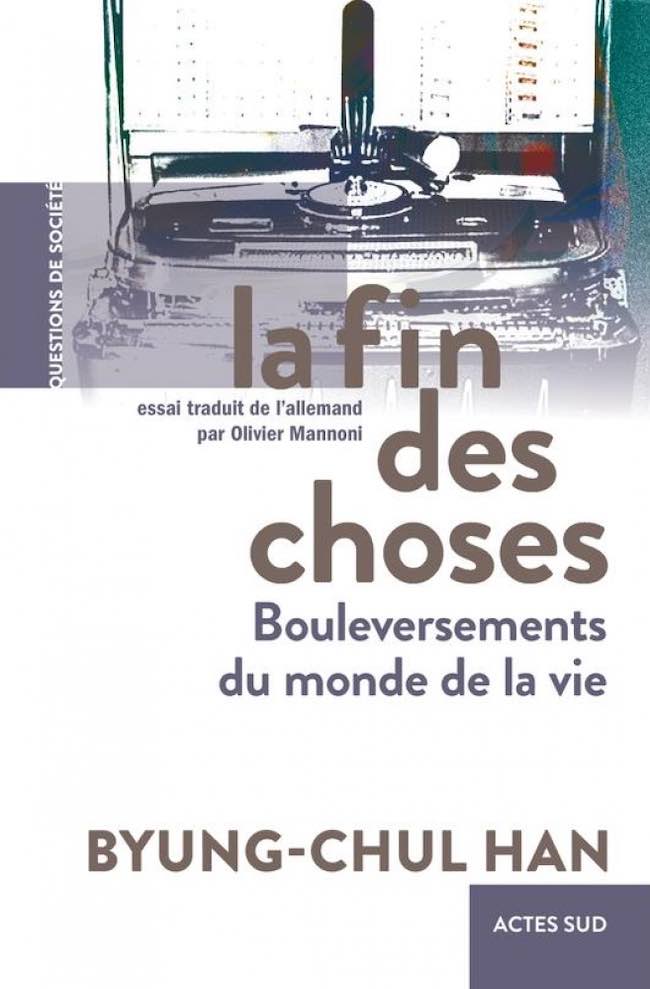
Gavés que nous sommes de positivité et d’excès en tous genres, il ne nous reste plus qu’à regretter « l’idiotie » du passé, ce temps où les choses étaient « rusées » et avaient du cœur, où opérait la « magie du séjour » alors que nous sommes aujourd’hui confrontés à « l’intellectualisation croissante de la réalité » ; ce temps où le monde était merveilleusement opaque et hérissé de « piquants » et non pas « offert » par les algorithmes – lesquels lui impriment une disponibilité et une transparence des plus aliénantes. Compulsivement attachés aux clics et aux likes (ces « amen numériques ») qui nous constituent, nous « performons l’identité », nous jouons plus que nous travaillons, la communauté digitale est aussi vaine et vide que le reste. L’intelligence artificielle ne connaît pas de pathos, « il lui manque l’esprit ». Les non-choses sont « soumises ». Le regard, la voix, « le dos » des choses, manquent ; il n’y a plus que des infomats et des objets autistiques.
Tout en se défendant d’être nostalgique, Han aligne une vision binaire à travers ses énoncés pauvrement constatifs et bizarroïdes : « La première image de pensée, c’est la chair de poule. » Ces affirmations s’appuient sur une kyrielle de citations avantageuses où la French Theory côtoie Walter Benjamin, Hölderlin, Rilke, Ernst Bloch, Robert Walser et surtout Heidegger (auquel Han a consacré sa thèse ; le contraste est marquant entre la rugosité du maître et la simplicité du disciple). Mais son petit essai se contente de reproduire platement et sans humour des thématiques avancées par Baudrillard il y a quelques décennies.
Gregory Bateson rappelait qu’on parle de métalogue lorsque la communication d’une idée est congruente dans sa structure et sa forme avec l’idée. Naïvement, La fin des choses en produit un. La pop philosophie n’a toujours pas trouvé son maître.