La société française est en crise. Le monde est en crise : crise sociale, comme l’a montré le mouvement des Gilets jaunes, crise sanitaire, crise climatique, désaffection massive du politique. On pourrait poursuivre l’énumération. En face de ce constat, finalement commun, Didier Fassin fait le pari de l’intelligence. L’accumulation des crises se lit alors comme un moment critique qui s’accompagne aussi de « temps de résistances, de mobilisations et d’expérimentations ». Pour analyser et enrichir la compréhension de ce moment critique et pour envisager une ouverture des possibles vers le monde dans lequel nous souhaiterions vivre, Didier Fassin a fait appel à de très nombreux spécialistes pour rédiger les soixante-quatre chapitres qui composent le volume. On peut donc consulter chacune des entrées indépendamment des autres, comme on feuilletterait une encyclopédie des temps présents. Loin d’étaler leur érudition, autrices et auteurs ont su présenter des synthèses claires accompagnées de courtes bibliographies et de notes abondantes, si l’on souhaite en savoir plus.
Didier Fassin (dir.), La société qui vient. Seuil, 1 344 p., 29 €
Dans les cinq premières parties du livre (« Enjeux », « Politiques », « Mondes », « Inégalités », « Reconnaissances ») on retrouve les grandes questions qui agitent en ce moment le monde médiatique et politique, et préoccupent ce que l’on appelle l’opinion publique. Le premier des enjeux pour la société qui vient est l’écologie, à laquelle Christophe Bonneuil consacre un article intitulé « Terre », où il présente ce qui est aujourd’hui notre commune condition, l’Anthropocène, « cette nouvelle époque de l’histoire de la Terre dans laquelle les activités humaines sont devenues force tellurique, à l’origine de dérèglements profonds, multiples, synergiques et difficilement prévisibles de la planète saisie dans son ensemble ». Les conquêtes émancipatrices doivent alors être pensées par les sciences humaines et sociales en réintégrant les puissances d’agir autres qu’humaines, c’est-à-dire en rappelant que, « loin d’environner le social », ce qu’on appelait « nature » le traverse et le travaille. À propos de l’immigration, François Héran, qui récuse à la fois le rêve d’ouverture universelle et celui de clôture généralisée, écrit que le chercheur n’est pas là pour trancher le débat public mais pour le nourrir en livrant des informations lisibles et vérifiables, servies par des arguments de qualité. Certains auteurs vont plus loin cependant et nous donnent réellement à penser.

© Jean-Luc Bertini
Didier Fassin, d’abord, dans le chapitre passionnant qu’il consacre aux théories du complot. Il en choisit deux illustrations. En novembre 2020, alors que la France compte déjà près de deux millions de cas de covid parmi lesquels plus de 42 000 morts et que la population est confinée pour la deuxième fois, la plate-forme Viméo projette le documentaire Hold-Up, qui prétend dévoiler d’effroyables vérités cachées, par exemple le fait que l’élite mondiale serait décidée à éliminer 3 milliards et demi de pauvres dont les riches n’auraient plus besoin. En quelques jours, plusieurs millions de personnes auront vu ce film. La même année, un forum internet QAnon dénonce une cabale satanique et pédophile qui gouvernerait le monde. Plus d’un États-Unien sur cinq adhèrerait à cette thèse. Donald Trump est celui qui a le pouvoir d’interrompre le projet maléfique. Si la croyance en la puissance malfaisante de forces obscures n’est pas un phénomène récent, les théories actuelles circulent rapidement dans le monde entier et rencontrent les idéologies populistes, ce qui les rend potentiellement inquiétantes.
Il ne s’agit pas de se contenter de dénoncer les théories complotistes, mais de comprendre leur succès au sein des « groupes dominés » méfiants à l’égard des récits officiels. Didier Fassin puise dans son expérience de sociologue de la santé pour rappeler des expérimentations humaines sur la transmission du virus du sida, conduites en Afrique du Sud où l’on a exposé indûment des sujets, habitants des townships, à des risques graves de contamination. Dans l’État de l’Alabama, aux États-Unis, une étude sur la syphilis, menée en 1932 sur des paysans noirs atteints de cette affection, leur faisait croire qu’on les traitait alors qu’ils n’ont jamais pu bénéficier de la pénicilline, introduite en 1947. Dans le cas français, c’est à la fois le manque de transparence dans l’action publique et l’habitude du secret voire du mensonge, mais aussi la progression du sentiment d’injustice, parmi beaucoup d’autres facteurs, qui peuvent favoriser l’adhésion aux thèses conspirationnistes.
Dans la rubrique « Mondes », le chapitre que Fabien Truong consacre aux banlieues, lieux de passage devenus zones de confinement dans une logique qui du sas mène à la nasse, transforme lui aussi le regard et enrichit la réflexion. Il analyse et récuse les conceptions misérabilistes et les représentations binaires et sensationnalistes qui présentent les quartiers populaires comme un univers menaçant frontalement la cohésion nationale. La popularité d’acteurs comme Omar Sy ou d’autres, le succès politique du Comité Vérité et Justice pour Adama, la place prise par le rap et la street culture, montrent bien que ces représentations sont des combats d’arrière-garde, « en complet décalage avec la place culturellement occupée par tout ce qui est attaché à la banlieue, et à sa jeunesse en particulier ». Les banlieues apparaissent plutôt, conclut Fabien Truong, « comme le creuset d’une société particulièrement inégalitaire, malgré leurs profondes interrelations avec les centres cossus ». De ces inégalités mais aussi des discriminations sous toutes leurs formes, il est largement question dans la troisième section de l’ouvrage.
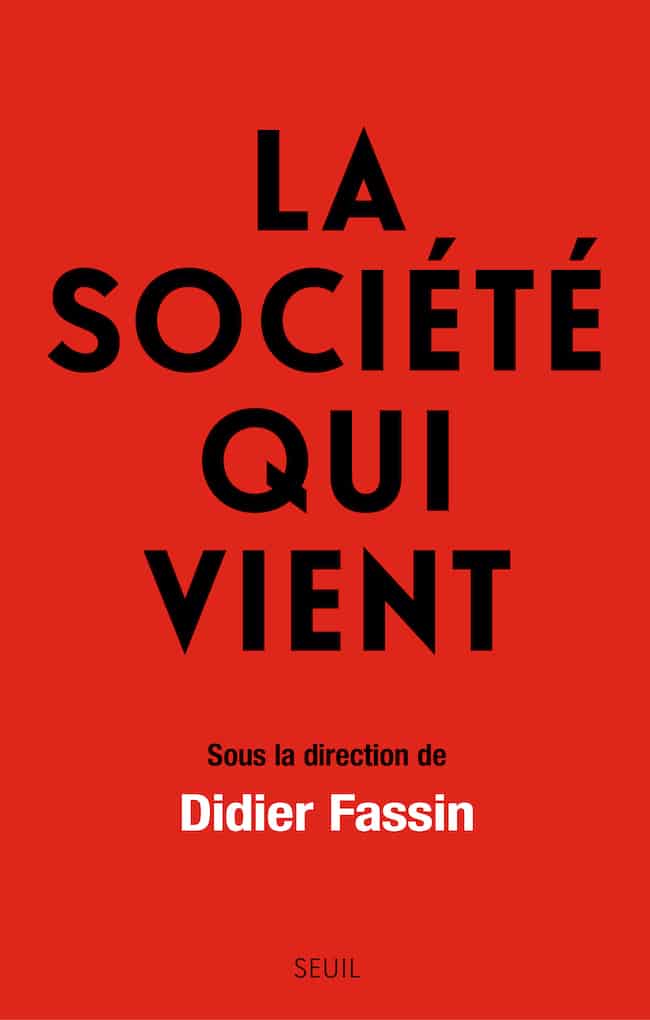
Dans un chapitre particulièrement percutant qui porte sur la justice, un de ces « mots usés tant ils ont été ravaudés, transformés, voire déformés pour s’adapter à des circonstances et à des idéologies différentes et parfois opposées », Mireille Delmas-Marty, grande spécialiste du droit international disparue le 12 février 2022, centre son propos sur le devenir récent de la justice pénale. Elle montre comment les attentats de 2001 ont constitué (et ici elle se réfère à la théorie de René Thom) une « véritable catastrophe de bifurcation » en faisant paradoxalement de la sécurité la première des libertés. La banalisation de l’état d’urgence a produit « un double effet de brouillage quant aux fonctions de justice dans les systèmes de droit ». D’abord un brouillage « anthropologique » entre la fonction punitive de la justice et l’instauration d’une justice « prédictive » qui transpose à des humains « dangereux », voire à des populations humaines « à risque », un principe de précaution emprunté au droit de l’environnement et des produits de consommation. Ensuite un brouillage plus politique entre l’État de droit, c’est à dire rappelle-t-elle, soumis au droit, et l’État de surveillance et de suspicion « qui instrumentalise le droit en mêlant le crime et la guerre ». L’assimilation du crime à un acte de guerre a permis, par exemple, aux États-Unis de légitimer les frappes contre l’Irak de 2003 comme un acte de légitime défense « préventive ». Ce basculement « a conduit d’autres pays, dont la France, à justifier les assassinats ciblés consistant pour le pouvoir exécutif à juger, condamner et exécuter les ennemis sans procès ».
Michel Foucault avait décrit une période pré-étatique. Nous nous trouvons maintenant dans un période post-étatique, où les liens d’allégeance font refluer l’ordre de la loi, avec la mondialisation de la surveillance, la délocalisation des lieux de détention secrète ou de torture. La privatisation des armées au profit des États les plus riches contraste douloureusement avec l’absence d’armée ou de police pour faire appliquer, notamment, les décisions de la Cour pénale internationale. Quand, dans la lutte contre le terrorisme mais aussi contre le coronavirus, on invoque la guerre, on instaure de fait un état de guerre « sans frontières territoriales, sans droit de la guerre et sans traité de paix ». « Cela s’appelle une guerre civile », écrit Mireille Delmas-Marty, « et cette guerre civile, déjà mondiale, pourrait devenir permanente ». Seul un sursaut de la société civile, une « énorme insurrection de l’imaginaire » comme l’écrivait Édouard Glissant, pourrait faire surgir de nouveaux « citoyens du monde » ne se résignant ni à une gouvernance de la peur ni à une gouvernance du tout-marché.
La section « Reconnaissances » est consacrée aux regards que la société porte sur elle-même, à des catégories envisagées sous un jour nouveau, comme les classes, la citoyenneté, les sexualités, à des concepts apparus récemment comme le genre ou le care, à des concepts parfois déniés (le décolonial) ou détournés de leur sens premier. C’est le cas de la laïcité, dont l’historienne Valentine Zuber rappelle, fort utilement, qu’elle est un principe fondamental du vivre ensemble, comme l’avait énoncé en 2005, lors du centième anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l’État en France, une Déclaration universelle de la laïcité signée par plus de 250 intellectuels issus de 30 pays différents. Même si ce concept a été mis en œuvre dans le cadre d’une histoire nationale particulière, la laïcité n’est plus une exception française. Cependant, ce principe issu d’une philosophie politique libérale s’achemine vers une interprétation illibérale, comme le montre la loi de 2021 « confortant les principes de la République » qui semble « renforcer les pouvoirs de l’État en matière de contrôle et de police des cultes, au détriment de l’autonomie et des libertés de ces derniers ». « Comprise auparavant comme condition de l’exercice des libertés, la laïcité se mue en principe d’identité nationale et de système de sécurité publique. » Dans une société démocratique, c’est bien l’État qui doit être laïque, c’est-à-dire neutre et impartial, et « non la société elle-même, nécessairement pluraliste ».

© Jean-Luc Bertini
La sixième partie de l’ouvrage explore, de façon parfois assez abstraite et théorique, les pistes déjà ouvertes vers d’autres possibles, en matière économique ou environnementale. Il y est question d’autres manières de travailler, de consommer, et même d’être citoyen, en pensant la démocratie, comme le fait Sandra Laugier, à travers le prisme de la désobéissance. Le livre se termine sur une série de chapitres qu’on pourrait dire « hors-champ », rédigés qu’ils sont par des autrices et auteurs (parmi lesquels le philosophe Axel Honneth, la politiste albanaise Lea Ypi, la sociologue palestinienne Islah Jad) n’appartenant pas au monde universitaire français, et à qui Didier Fassin a suggéré de donner « libre cours » à leur réflexion. Roberto Esposito y parle, par exemple, d’immunité commune, c’est-à-dire de l’immunité qui, au lieu d’exclure, devient un « dispositif d’exclusion universelle ». C’est à Felwine Sarr qu’a été confié le dernier chapitre, « Être vivant, demeurer humain », dans lequel il appelle à rompre avec le rapport instrumental à la nature et « à porter la vitalité à son plein régime », « à semer les graines de la vie ».
On est loin alors des analyses souvent austères, et cependant pleines d’informations, des chapitres précédents. Cette belle envolée du penseur sénégalais n’est pas une conclusion. Didier Fassin a introduit le volume, mais s’est refusé à toute synthèse finale et à toute prospective, même si le choix des auteurs pointe un projet politique qu’on pourrait qualifier de profondément démocratique et humaniste. On ne peut que saluer cette entreprise de réflexion collective au cours de laquelle des sujets voisins (la démocratie, les femmes, l’écologie, le travail, les migrations, la santé…) sont abordés sous des angles divers qui ne convergent pas toujours. L’essentiel est de fournir au plus grand nombre les éléments de savoir qui devraient pouvoir nourrir un véritable débat. La société qui vient sera ainsi une société ouverte.











![Collectif[1], La condition intérimaire, La Dispute, 2024, 164 pages. Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, Raisons d’agir éditions, 2024, 154 pages. Éric Louis, Casser du sucre à la pioche, chronique de la mort au travail, Rennes, Éditions du Commun, 2024, 140 pages.](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/10/1600px-A_Warning_To_Be_Careful_While_Working_Eine_Mahnung_zur_Vorsicht_bei_der_Arbeit_MET_DP344663.jpg)
