Denis Podalydès, acteur, scénariste, metteur en scène, écrivain, aime les rôles qui sortent du cadre – tel son Passe-muraille –, inclassables, excentriques, comiquement ou tragiquement obsessionnels : Joseph Rouletabille, Konstantin von Essenbeck, mais aussi Richard II, Diafoirus, Harpagon, Alceste, Arlequin de Marivaux, Dufausset de Feydeau… En janvier, il incarnait en alternance Oscar Ekdal dans Fanny et Alexandre et l’Orgon du nouveau Tartuffe. C’est son investissement sans réserve dans cette aventure audacieuse, la dernière en date, qui m’a fait rouvrir le récit de la précédente, La nuit des rois, relatée dans Les nuits d’amour sont transparentes.
Denis Podalydès, Les nuits d’amour sont transparentes. Pendant La nuit des rois. Seuil, 272 p., 21 €
L’auteur Podalydès dédie ses souvenirs au grand art de son metteur en scène, Thomas Ostermeier, ainsi qu’à Olivier Cadiot, dont la traduction et l’œuvre ne sont pas étrangères à son envie d’écrire ce livre. N’espérez pas de révélations croustillantes sur la vie des coulisses : s’il y a eu des conflits ou des drames, on n’en saura rien. Ses portraits sont bienveillants, subtils, emplis d’admiration pour le talent de ses camarades, qui les fait échapper aux déterminismes culturels, « et prouve que l’universalisme existe ». Ses émotions se succèdent à vive allure, exaltation, abattement, saveur de découvrir, plaisir du chant, ivresse des mots, angoisse de l’amnésie, blocages, désir d’être « simple, naturel, vivant ». Le bonheur de l’entreprise collective se paie de doutes sur ses propres aptitudes à rencontrer son personnage, de son épouvante en découvrant le costume qui va l’exposer sans merci aux regards, de ses inquiétudes : « Suis-je trop collet monté, trop cul serré ? »

Denis Podalydès (2008) © Jean-Luc Bertini
Le livre, composé à l’aide de notes éparses prises au cours de répétitions, se concentre sur l’élaboration complexe de la mise en scène et la recherche de son rôle. D’abord, un résumé clair des intrigues, humeurs et confusions de la pièce, où la circulation du désir bouscule les catégories du genre. Certes, Antonio est épris de Sebastian, mais sont-ils amants, rien n’est moins sûr, leurs échanges ne disent pas si son amour est payé de retour. On s’en souvient, Ostermeier entendait éclairer les tensions homosexuelles de l’œuvre, faire tomber les interdits latents, d’où un Sebastian giton, « petite frappe, allumeur, facétieux », qui passe avec aisance de bras en bras. La souffrance d’amour, celle des amoureux véritables, est au cœur de l’action. À la table, les comédiens écoutent d’abord des exposés sur le contexte élisabéthain, l’Église anglicane, les conventions du travesti, la dimension politique de la pièce, les dominantes de chaque personnage, leurs équivalents dans le monde réel. L’Illyrie d’Ostermeier est rongée par la vacance du pouvoir, un duc démissionnaire, une comtesse qui peine à imposer son autorité, reflet de la jeune souveraine que fut Elizabeth. Un monde dangereux, où Viola déguisée en garçon doit avoir constamment peur d’être démasquée. La nature y reprend ses droits, signalés par la présence de trois grands singes. Avec le recul, on pourrait y voir une prémonition de la pandémie, le retour des animaux dans nos villes désertées.
Denis Podalydès confie qu’il rêvait par intermittence depuis vingt-cinq ans de monter la pièce. Son plateau aurait été cerné de bouteilles, « astres de verre qui auraient éclairé l’ivresse ambiante dans cette île de rire et de deuil ». Plutôt funèbre, dans un vieux cimetière de campagne, hanté par les images d’un de ses films favoris, Moonfleet, des souvenirs de classes préparatoires littéraires, du Conservatoire, un amour transi de lycéen, l’addiction de son frère, qui lui « faisaient rechercher ce climat interlope de mélancolie, de dérision, de gaîté alcoolique et de mort ». À deux reprises, il était prêt à se lancer et a dû remballer son projet quand on lui a proposé un rôle dans celui d’un autre. Jouer le duc Orsino le confronte à une double approche externe du texte. Il exulte en découvrant la traduction d’Olivier Cadiot, son éclat, sa « réjouissante folie », ne critique jamais la mise en scène, ni ne la mesure à celle qu’il avait en tête. Au contraire, il exprime une adhésion totale, inconditionnelle, au projet du maître d’œuvre, peut-être condition sine qua non de son alchimie délicate. Il se sent « en état de pure disponibilité » : aucun scepticisme, mais une confiance enfantine qu’il n’éprouve jamais aussi bien qu’en répétition.
Même adhésion, à l’entendre, chez l’interprète de Malvolio le puritain, Sébastien Pouderoux, qui parvient à ravaler chagrin, pudeur et orgueil quand Ostermeier coupe sans avertissement préalable sa dernière scène : « La confiance qu’il lui conserve, l’admiration profonde qu’il voue à celui qu’il reconnaît pour son maître, lui ont aussi dicté son attitude stoïque. » C’est Pouderoux qui suggérera de conclure par le suicide du trouble-fête, sans soulever d’autre question. Mystérieuse docilité, abandon de soi à la vision d’un autre, Podalydès est en priorité, il en est conscient, un acteur. Pourtant les suggestions, les idées lui viennent en foule, composant une lettre virtuelle – « Cher Thomas, qu’en penses-tu ? » – qu’il ne finit pas. Plus tard, il aimerait voir réintroduire la chanson « Come away, Death », qui a été remplacée par un air de Cavalli, mais il est trop tard pour changer, et le point crucial, lui explique patiemment Ostermeier, c’est que la musique ne console plus Orsino, quelle que soit la chanson. Était-ce sa vieille mise en scène qui remontait, le besoin d’intervenir au-delà de sa fonction d’acteur ? Le livre semble s’attacher à résoudre cette contradiction.
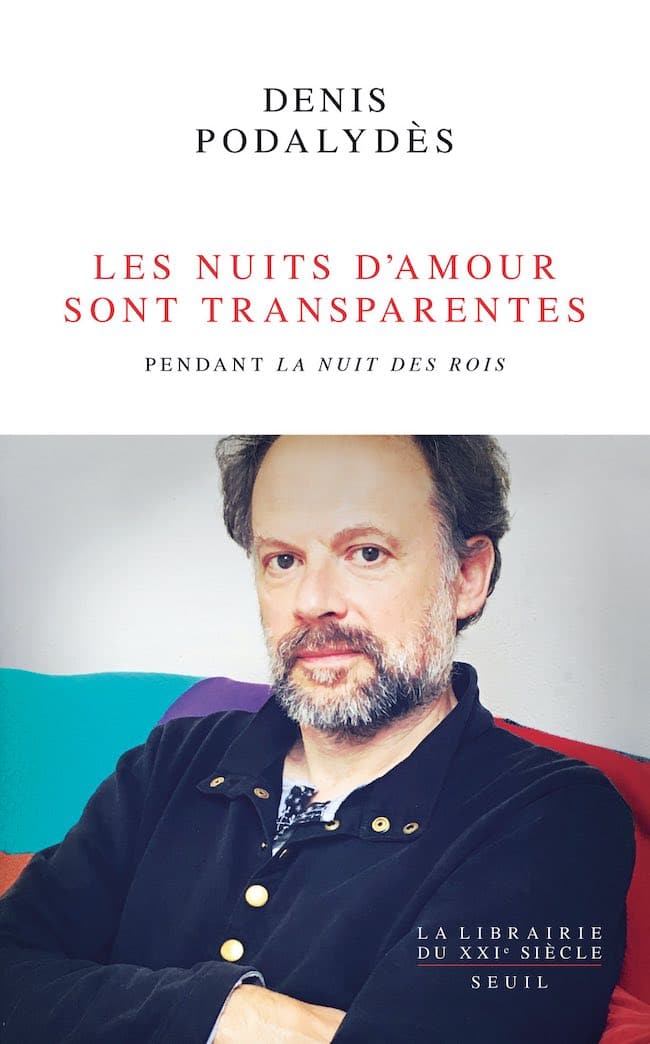
Thomas Ostermeier, deux fois grand comme lui, le regard vert, écoute tel un fauve à l’affût, refuse qu’on théâtralise les émotions, qu’on fixe une scène, et il laisse ouvertes les possibilités d’expérimentation avec une apparente désinvolture. On attend qu’il commente, corrige, il se tait, enchaîne. « S’il ne rit pas, on entend aussi l’absence de rire. On s’interroge alors. » Chaque scène, chaque personnage se dessine peu à peu, nuance après nuance, détail après détail, au cours de « longues séances suspendues, évasives, apparemment contradictoires ». L’exercice du storytelling crée des relations croisées entre les acteurs. Ils inventent des histoires où affleurent des souvenirs personnels. Tandis qu’il raconte une farce subie lors d’un camp de louveteaux, Podalydès se voit soudain « en Malvolio enfant », timide et morose, jaloux, vivant la solitude extrême du mystifié. Une méthode élaborée par Ostermeier, pour qui « des consignes trop strictes donnent des résultats rigides, gauches et austères », le but d’une mise en scène créative étant de « faire des découvertes avec d’autres personnes créatives », comme l’expliquait le metteur en scène dans ses entretiens avec Gerhard Jörder (publiées sous le titre Backstage, L’Arche, 2015). Des exercices inspirés de la biomécanique leur font oublier le sens des mots, trouver le rythme approprié, jusqu’à redonner à chaque réplique « l’éclat d’une idée nouvellement formulée ».
C’est aussi avec le traducteur que Podalydès discute après coup, par textes interposés – les traducteurs, plutôt, car, le texte de Cadiot n’étant pas encore prêt, c’est celui de Jean-Michel Déprats qui est utilisé au moment des auditions. À cela s’ajoutent ses propres tentatives, et l’original anglais qu’il se récite comme un mantra. Presque une langue maternelle, car sa mère l’enseignait, qui le rassure et l’accompagne. « Aucune phrase de la pièce ne va de soi. Chacune contient un trait d’esprit, une métaphore, un double sens, une allusion, un ornement qui l’enrichit encore, tel quel intraduisible la plupart du temps. » À quelques jours de la première, il fait encore une « lecture et relecture rapide du texte anglais et de diverses traductions ». Le titre du livre reflète déjà un paradoxe : dans la citation originale, « Love’s night is noon », Olivia affirme qu’une faute ne se dévoile jamais aussi vite que l’amour qui tente de se cacher, sa nuit s’éclaire comme en plein midi. Il compare sept traductions du passage, sonorité, justesse, et leur donne une note – inutile, pompeux, parfait – tente la sienne, avant de se rallier à celle de Cadiot.
Denis Podalydès impressionne à la fois par sa sensibilité et son ample culture théâtrale. Derrière l’avancée au jour le jour des répétitions se dessine une réflexion mûrie sur le métier d’acteur, les écoles, les tendances de jeu, sur son hostilité de jeunesse, celle de l’époque, à l’esthétique naturaliste : « Le réalisme était un choix, le naturalisme une maladie, un embonpoint. » Réalisme que recherchait une avant-garde talentueuse, « les Grüber, Stein, Chéreau, Vincent, Langhoff, Lassalle », en lutte contre l’académisme d’un côté, la stylisation de l’autre, dont il voit en Thomas Ostermeier, qui se dit toujours en quête « d’une imagination nourrie par la réalité », l’héritier. Y aura-t-il un livre de dialogue entre l’acteur et la mise en œuvre de Tartuffe ? On ne peut que l’espérer.












