« L’idéologie exige la liberté, mais ne la pense pas », écrivait le regretté Jean-Luc Nancy. C’est précisément l’objectif que s’est fixé Olivier Boulnois, historien de la pensée médiévale, avec ce dernier livre : comment s’est posé au cours de l’histoire le problème de la liberté ; peut-on améliorer cette position en vue d’apercevoir une solution ?
Olivier Boulnois, Généalogie de la liberté. Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 485 p., 24 €
Pour ce faire, il convient d’adopter une méthode généalogique qui consiste à reconstruire l’histoire de la problématisation de la question de la liberté depuis Aristote jusqu’aux Modernes. Mais le lecteur va découvrir qu’une généalogie peut en cacher une autre, que sur le motif de la liberté se surimpose celui de la « volonté », et qu’à la fin il semble que nous soyons, avec ce livre, davantage devant une généalogie du concept moderne de volonté. Bien entendu, liberté et volonté appartiennent au même champ problématique, mais on verra au cours de la lecture que la liberté peut se concevoir en l’absence d’un concept (moderne) de volonté (Aristote) et qu’à l’autre bout de la chaîne chronologique l’accent est mis sur une volonté libre – et libre parce que volonté.

« La Liberté armée du Sceptre de la Raison foudroye l’Ignorance et le Fanatisme ». Estampe de Jean-Baptiste Chapuy et Louis-Simon Boizot (1793-1795) © Gallica/Bnf
Olivier Boulnois fait face d’abord à des difficultés terminologiques, liées comme souvent au passage du grec au latin. La voluntas de Cicéron n’a pas d’équivalent grec. Boulesis, qu’elle est censée traduire, correspond plutôt au souhait. Quant au voluntarius, il traduit le hekousion qui indique surtout la spontanéité (ekón) et qui est généralement rendu en français par l’expression « de plein gré ». Nous sommes dans le contexte grec d’une théorie de l’agir qui doit ajointer souhait, délibération (boulesis) et la fameuse proairesis, la décision (Olivier Boulnois préfère traduire « résolution »). Cicéron a sans doute cherché à rendre ce complexe par le terme de volonté, qui, insistant sur le « plein gré », ne rend pas tout à fait compte du fait que le « volontaire » a une extension moins large que le plein gré puisqu’il est le résultat d’une délibération et d’une décision.
Ce qui est donc décisif dans le cas de l’agir humain et pour qu’il soit véritablement humain, c’est la décision forcément précédée d’une délibération (la proairesis ou l’electio pour les Latins). Être principe de son mouvement ou posséder en soi-même ce principe ne suffit pas à désigner l’agir « volontaire » au sens strict, il y faut le logos, le discernement intellectuel du bien et la décision. Mais, chez Aristote, nous ne délibérons pas sur la fin qui est celle, universellement partagée par les hommes, du bonheur, mais sur les moyens d’obtenir cette fin. Dans le cadre de l’excellence, ce mixte d’intelligence désirante (orektikos nous) et de désir intellectuel (orexis dianoetike) qu’est l’homme vertueux ne se préoccupe pas tant de sa liberté que de sa sagacité (phronesis), puisqu’il est assuré pour les choses qui dépendent de lui (eph’ hemin) d’être le principe de son agir. C’est sa sagacité, sa sagesse pratique, qui lui garantira de désirer toujours mieux le bien adéquat à l’obtention de la fin et la qualité de son agir, au point de l’établir comme mesure de l’agir des autres.
Les Latins vont traduire le grec « to autoexousion » (un dérivé de notre ekón, littéralement « maîtrise de soi » ou « disposition de soi-même »), terme dont Marguerite Harl a montré les diverses provenances, aussi bien stoïcienne, néoaristotélicienne que chrétienne, par « libre arbitre », mettant l’accent sur le choix et sur la puissance des contradictoires et des contraires (vouloir et ne pas vouloir, tel bien et non tel autre). Ce n’est pas tant la responsabilité de nos actes qui était en question – puisque, comme Louis Gernet l’a montré jadis (Recherches sur le développement de la pensée juridique en Grèce ancienne, 1917, rééd. Albin Michel, 2001), le problème de la responsabilité, du volontaire et de l’involontaire est une vieille histoire en Grèce depuis la tragédie –, que, du moins dans la sphère du christianisme, la nécessité d’affirmer qu’aucun bien autre que la fin dernière, la béatitude éternelle, ne peut s’imposer à l’homme qui a été « remis à son propre pouvoir ». C’était caractériser la « liberté » humaine comme une certaine souveraineté à l’égard du monde. Avec le christianisme, ce qui modifie la question de la « liberté » posée par l’Antiquité, c’est la création de l’homme à l’image de Dieu. En quoi, par quoi l’homme est-il cette image : par son intelligence ou par sa volonté ? De cette façon, l’unité du complexe grec (intelligence désirante/désir intellectuel) se rompt peu à peu au profit de la volonté. Autre disjonction identifiée par l’auteur, celle entre capacité d’agir et capacité de vouloir, la seconde prenant le pas sur la première.

Ce n’est plus dans l’horizon de l’agir que la pensée de la liberté va se situer mais dans celui de l’affirmation de plus en plus appuyée d’un pouvoir en l’homme, sa puissance de choix, saint Augustin représentant dans ce chemin, pour Olivier Boulnois, un tournant important. S’émancipant de l’intelligence (comme on le voit chez le franciscain Duns Scot), ou plutôt ne formant plus avec elle le complexe anthropologique, et se séparant de la question éthique, autrement dit du contrôle de nos actions, la « volonté » va finir, au terme de ce parcours, par se vouloir elle-même, et tout l’accent va se porter sur l’autodétermination (on se souvient que la résolution ou la décision ne porte jamais sur la fin dernière). Parvenu à ce point, peuvent apparaître des philosophies de la volonté qui instituent ce concept en fond de toute la réalité. Mais se font jour également des pensées qui recomposent la totalité du réel à travers un concept de liberté qui n’est que la façon adéquate de nommer le mode d’existence de l’homme. « L’existence », c’est alors la liberté (le sens) qui décide d’elle-même, bien au-delà d’une théorie de l’action.
On peut reprocher à Olivier Boulnois une lecture partielle de certains auteurs : pourquoi avoir négligé les belles analyses d’Augustin dans le livre III du Traité du libre arbitre où il explique comment la volonté peut se prendre au piège de son propre miroir, ou, pour une approche complète de la question de la liberté chez Thomas d’Aquin, avoir fait peu de cas des textes sur les actes humains ou les vertus et de la distinction entre détermination de l’acte et exercice de l’acte ? Mais on ne peut qu’être d’accord sur la nécessité, pour résoudre les apories de la liberté, de revenir à une doctrine de l’action et à son contexte éthique, et, par lui, au politique.




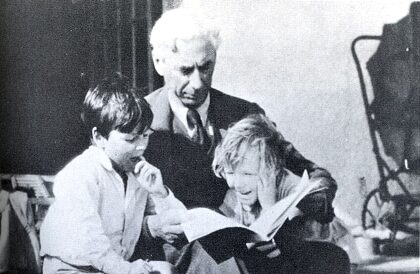



![Theodor W. Adorno, Trois études sur Hegel [1970], tr. de l’allemand par le Groupe du Collège international de philosophie, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 168 p. Theodor W. Adorno, La « Critique de la raison pure » de Kant [1959], tr. de l’allemand par Michèle Cohen-Halimi, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 540 p. Theodor W. Adorno, Leçons sur l’histoire et sur la liberté (1964-1965),](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/11/Paul_Klee_Seiltanzer_1923.jpg)



