Romans et récits (1979-1991) poursuit l’aventure Philip Roth de la Pléiade. Ce deuxième volume représente le sommet de l’œuvre, le moment où l’auteur perfectionne la voix qui sera sa marque de fabrique – une voix sèche, ironique, réflexive – avant qu’il ne sombre dans le conservatisme.
Philip Roth, Romans et récits (1979-1991). Édition publiée sous la direction de Philippe Jaworski, avec la collaboration de Brigitte Félix, Aurélie Guillain et Paule Lévy. Introduction de Philippe Jaworski. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1 584 p., 69 €
Célèbre-t-on Roth pour de bonnes raisons ? Pour les concours français, c’est la période tardive qu’on donne à lire, à partir de Pastorale américaine (1997). Or, sa pérennité repose plutôt sur les textes de la présente Pléiade, avec Portnoy en plus.
Ah, quel drame ce Portnoy ! C’est flippant pour un romancier au milieu de la trentaine de vendre soudainement quatre cent mille exemplaires, de devenir célèbre – et critiqué par ses coreligionnaires – comme vulgarisateur de la masturbation, de la psychanalyse et de l’esprit juif, le tout réuni dans la transcription d’une pseudo-séance ! 69 : année érotique, celle de Portnoy et son complexe et de The Love Machine, roman porno de Jacqueline Susann. L’autrice a été invitée sur le plateau de The Tonight Show Starring Johnny Carson, le Ruquier américain de l’époque, où elle a confessé qu’elle aurait aimé rencontrer l’auteur de Portnoy, à condition de ne pas lui serrer la main.
Pauvre Roth, confondu avec son héros, comme si lui-même se salissait les mains en pratiquant l’auto-stimulation. Les Américains sont-ils naïfs à ce point, incapables de distinguer entre imagination et réalité ? Comment s’adresser à de tels illettrés ?
Bienvenue à Nathan Zuckerman, « masque » supposé de Roth, son nouvel alter ego après avoir débuté comme simple personnage dans Ma vie d’homme (1974). À travers Zuckerman, Roth se venge du lectorat philistin qui l’a enrichi, il met au premier plan la chasse au trésor : la quête du romancier dissimulé. Il dit : « chiche ! ».

Le génie de Roth, c’est d’introduire le lecteur dans le texte : si « jeu de miroirs » il y a, c’est celui de la réception – son véritable sujet. D’une certaine manière, les universitaires idolâtres responsables de ce volume de la Pléiade sont aussi crédules que le public de 1969 : ils prennent pour l’oracle de Delphes les déclarations de l’auteur concernant ses intentions et le fonctionnement de son univers fictif. Selon leur lecture obéissante, l’intérêt de cette œuvre réside dans la façon dont Roth se déguise (parfois en Zuckerman, parfois en « Philip »). La mort de l’auteur ? Tu parles ! Relisez Barthes, mesdames et messieurs !
En tout cas, Gil Carnovsky se substitue à Alexander Portnoy, endossant son rôle de héros d’un roman éponyme à l’origine de la fortune, de la notoriété et des ennuis de son créateur : l’Histoire se répète une seconde fois comme une farce. Au début de Zuckerman délivré, on pense justement à Jacqueline Susann, préoccupée par la patte de Roth, lorsqu’un passant apostrophe Nathan : « Hé, tu veux voir mes dessous, Gil ? »
Mais là on va trop vite : Zuckerman délivré est le deuxième volet de la « trilogie Zuckerman » contenue dans la présente Pléiade ; d’abord, il faut passer par L’écrivain fantôme, le premier volet. On est en 1956 ; à vingt-trois ans, Nathan Zuckerman n’a publié que quelques nouvelles. Il va en Nouvelle-Angleterre pour rendre visite à E. I. Lonoff, doyen des romanciers juifs d’Amérique. C’est un grand honneur que d’être reçu par l’illustre écrivain, vivant dans une ferme seul avec son épouse. Il donne des conseils à son acolyte, qui l’écoute, le regard attiré par la jeune, belle et mystérieuse assistante de Lonoff. Elle a beau s’appeler Amy Bellette, Zuckerman se convainc qu’il s’agit d’Anne Frank, qui aurait survécu à la Shoah pour échouer après la guerre aux États-Unis.
Quelle honte ! Comment ose-t-il nier le martyre d’une sainte juive ? C’est du pur révisionnisme ! Pire encore, Zuckerman imagine une idylle adultère entre Anne/Amy et son employeur. Le comble, c’est que Nathan tombe lui-même amoureux de la fille, il flirte avec l’idée de la rendre enceinte – oui, n’en déplaise à Paule Lévy, le thème de la conception (avortée, miraculeuse) est fondamental chez Roth : Zuckerman, infécond comme Roth, pourrait ainsi se vanter d’une noble progéniture juive.
Infécondité ? C’est le calvaire de Lonoff, amalgame de Roth et de Bernard Malamud, dont la description du métier fait froid dans le dos : un processus stérile consistant à tourner et retourner des mots dans l’espoir d’enfanter deux ou trois phrases par jour. Une occupation vide.
Zuckerman enchaîné – le vrai nom de la « trilogie Zuckerman » – se résume à un portrait de ce vide, le trou béant autour duquel gravite l’univers du créateur de Carnovsky. Nathan préfigure les Kardashian, la plume en plus. Bien avant Instagram, les célébrités avaient des followers, friands des détails quotidiens de leur coqueluche. L’adepte de Nathan s’appelle Alvin Pepler. Dans Zuckerman délivré, le deuxième volet de la trilogie, il réussit à coincer son idole dans une épicerie fine de l’Upper East Side. Nathan lui donne son cornichon, avalé avec l’agilité d’une belle fellation, acte fétiche chez Roth. Pepler est une sorte de pep girl (pom-pom girl, majorette), il existe pour acclamer son héros. Sommes-nous tous des Alvin Pepler, avides de frôler l’auteur en chair et en os, de le tripoter ?
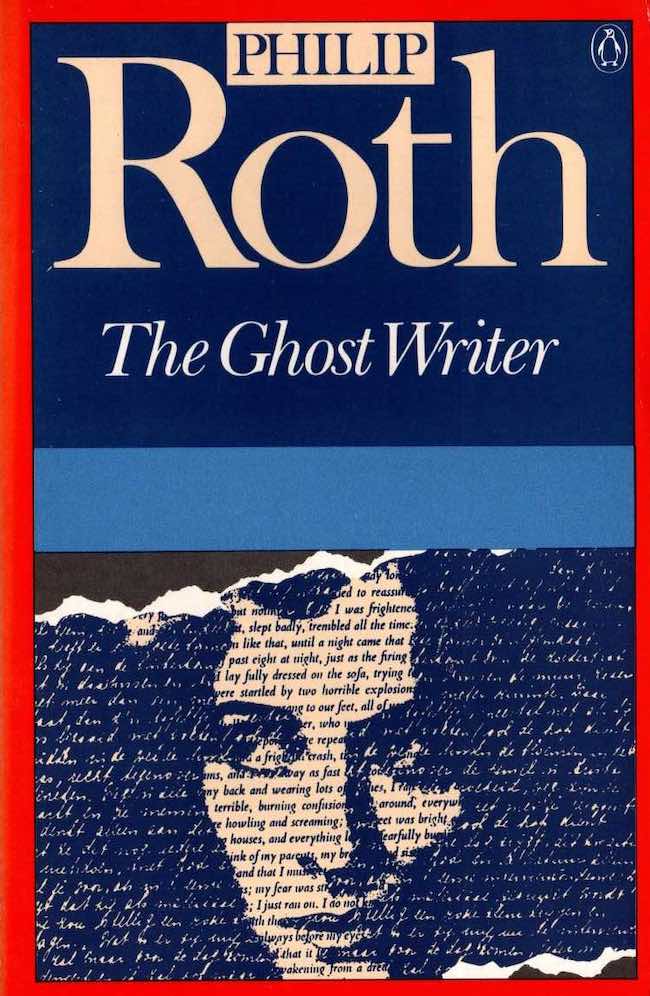
Édition de 1986 de « L’écrivain des ombres »
Corps ou corpus… c’est la ligne de fracture traversant sa carrière, révélée dans le troisième volet, La Leçon d’anatomie. En anglais, « corpus » recouvre les deux sens, d’où le jeu de mots à la fin : « …as though he still believed that he could unchain himself from a future as a man apart and escape the corpus that was his » (« …comme s’il croyait encore qu’il pourrait s’arracher aux chaînes de son avenir d’homme à part et échapper au corpus qui était le sien »).
En panne d’inspiration – thème repris du premier volet – et souffrant physiquement, Zuckerman part pour Chicago, ville réputée pour son aspect charnel (les parcs à bestiaux), haut lieu du passage à l’acte (Al Capone, Bellow…), où le corps ne se laisse pas freiner par les scrupules métaphysiques de la côte Est, pour adopter une approche symbolique, peu compatible avec ce volume de la Pléiade. Las de son métier, Zuckerman se renseigne auprès d’un praticien hospitalier sur la possibilité de se reconvertir en médecin : il serait enfin utile, il aurait une occupation concrète. À la fin du roman, il retournera à l’hôpital, en tant que patient, et aura l’occasion de parcourir les couloirs avec les professionnels.
La Leçon d’anatomie se nourrit d’invectives : Zuckerman enrage contre l’intellectuel new-yorkais Milton Appel, calqué sur Irving Howe, adversaire de Roth et critique véhément de Portnoy. Tel Carnovsky, ce roman a beau porter un titre charnel – avec le mot « anatomie » –, les opérations qu’il effectue sont verbales. Le décalage entre le titre et le sujet fait penser à La leçon d’anatomie de Danilo Kiš (1978), publié cinq ans auparavant, et consacré lui aussi à une dispute littéraire. Roth, éditeur entre 1976 et 1983 de la collection « Writers From the Other Europe » (l’Europe de l’Est), connaissait-il l’existence du roman serbe ? Il n’y a aucune référence à Kiš dans le présent volume.
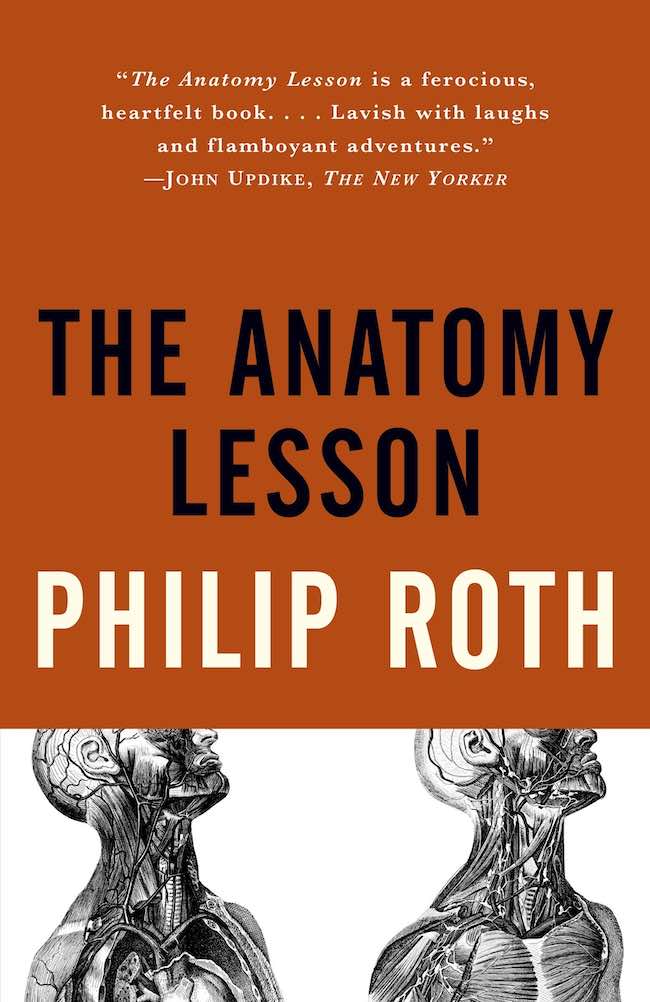
Édition de 1996 de « La leçon d’anatomie »
Autre omission : Moi, Philip Roth (2018), roman de Steven Sampson, mise en abyme où s’entremêlent les thèmes de l’incarnation, de la glose et de la réception. Son narrateur se prend pour Roth et croit que sa vie constitue un commentaire de La leçon d’anatomie. Il recrée ainsi le rapport entre le Talmud et la Torah, entre les Évangiles et l’Ancien Testament : un nouveau canon se bâtit dans les interstices de l’ancien. Le Christ n’accomplissait-il pas la loi de Moïse ? C’est l’ultime leçon d’anatomie.
L’Amérique est pétrie de cette leçon, Philip Roth l’a reçue (voir mes deux essais Corpus Rothi). D’où l’irruption brutale d’un heureux événement à la fin du roman La contrevie, où l’on apprend que Maria, personnage imaginé par Zuckerman, a été mise enceinte par son créateur, épisode minoré par Paule Lévy. La contrevie suit ici la trilogie Zuckerman, ses cinq chapitres font alterner les voix de Zuckerman et de son frère ; l’un ou l’autre est mort, il s’agit de deux univers incompatibles, chacun élaboré autour d’un lecteur : il lit – et commente – les manuscrits du défunt.
La contrevie fait penser au film Zelig de Woody Allen : une fois qu’on a compris le mécanisme astucieux qui est à l’œuvre, on peut se dispenser d’aller plus loin. On reste perplexe devant l’enthousiasme de Marc Weitzmann dans Le Monde (« chef-d’œuvre total »), on ne comprend pas le propos de Pierre-Yves Pétillon selon lequel Roth emboîte le pas de John Barth et de Gilbert Sorrentino avec ce roman de « métafiction ». C’est ignorer la banalité de cette prose. La seule fois où Roth joue à être postmoderne, c’est dans Le grand roman américain, livre poétique, ambitieux et illisible.

Première édition de « La contrevie » (1986)
Cher lecteur, tu suis encore ? Il nous reste le dernier tiers de ce volume. D’abord, Les faits : une « vraie » autobiographie (proche de la fiction, en y remplaçant les noms réels). Elle s’ouvre sur une lettre adressée à Zuckerman par « Roth », qui lui demande son avis sur le manuscrit. À la fin, Zuckerman, mis dans le rôle du lecteur au même titre que le public, répond au moyen de sa propre lettre.
Tromperie se passe à Londres, il est entièrement composé de dialogues. D’un point de vue formel, le texte est excellent, le premier de cette qualité depuis La leçon d’anatomie. « Philip » écoute des gens venus lui parler dans son atelier : sa maîtresse anglaise, une réfugiée tchèque et son ami Ivan. Philip se définit comme « écouteur » (en français dans le texte), c’est un voyeur de l’écoute ; le lecteur vit ce voyeurisme par procuration en le lisant. Il adore entendre l’anglais non américain – l’élégance britannique et l’inélégance étrangère. L’érotisme passe par l’imprimé, la calligraphie est charnelle parce que désincarnée. Voilà pourquoi l’épouse de Philip, apparue dans le dernier chapitre lorsqu’elle trouve son cahier dans leur appartement, n’arrive pas à croire qu’il s’agit d’une fiction : c’est trop réel. Le Verbe s’est fait chair.
Arnaud Desplechin vient d’en tirer un film – Tromperie (2021) –, défi difficile, et raté. Entre Léa Seydoux, aristocrate, et Denis Podalydès, versaillais, il y a un parfait accord linguistique, donc aucun exotisme, partie intégrale de l’érotisme chez Roth. Cet audio-voyeur voyageur affamé – un American Werewolf in London – se serait ennuyé. Desplechin aurait dû s’y prendre autrement : supprimer « Philip » et faire en sorte que ses interlocuteurs brisent le quatrième mur, qu’ils s’adressent directement à la caméra. Avait-on besoin de voir les cuisses de Léa, de regarder ses orteils enveloppant le cou de Denis ?
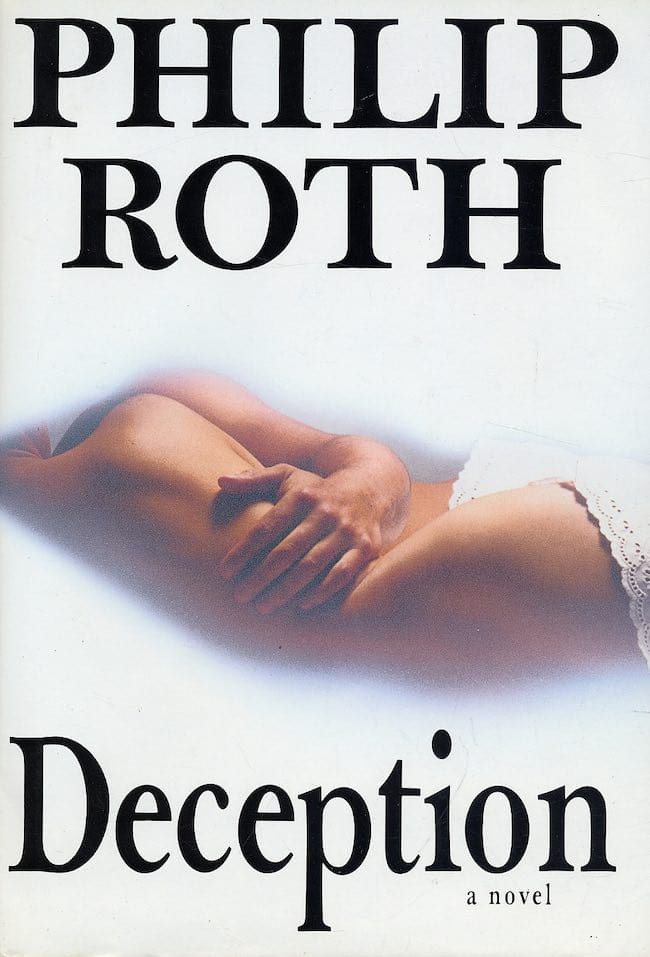
Première édition de « Tromperie » (1990)
Y a-t-il un fil rouge chez Phil Roth ? Briser le quatrième mur, concept cinématographique, s’y prête bien. Dans le présent volume, au lieu de bourrer les notices de citations de maîtres de conférences, de renvoyer l’ascenseur entre membres de The Philip Roth Society (tout en excluant votre humble serviteur, pourtant à jour de ses cotisations !), les éditeurs auraient mieux fait d’étudier Woody Allen : le jeu commun de ces deux « connaissances » de Mia Farrow consiste à casser les barrières, à détruire toute hiérarchisation, à éliminer l’espace entre le lecteur/spectateur et l’artiste, entre créateur et création, entre l’événement vécu et son récit. La vie s’écrit, l’écriture prend vie, parallélisme exprimé dans une phrase de La contrevie, reprise comme épigraphe des Faits : « And as he spoke I was thinking, ‘‘ the kind of stories that people turn life into, the kind of lives that people turn stories into”. » Ici, la traduction détruit l’ambiguïté, tout devient faussement limpide : « À mesure qu’il parlait, je me disais : ‘‘Cette façon qu’ont les gens de réécrire l’histoire de leur vie, ces vies dont les gens font une histoire’’. » Je l’aurais traduite ainsi : « Ce genre d’histoire que devient la vie des gens, le genre de vie que deviennent leurs histoires. » Vie et écriture sont mises sur le même plan, aussi réelles, et irréelles, l’une que l’autre.
Nés dans les années 1930, Allen et Roth sont des Juifs de la métropole new-yorkaise, issus d’une tradition antinomique par rapport à la culture majoritaire. Leur rencontre avec la shikse sert à explorer le vide, dans Portnoy comme dans Annie Hall. Chez Roth, ce vide se cristallise dans la trilogie Zuckerman : son portrait prémonitoire de la société du spectacle relève du réalisme littéraire, contrairement à l’œuvre tardive, façonnée pour les book clubs des banlieues aisées. On pardonne aux éditeurs de cette Pléiade leur vision hexagonale de l’Amérique, leur frénésie rébarbative. Ce n’est pas grave. Comme l’aurait dit Humphrey Bogart : « We’ll always have Philip. »












