Né en 1952, Jean-Michel Maulpoix a commencé à publier à la fin des années 1970. Critique (à La Quinzaine littéraire), fondateur de la revue Le Nouveau Recueil, essayiste, universitaire, il a su, dans une œuvre forte de plus de quarante-cinq publications, rester avant tout un poète. En bonne place dans toutes les anthologies (ou presque), invité régulièrement à l’étranger, il est une des figures qui comptent dans la génération de l’après-guerre.
Jean-Michel Maulpoix, Rue des fleurs. Mercure de France, 88 p., 10,50 €

Jean-Michel Maulpoix © Stéphane Haskell
Après Locturnes qui, en 1978, entrelaçait des courtes proses et des vers, tu as choisi le poème en prose. Aujourd’hui, tu publies un livre qui semble dire que le vers a toujours hanté ton écriture et que sa nostalgie traverse ta bibliographie.
Le vers, en effet, hante mes recueils. Régulier ou non, c’est l’unité de mesure primordiale de l’écriture poétique. J’adhère à ce mot de Mallarmé : « le vers est tout, dès qu’on écrit ». Il est ce qui rend sensibles le rythme, le souffle, mais aussi les impulsions des sensations, des perceptions et des pensées. Il produit de petits cristaux de langue dans lesquels toutes choses peuvent se laisser prendre. Il était donc là dans mes proses « poétiques » où il n’est pas nécessaire de creuser beaucoup pour le retrouver. Ainsi, le rythme 8+6 ou 8+9 travaille en sourdine la prose d’Une histoire de bleu. Rue des fleurs rassemble des bouquets de vers simples qui furent pour nombre d’entre eux les premiers moments de ma prose. Il y a comme un effet de boucle ou d’entrelacs : je pars d’une impulsion cachée qui est le vers, je transite par la prose, et je reviens au vers…
Tu es donc d’accord avec la définition de Valéry : « le poème, cette hésitation prolongée entre le son et le sens » ?
Oui. J’écris beaucoup à l’oreille, en écoutant à la fois ce que pensent et ce que chantent les mots qui s’agrègent en vers ou en prose selon le son et le sens. Plus le son est prépondérant et plus je me rapproche du vers qui est pour beaucoup une chambre d’écho. Mais ce qui importe est aussi le prolongement de l’« hésitation » qu’évoque Valéry : ce qui se met en place sur la page n’est pas un discours ; il y a un chef d’orchestre invisible qui se cache dans la page !
Quand tu as commencé à publier, un certain nombre de notions, discréditées par les mythologies de l’Homme Nouveau, de l’Homme Éternel et de la Poésie, semblaient impossibles à défendre. Soutenu par Maurice Nadeau qui a été ton premier éditeur, tu es monté au créneau en imposant une autre conception du lyrisme…
Étudiant, j’ai engagé une réflexion sur le lyrisme qui reste une notion relativement confuse : je me suis efforcé de la clarifier et lui ai consacré la thèse de doctorat que j’ai soutenue en 1987 à l’université de Nanterre. Mais si je m’y suis intéressé, c’est aussi parce qu’elle concernait mon écriture – une certaine énergie que je souhaitais y mettre, une implication subjective, un rapport dynamique avec la réalité concrète du monde.
Le lyrisme n’a donc jamais été pour toi synonyme de sentimentalisme.
Dans un passé proche, c’est du côté d’André Breton préconisant « le comportement lyrique », ou de Gracq évoquant les « longues rampes fiévreuses » du lyrisme, que je regardais. Mais ce mot vaut aussi bien pour parler de l’énergie du mal chez Baudelaire, ou des visions extravagantes de Rimbaud qui rejette avec force la « poésie subjective ». Assez vite, m’est ainsi venue à l’esprit la notion de « lyrisme critique », à laquelle j’ai consacré un essai, aux éditions José Corti, en 2009. Elle induit l’idée d’une réflexivité lyrique prenant forme à partir de crises qui sont aussi bien les crises de vers de Mallarmé que les crises de la subjectivité de Verlaine. Le lyrisme n’est pas une ivresse de langue, ce peut être une puissance d’examen, une intensité de la pensée qui fait directement jouer les ressorts de la langue.
Où commence et où finit « l’intime » pour toi ?
Rude question ! Essentielle ! Je répondrai par une image qui me vient à l’esprit : l’intime est une caverne, ou un labyrinthe dans lequel je dévide comme je peux des fils pour essayer de m’y retrouver ou de ne pas trop me perdre. Il y a là plus d’ombre que de lumière, beaucoup de choses qui m’échappent et qui déterminent pour une grande part mes relations avec autrui, car l’intime va jusque-là, jusqu’à la capacité de dire « tu », jusqu’à l’intimité telle qu’elle se vit aussi dans l’écriture : ne sommes-nous pas liés par le plus profond, le moins visible, l’inconnu que chacun reste à soi-même ?
Le fait d’être traduit en plusieurs langues apporte-t-il un plus à ta réflexion ?
Je reste perplexe devant les traductions de mes livres. Même si je lis l’anglais et l’espagnol, ainsi qu’un peu d’allemand, il me semble que je ne connais pas assez bien ces langues pour apprécier leur pertinence. Toutefois, les échanges avec les traducteurs sont très intéressants quand il faut trancher des choix de détail : ainsi, L’hirondelle rouge, qui vient d’être traduit en espagnol par Omar Emilio Sposito, a donné lieu à un vrai dialogue, comme la traduction en allemand d’Une histoire de bleu par Margret Millischer. Mais, dans l’ensemble, je regarde mes livres traduits comme des objets étrangers. C’est surtout vrai, bien sûr, pour les traductions en des langues dont j’ignore tout, comme le japonais ! Néanmoins, il est heureux de penser que des textes touchent des lecteurs d’une autre culture. Cela confirme l’idée, chère à Vigny, Mandelstam, Celan et d’autres, que le poème est une « bouteille à la mer ».
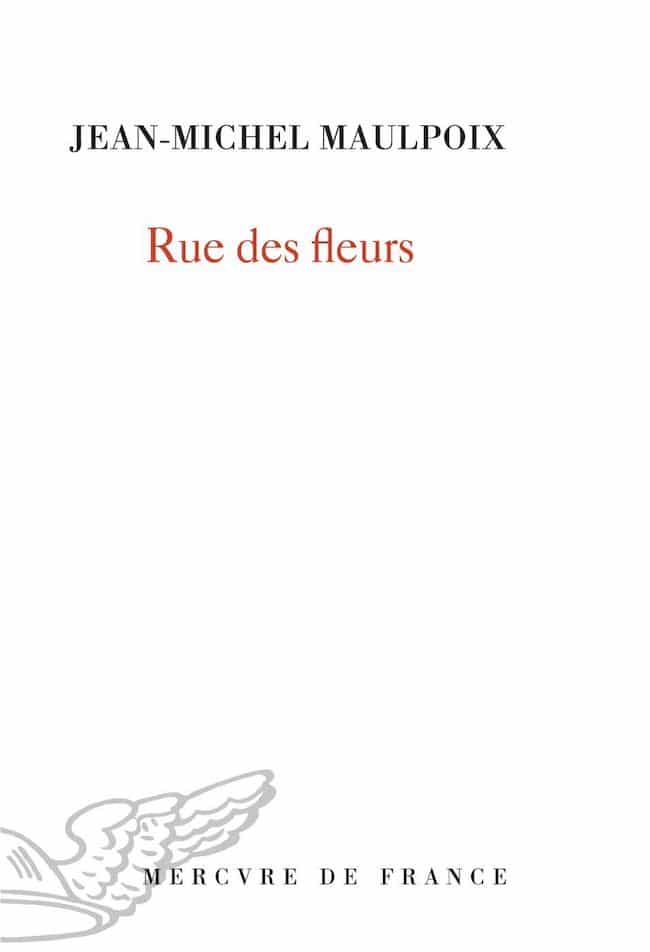
Tu as défendu et tu défends des poétiques très opposées. Comment parviens-tu à soutenir celles qui te sont « étrangères » ?
Rien de ce qui se passe dans l’époque ne m’est indifférent, ni rien de ce qui se passe dans le sort de la langue que nous parlons et que nous écrivons. Les différents régimes du langage m’intéressent, m’interrogent, et je suis sensible à la plasticité extrême de la poésie, capable de donner lieu aux discours les plus simples ou les plus sophistiqués, de prendre le parti de la nudité ou de l’ornemental, de se charger d’images ou de dire les choses telles quelles, etc. J’aime voir vivre la langue dans tous ses états !
J’en reviens à Rue des fleurs. Certains de ses poèmes ont été publiés sous une forme différente. Pourrais-tu nous dire pourquoi et comment tu les reprends ?
Ce livre est né d’un travail de relecture et parfois de réécriture. Je désirais reprendre certaines pages écrites il y a bien longtemps, pour certaines en vers, pour d’autres en prose. La tonalité d’ensemble est, comme d’habitude, plutôt mélancolique, mais il s’agit ici de fleurir la mémoire de l’adieu avec la parole des commencements. C’est un curieux exercice mental, une sorte de yoga affectif, que cette relecture-réécriture : elle modifie la respiration, donne de la souplesse, et distille, me semble-t-il, une résignation douce-amère. C’est comme apprendre à disparaître et consentir à la finitude en prenant appui sur des images précoces, un brin naïves, comme innocentes de la charge de douleur que déjà elles transportent. Rue des fleurs peut ainsi être entendu de plusieurs manières : c’est le nom de la rue où j’habite dans la banlieue de Strasbourg, c’est une métaphore du recueil, c’est un bouquet de textes offerts, ce sont aussi les allées fleuries du cimetière à la Toussaint. D’ailleurs, le livre tourne autour d’un texte de naguère auquel je suis resté très attaché, « Cimetière », qui s’est longtemps intitulé « Toussaint ». Dans mon esprit, ce livre marque une pause lyrique, mais c’est aussi un travail de mémoire.
D’où te vient ton goût pour les citations ?
J’écris pour une grande part dans la mémoire de mes lectures et je me guide dans le labyrinthe de l’intime grâce à des poteaux d’angle – c’est un mot de Michaux – qui font office de repères. Des lanternes parfois y sont accrochées : celle de Rilke : « Être ici est magnifique » ; celle de Gracq : « Il n’y a pas de grand poète, si sombre, si désespéré qu’il soit, sans qu’on trouve au fond de lui, tout au fond, le sentiment de la merveille, de la merveille unique que c’est d’avoir vécu dans ce monde et dans nul autre » ; ou celle de Jabès : « Le poème est la soif que le désir d’une plus grande soif étanche ».
Rue des fleurs n’est-il pas aussi, à sa manière, un travail de citation ?
En effet, puisque j’ai repris d’anciens textes, d’anciens titres aussi, en les sortant de leur contexte initial, en les déplaçant, en les réorganisant autrement, selon le principe du « bouquet », avec des clins d’œil multiples à des poètes du passé, des saluts à quelques amis, des pas de côté, bref une sorte de jeu de marelle lyrique, comme celui de la petite fille que j’évoque dans mon livre et qui sautille sur les carreaux de linoleum dans un couloir de l’hôpital… J’ai aussi choisi dans ce livre d’assumer quelque chose comme la légèreté du poème, son allant ou sa fausse insouciance porteuse de gravité.
Propos recueillis par Gérard Noiret











